 
LES CAHIERS Science & Vie -
226 - Décembre 2025
Entretien
avec JEAN-LOIC LE QUELLEC
anthropologue, préhistorien et mythologue,
directeur de recherche honoraire à l'Institut des
mondes africains (CNRS), spécialiste des images rupestres.
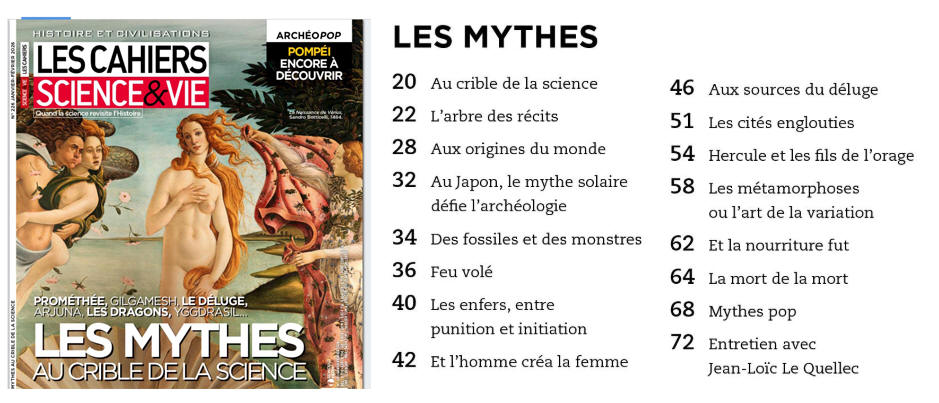 |
|
Ce que nous appelons
"mythe' n'est que le récit des autres sur le monde.»
Entretien avec JEAN-LOIC
LE QUELLEC
Propos recueillis par
Anne Lefevre-Balleydier
JEAN-LOIC LE QUELLEC,
anthropologue, préhistorien et mythologue, directeur de recherche
honoraire à l'Institut des mondes africains (CNRS), spécialiste des
images rupestres.
PRENEZ LE SUPPOSÉ
ARCHÉTYPE DE LA TERRE MÈRE ; DANS CERTAINES SOCIÉTÉS, LA TERRE EST
MASCULINE
TALLEYRAND AFFIRMAIT QUE
"LA PAROLE A ÉTÉ DONNÉE À L'HOMME POUR DÉGUISER SA PENSÉE"
Cahiers de Science & Vie:
Quelle définition donneriez-vous du mot «mythe»?
Jean-Loïc Le Quellec: Ce
mot vient du grec muthos, qui signifie « discours», Il ne
désigne donc ni une image, ni une personne, ni un objet, mais des
paroles. Plus précisément, il s'agit d'un récit particulier,
structure autour d'un renversement. Il raconte qu'à une époque
très lointaine et indéterminée - «jadis, a l'origine», «en ce
temps-la » le monde était dans un certain état. Puis survient un
événement qui transforme tout, expliquant ainsi pourquoi le monde
est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Autre point essentiel : ce
récit est construit et transmis collectivement, et, pour le groupe
qui le raconte, il exprime toujours la vérité.
CSV: En somme, le
contraire de l'usage commun du mot ...
J-L.L.Q .: Tout a fait.
Aujourd'hui, on appelle «mythe> un récit qui nous induit en erreur
et qu'il faut démystifier, . debunker », Pourtant, pour ceux qui
l'ont créé et transmis, ce récit dit le vrai, et ils n'accepteraient
pas qu'on le qualifie de mythe. Ce sont les autres qui le perçoivent
comme une croyance, un récit mensonger ou fallacieux. Autrement dit,
ce que nous désignons comme «mythe» n'est en réalité que le récit
des autres sur le monde : on les repère facilement dans la
littérature grecque antique ou dans les histoires des Papous, mais
il est beaucoup plus difficile de reconnaitre nos propres mythes.
CSV: Sont-ils différents
des légendes et contes populaires?
J-L.L.Q .: Dans les trois
cas, il s'agit de folklore narratif, c'est-à-dire de narrations
bâties sur des savoirs populaires folk signifiant peuple. et leur
savoir ., D'après les folkloristes, le mythe évoque des divinités et
des héros primordiaux, présents sur Terre avant les humains. Le
conte, qui se déroule lui aussi dans un temps ancien et flou, met en
scène des humains ordinaires, mais dont les comportements suivent
des modèles stéréotypés. La légende, quant à elle, se rattache a un
lieu précis : une source, un menhir, une foret, etc. Mais faut-il
vraiment les distinguer ? Georges Dumezil et Claude Lévi-Strauss
répondaient par la négative, et je suis de leur avis. Tous ces
récits partagent un certain nombre de constituants élémentaires
qu'on appelle «mythèmes» ou «motifs». Ainsi, le motif du héros qui,
après avoir été décapité, ramasse sa tête et marche en la tenant
dans ses mains se retrouve autant dans des récits préchrétiens que
dans La Légende dorée, recueil du XIIIe siècle relatant la vie d'une
centaine de saints, Les classer en mythe " ou « légende
hagiographique » n'apporte finalement que peu d'information sur leur
histoire réelle.
CSV: Comment expliquer
que ces mythes soient présents dans toutes les civilisations?
J-L.L.Q .: Le fait
mythique est consubstantiel à l'humanité. Comme le soulignait Nancy
Huston, nous sommes des êtres fabulateurs : nous utilisons la parole
pour nous inventer des histoires. Talleyrand affirmait que «la
parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée», et c'est
sans doute très vrai. Prenons la mort : aucun peuple ne l'aborde
avec indifférence. Partout, l'humanité invente des récits sur
l'origine de la mort et de la souffrance. Ces récits varient : ici,
la faute est attribuée à une fenêtre, là à un homme, à un groupe, ou
à une force mystérieuse. Seule l'existence de ces récits, elle, est
universelle. Personne ne répond : Cette question est idiote, passons
à autre chose. » Toujours, on raconte une histoire. Elle n'explique
en rien la mort, mais elle lui donne un sens, et permet de croire
que l'on ne meurt pas sans raison.
CSV: Parfois, les récits
semblent très similaires d'un point a l'autre du globe ...
J-L.L.Q .: Oui, et cela
ne pose question que pour des récits élaborés. Pour des histoires
très simples, on peut imaginer qu'elles surgissent spontanément dans
l'esprit des gens en des lieux et a des époques différentes. Carl
Gustav Jung est allé plus loin en proposant que certains éléments
fondamentaux, qu'il appelle . archétypes >, soient universels et
indépendants de la culture. Mais il n'a pas réellement fait l'effort
de le démontrer, et cette théorie ne résiste pas aux faits. Prenez
par exemple le supposé archétype de la Terre mère : cette image est
très présente dans nos propres mythes, mais il existe des sociétés
pour lesquelles la Terre est masculine, et il ne s'agit donc pas
d'une notion universelle. Surtout, des que les récits sont
complexes, avec une longue succession d'événements et de nombreux
détails, il faut chercher une autre explication a leur présence
simultanée dans des sociétés qui n'ont jamais été en contact.
D'autant qu'en étudiant leur répartition a travers le monde, on
constate que certains sont présents ici, mais pas la : la seule
hypothèse plausible est donc celle de récits ancestraux, qui se sont
transmis et diffuses au fil des migrations humaines.
CSV: N'ont-ils pas été
transformes et remodèles?
J-L.L.Q .: Bien entendu.
A l'échelle de l'humanité, l'invention de l'écrit est très récente.
Si bien que, pendant des millénaires, ces récits ont été transmis
oralement souvent par des gens spécifiquement chargés de les
mémoriser et de les répéter fidèlement, quand ils étaient considérés
comme «sacrés», c'est-à-dire porteurs d'une vérité absolue. Il
n'empêche. Même avec la meilleure volonté, raconter une histoire
implique toujours des modifications : des oublis, des réactions
inattendues de l'auditoire poussant à ajuster un passage, etc. Ces
variations, inévitables, façonnent la descendance des récits. D'un
lieu à l'autre, ils peuvent ainsi légèrement changer : on reconnait
l'histoire, à quelques détails près le héros s'appelle autrement, la
montagne devient colline, etc. Mais quand ces modifications
s'accumulent, on finit par obtenir des récits très différents. Comme
en biologie, en comparant deux à deux leurs différences pour une
série de caractères ici les tythètnes ou motifs - il est possible de
reconstituer leur généalogie.
CSV : Mais pourquoi nous
racontons-nous ces histoires? A quoi servent les mythes?
J-L.L.Q .: D'abord, parce
que nous adorons les histoires, et ce des la petite enfance.
Adultes, nous lisons des romans, regardons des séries, allons au
théâtre, a l'opéra, au cinéma : tout cela, c'est du récit. C'est
universel. Quand quelqu'un raconte bien, on se laisse emporter : on
y croit, on s'y croit. Cette faculté à partager un monde mental
commun renforce le lien entre nous : on fait groupe. Et cela suffit
à expliquer la persistance du récit, qu'il soit ou hon mythique.
Quant aux mythes, au-delà de donner un sens par exemple, a
l'existence du monde, des humains, ou encore au fait que certains
soient riches et puissants, d'autres pauvres et faibles ils peuvent
inspirer des actions, justifier une guerre, un positionnement
politique ... et pour ceux qui y croient, il ne peut pas en aller
autrement.
CSV : Notre rapport aux
mythes a-t-il évolue?
J-L.L.Q,: Non. On y
adhère toujours de la même manière. Mais avec le temps, certains
récits autrefois tenus pour vrais sont désormais perçus comme des
mythes - au sens cette fois de belles histoires poétiques et sources
d'inspiration artistique, auxquelles toutefois l'on ne croit plus.
Par exemple, le récit de la création du monde en six jours n'est
plus majoritairement considéré comme une vérité absolue. Parce que
le discours de vérité mythique a cède la place au discours de vérité
scientifique.
CSV: Mythes et sciences
sont-ils nécessairement eh opposition?
J-L.L.Q .: Ce sont deux
discours concurrents. Mais quand j'entends dire
qu'ils seraient
équivalents, je trouve cela très inquiétant, car leurs fondements
sont radicalement différents. Le mythe dévoile une vérité non
modifiable sur le monde, la science démontre une vérité qui, par
essence, doit être révisée. Un mythe ne se change pas à la carte :
on y adhère totalement, et si des parties du récit sont modifiées,
c'est par inadvertance. Une théorie scientifique, elle, est
contestable et doit être démontrée, c'est même la condition de sa
validité. Contrairement a ce qu'affirmait l'anthropologue James
George Frazer, il n'y a pas dans notre histoire trois âges
successifs de la pensée magie, religion, puis sciences. On voit bien
de nos jours que la science n'a élimine ni les mythes ni les
religions. Et croire que nous serions affranchis des mythes
constitue sans doute ... l'un de nos mythes les plus dangereux!
CSV: Justement, quels
récits contemporains peut-on considérer comme des mythes?
J.L.L.Q. : Par exemple,
nombre d'anecdotes rapportées comme des faits vécus par un proche,
ou l'ami d'un ami, et qu'on appelle souvent < rumeurs contemporaines
.. Bien que présentées comme uniques et authentiques, elles sont
très répandues : les gens racontent la même à des endroits
différents, un phénomène que l'on connait bien avec les légendes
cites " migratoires", Ensuite, ce qu'on appelle « théories du
complot . n'est en réalité qu'une forme de mythologie contemporaine.
Même quand des preuves solides les contredisent, ces récits donnent
du sens a ceux qui y croient. Il y a aussi les récits de type
anthropogénique affirmant que des extraterrestres auraient crée ou
modifie l'espèce humaine, présentés comme vrais dans d'innombrables
livres, podcasts ou films.
CSV : En définitive, les
mythes nous accompagneront-ils toujours?
J.L.L.Q .: Sans aucun
doute. L'histoire, ancienne comme récente, montre que tout peut
devenir matière à reconstruction ou à réinvention mythologique.
C'est, pour reprendre Claude Levi-Strauss, une forme de « bricolage
» à partir du vaste réservoir des récits toujours disponibles et
susceptibles d'être réactivés. Et puis, même lorsque les mythes
cessent d'être perçus comme des vérités, ils continuent de nourrir
notre imaginaire a travers l'art, et notamment le cinéma pensons à
La Guerre des étoiles de George Lucas. Et nous aimons tellement ces
récits que je ne vois pas comment on pourrait un jour s'en priver.
Propos recueillis par
Anne Lefèvre-Balleydier
JEAN-LOIC LE QUELLEC,
anthropologue, préhistorien et mythologue, directeur de recherche
honoraire à l'Institut des mondes africains (CNRS), spécialiste des
images rupestres. |
 
LES CAHIERS Science & Vie -
225 - Novembre 2025


|
|
Entretien avec Jacques Arnould
Propos recueillis par Anne
Lefèvre-Balleydier

|
|
Explorer c'est aussi vital, pour nous les humains, que respirer.
Entretien avec Jacques Arnould
Propos
recueillis par Anne Lefèvre-Balleydier
L'EXPLORATEUR EST D'ABORD CELUI QUI REVIENT SAIN ET SAUF CHEZ LUI
POUR RACONTER SON VOYAGE
DIRE
QUE LA COLONISATION DE L'ESPACE N'AURA JAMAIS LIEU SERAIT UNE
IDIOTIE
Cahiers
de Science & Vie : Vous dites que l'être humain explore comme il
respire. Que révèle ce besoin d'ailleurs -qu'il s'agisse des pôles,
des abysses ou de l'espace ?
Jacques
Arnould : Respirer, c'est a la fois inspirer, incorporer de
l'extérieur, de l'étranger en soi et expirer, sortir de soi.
Explorer, c'est réaliser ce même double mouvement, d'incorporation
et de sortie de soi. À mes yeux, c'est aussi vital pour nous les
humains que respirer. Aujourd'hui, certains estiment qu'il faudrait
cesser d'explorer, notamment l'espace, pour se recentrer sur
l'avenir de notre planète. Leurs arguments sont sensés. Mais je
reste persuade que les missions spatiales nous sont indispensables.
Sans doute cette conviction découle-t-elle d'une vision du monde
très occidentale, d'une cosmologie encore très dualiste qui sépare
notre monde d'un extérieur qui nous échappe et que nous tenons a
découvrir. Ce n'est pas le cas pour d'autres cultures. Aux yeux des
Amérindiens Navajo, par exemple, la Lune n'est pas un ailleurs, elle
appartient a leur monde et héberge les ancêtres. C'est pourquoi ils
ont vivement protesté l'an dernier, quand une mission spatiale
américaine devait acheminer les cendres de défunts sur la Lune.
Reconnaissons-le : il n'est pas évident de faire cohabiter des
représentations aussi divergentes. Il faudrait pour le moins être
plus attentifs a ne pas les ignorer et a uvrer pour une meilleure
connaissance réciproque, comme d'ailleurs cela a été le cas dans le
passe vis-à-vis de certaines minorités américaines.
CSV :
L'exploration spatiale est souvent lue à travers le prisme du mythe
d'Icare. Que nous dit-il ?
J.A. :
C'est un peu la question que j'avais posée a mes futurs collègues du
CNES, il y a environ 25 ans, lors de notre première rencontre. Je
souhaitais leur parler d'éthique sans les effrayer : les ingénieurs
adorent relever des défis techniques et n'apprécient guère qu'on
vienne leur parler de ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ! J'ai
donc commencé par leur demander : « Quel est le grand mythe spatial
? » Ils m'ont répondu : « Le mythe d'Icare ! »
Alors,
j'ai sorti de ma poche Les Métamorphoses d'Ovide, et je leur ai lu
le mythe en question. À la première lecture, on y repère
l'avertissement de Dédale : s'il a conçu des ailes pour Icare, il
sait qu'elles ne supporteront ni les remous de la mer Egée ni
l'ardeur du soleil. Il interdit donc a son fils de voler trop haut
ou trop bas. En somme, un appel a la prudence. N'oublions pas que
l'explorateur est d'abord celui qui revient sain et sauf chez lui
pour raconter son voyage, décrire jusqu'où il est allé, et indiquer
la prochaine étape à franchir. Mais ce mythe nous parle aussi du
plaisir et de la liberté qu'éprouve Icare : il agit comme un enfant
qui reçoit une trottinette ou un vélo et veut aller le plus vite
possible. Une expérience universelle.
CSV :
Et pourquoi Mars nous fascine-t-elle autant, en dépit des obstacles
a surmonter pour l'explorer ?
J.A. :
Elle nous fascine depuis très longtemps.
Autrefois, nos anciens considéraient la Lune comme une sorte de
poste-frontière séparant la Terre des sphères célestes. Puis la
révolution copernicienne a bouleversé cette vision-là. Il n'y avait
plus d'un côté le monde terrestre, laid, altérable et mortel, et de
l'autre un cosmos parfait, éternel et ordonné : l'univers tout
entier obéissait aux mêmes lois et était fait de la même matière.
Ainsi des le XVIIe siècle, Johannes Kepler n'hésite pas a imaginer
que des navigateurs oseront un jour voyager dans le ciel. La Lune
était la première étape, Mars la suivante, longtemps envisagée comme
une petite Sour de la Terre. D'ailleurs, au tournant du XIXe siècle,
l'Académie des sciences crée un prix pour celui qui établirait un
contact avec une autre planète ... en excluant la Lune et Mars, car
tout le monde était persuadé qu'elles étaient habitées !
L'impression de familiarité avec Mars ne date donc pas d'hier. Quant
à l'exploration humaine de la planète rouge, les Américains
pensaient la mener quinze ans après avoir marché sur la Lune. Mais
nous en sommes encore loin : nous ne disposons toujours pas de la
technologie nécessaire pour y envoyer des humains et les ramener en
vie, afin qu'ils racontent leur périple.
CSV :
Qu'avons-nous à découvrir qui justifie les investissements colossaux
consentis au nom de l'exploration spatiale ?
J.A. :
Si nous parlons d'investissements colossaux, nous devons nous
demander par rapport a quoi. Les missions Apollo ont certes été
couteuses, mais sans doute moins qu'une prolongation de la guerre
froide. Et que ce soit humainement ou financièrement, les conflits
armes sont bien plus onéreux que n'importe quelle mission spatiale.
Maintenant, cote découvertes, l'exploration spatiale s'appuie
aujourd'hui pour l'essentiel sur des robots qui nous envoient des
photos absolument extraordinaires de planètes inaccessibles aux
humains, mais aussi des sons comme le bruit du vent sur Mars, ou
encore des odeurs que personne ne pourra jamais sentir sur Mars en
mettant le nez dehors. Je pense parfois a l'émotion des
scientifiques de la NASA qui ont reçu en 1976 les premières images
de Mars envoyées par la sonde Viking 1 : ils voyaient apparaitre sur
leurs écrans ce qui avait été capté vingt minutes plus tôt ! Il ne
faut pas négliger ce plaisir. Ensuite, explorer un monde inconnu,
c'est nécessairement le comparer avec le nôtre, et s'il est très
différent, nous interroger sur nos origines. Certains astronomes
vous diront que la vie n'est présente que sur Terre, mais d'autres
pensent qu'elle pourrait exister partout dans l'univers. La question
reste ouverte. En définitive, Mars est encore très mal connue et
l'espace demeure pour l'essentiel inconnu. Au risque de me répéter,
l'exploration est une brique essentielle de notre humanité.
CSV :
Dans l'un de vos derniers livres, vous évoquez Gérard O'Neill et ses
projets de colonies spatiales. Peut-on dire qu'Elon Musk, Jeff Bezos
et autres acteurs du NewSpace en sont les héritiers ?
J.A. :
À strictement parler, Jeff Bezos est son héritier direct, car il fut
son élève et a travaillé sur ses projets.
Aujourd'hui, quand il évoque des colonies spatiales, c'est une
référence claire aux grandes cités orbitales d'O'Neill. Bezos pense
comme lui que l'espace constitue le futur de l'humanité, et il va
même plus loin en proposant d'installer les activités polluantes
dans l'espace et ainsi de préserver la Terre. Elon Musk s'inscrit
lui aussi dans l'idée que l'espèce humaine doit être
interplanétaire. Mais il se distingue de Bezos en considérant qu'il
est plus facile de s'installer a la surface d'une planète, en
l'occurrence Mars, que de créer de toutes pièces une station
orbitale. Sur ce point, il faut rappeler qu'en 1969, O'Neill avait
présenté ces deux options à ses étudiants de Princeton : leur
préférence allait à la station orbitale et il a retenu cette
orientation. Evidemment, ces projets de colonisation de l'espace
inquiètent aujourd'hui bon nombre de scientifiques. Parce que le
jour ou des humains débarqueront sur Mars sans précautions, ils
risquent de contaminer la planète avec des bactéries et
d'hypothéquer les recherches sur la présence passée ou actuelle
d'une vie martienne.
CSV :
La montée en puissance de ces acteurs privés appelle-t-elle une
refonte du droit spatial ou une simple mise à jour ?
J.A. :
Le droit spatial a été élabore a la fin des années 1960, a une
époque ou les acteurs étaient encore peu nombreux (seulement
quelques nations) et le privé quasi absent. Avec le traité de
l'espace (1967) ont été posés d'importants principes : la
non-appropriation, le libre accès, la responsabilité des États,
l'interdiction d'armes à destruction massive. L'accord sur la Lune
(1979), qui propose de déclarer les corps célestes patrimoine commun
de l'humanité, n'a en revanche qu'un faible nombre de signataires.
Avec le NewSpace, la communauté des juristes du spatial - qui compte
à présent une foule de doctorants et de jeunes diplômés - a du
reprendre la réflexion afin de proposer une nouvelle gouvernance. Il
y a beaucoup a faire, car il ne s'agit pas seulement d'écrire des
textes, mais aussi de réfléchir à leur mise en uvre.
Il faut
bien sur prendre en compte l'arrivée de nouveaux acteurs désormais
incontournables, comme SpaceX qui possède la grande majorité des
satellites en orbite terrestre. Les intérêts de ces acteurs ne sont
pas ceux des États : comment le droit peut-il aider a la
cohabitation entre public et prive, sans renier ses principes
fondamentaux ? A ce propos, il ne faudrait pas voir les acteurs du NewSpace comme d'horribles hors-la-loi : ils sont capables de
développer des technologies innovantes - par exemple dans le
contrôle de leurs satellites et le risque de collision - qui leur
permettent de respecter la loi aussi bien, voire mieux que les
acteurs historiques !
CSV :
Finalement, voyez-vous la colonisation spatiale comme un horizon
crédible, ou comme une illusion techno politique ?
J.A. :
Dire que la colonisation de l'espace n'aura jamais lieu serait une
idiotie, mais en donner une date précise le serait tout autant. Si
j'ai qualifie les colonies spatiales d'ultime utopie dans l'un de
mes livres, ce n'est pas par hasard : ces projets ont beaucoup a
nous dire sur nos rêves et nos cauchemars. Il n'y a qu'a lire les
auteurs de science-fiction pour se faire une idée de ce que cela
implique aux niveaux technique, juridique ou social. Pour les
humains que nous sommes, ce serait synonyme de contraintes
extrêmement fortes que nous avons oubliées ou n'avons même jamais
connues. Ceux qui envisagent d'installer des colonies sur la Lune ou
sur Mars ont-ils conscience de la vie qu'ils nous promettent ?
L'astrobiologies britannique Charles Cockell a proposé à des détenus
d'imaginer quelle y serait la vie. Non sans raison. Car sur Mars,
même l'air serait compté (il faudrait des millénaires avant de
pouvoir le produire par terraformation), ce qui signifierait une vie
sous contrôle total, donc moins de liberté et plus de tyrannie. Il
faut aussi se demander qui irait là-bas et quel serait le statut de
ces colons vis-a-vis des Terriens. C'est l'occasion d'interroger
notre humanité, l'image que nous en avons.
D'autant plus que certains envisagent de recourir au transhumais,
donc de modifier notre nature humaine ...
CSV :
Vos réflexions éthiques ont-elles concrètement influence
l'orientation des projets du Centre National d'Études Spatiales ?
J.A. :
Honnêtement, non, je n'ai aucun exemple concret. Plusieurs éléments
me permettent toutefois d'envisager l'avenir de l'éthique spatiale
avec optimisme. Quand j'ai commence ma carrière, au départ, le
milieu spatial s'intéressait peu à l'éthique. Puis le public et les
journalistes ont soutenu cette initiative. Et pendant des années, le
CNES a été sollicite pour parler d'autre chose que de technique ou
de beaux lancements. Sans conseiller éthique, le CNES aurait-il été
différent ? Probablement pas ! Toutefois, il y a deux ans, un comité
d'éthique a été installé au CNES. Il témoigne de l'exigence, a la
fois externe et interne, de continuer a mener ce travail
d'interrogation et de réflexion qui doit impérativement accompagner
la préparation et la réalisation de nos programmes spatiaux.
Aujourd'hui, soyons clairs, le domaine spatial traverse une période
extrêmement difficile, chaotique. Notre collaboration avec la Russie
s'est brutalement arrêtée : celle avec les États-Unis est mise en
cause, jusque dans les relations entre chercheurs : il semble que
tout doive être reconsidère, reconstruit. Pourtant, au sein du CNES
et au-delà, je n'ai jamais été autant interrogé par les jeunes
générations. Elles cherchent des repères dans un monde spatial
déboussolé, entre les projets pharaoniques de Musk et les nombreuses
publications qui les remettent en question - à l'instar des travaux
du philosophe anglais Tony Milligan, des sociologues Mary-Jane
Rubenstein et Arnaud Saint- Martin. Et le défi est de faire en sorte
que le milieu des acteurs profite de celui des chercheurs et
réciproquement.
|
 
Hors Série n°322
Science & Vie -
Novembre 2025
|
 |
Yann Ferguson, docteur
en sociologie à l'Inria et directeur scientifique de LaborlA,
programme d'étude de
l'impact de I'TA sur l'emploi et le travail.
Antonin Bergeaud,
professeur d'économie à HEC Paris, spécialiste de la croissance et
de la productivité
PAR RIVA BRINET-
SPIESSER
|
|
"La
créativité est la compétence la plus challengée"
L'essor
de l'intelligence artificielle va révolutionner la quasi-totalité de
nos métiers.
Comment
s'adapter ?
PAR
RIVA BRINET- SPIESSER
Réponses par Yann Ferguson, sociologue, et Antonin Bergeaud,
économiste.
Ce qui
va changer, ce ne sont pas tant les métiers que la manière dont nous
allons travailler
Une
étude de l'OCDE estime que les trois métiers les plus menacés par
l'IA sont les directeurs généraux, les managers et les ingénieurs
SVHS :
Qu'est-ce qui va changer dans notre manière retravailler ?
Y.F. :
L'IA générative demande d'abord d'élaborer une requête (un prompt).
Il faut
ensuite interpréter la pertinence du résultat puis demander à la
machine de réduire ses erreurs.
Alors
qu'avant nous étions producteurs de notre travail, nous en devenons
maintenant éditeurs.
Nous
nous préoccupons moins de l'objet de notre travail que de superviser
le travail de la machine elle- même.
Cela
pose encore une fois la question de l'intérêt d'un tel travail.
Cela
demande aussi beaucoup d'efforts cognitifs pour déjouer les
hallucinations de la machine, ces affirmations qui semblent
confiantes, mais qui sont en réalité fausses.
Or,
nous ne sommes pas habitués à de tels efforts, nous préférons aller
vite, surtout quand la machine nous a permis de réaliser 80% du
travail sans le moindre effort.
|
Serge Tisseron, psychiatre et docteur
en psychologie, université Paris Cité.
Amélie Cordier, ingénieure, docteure
en IA et fondatrice de Graine d'IA, université Claude-Bernard
Lyon-1.
Maryline Perenet, entrepreneure,
experte en neurosciences appliquées et transformation cognitive.
PAR ARMELLE CAMELIN
|
|
Nos
pensées sont-elles manipulées ?
Une
étude IRM montre une baisse d'activation du cortex préfrontal dors
latéral, zone-clé de la planification et de la prise de décision,
lorsqu'un utilisateur s'appuie sur ChatGPT
Nous
avons fabrique des outils plus puissants que notre capacité a en
comprendre les limites. C'est une forme de "chaos ontologique" : une
sorte d'espèce alien, venue de nous-mêmes, et pourtant étrangère
Que se
passe-t-il lorsque nous bavardons avec une IA conversationnelle ?
Transforme-t-elle notre esprit ? Les réponses de Serge Tisseron,
psychiatre, Amélie Cordier, ingénieure, et Maryline Perenet,
entrepreneure.
PAR
ARMELLE CAMELIN
SVHS
: Que provoque, dans notre esprit, l'utilisation d'une IA
conversationnelle comme ChatGPT ou Gemini ?
Serge
Tisseron : Une très grande confusion ! Quand vous utilisez une
intelligence artificielle conversationnelle, vous êtes invité a
interagir avec elle exactement comme avec un humain.
Vous
adhérez à ce qu'elle vous propose pour pouvoir lui répondre. Si elle
évoque des émotions, vous serez tenté de répondre sur le même
registre. Pour dialoguer efficacement avec une IA, il faut lui
prêter des intentions et estimer qu'elle est capable d'une forme de
sentience - comme si elle ressentait quelque chose. C'est une
illusion nécessaire pour interagir ... et en même temps, il est
crucial de se rappeler qu'il s'agit d'une machine qui n'a aucune
émotion. Et pas n'importe quelle machine : une machine programmée
par des humains, qui peuvent avoir des intérêts, commerciaux ou
idéologiques. Nous devons donc maintenir ces trois attitudes
mentales quand nous l'utilisons et c'est extrêmement problématique.
Maryline Perenet : L'être humain est neurologiquement câblé pour
attribuer des intentions à ce qui lui parle. C'est un mécanisme
évolutif : dès qu'une interface a un visage, une voix ou une
fluidité langagière, notre cerveau l'interprète comme un "autre"
potentiel. Cette anthropomorphisation est quasi inévitable, surtout
avec des IA conversationnelles.
Cela
biaise notre rapport : plus l'IA paraît humaine, plus notre
vigilance diminue. On observe un effet de "bulle sociale" :
l'utilisateur se détend, s'ouvre, devient plus suggestible. D'ou
l'importance d'éduquer a la dissociation émotionnelle : ce n'est pas
un sujet, c'est un algorithme.
Amélie
Cordier : Pour moi, I'IA ne fait rien a notre cerveau en tant que
tel. C'est un outil. Ce sont nos usages qui ont un impact. Si vous
abordez ChatGPT sans comprendre comment il fonctionne, vous risquez
de tomber dans le panneau.
La
majorité des problèmes qu'on observe vient d'une absence d'éducation
au fonctionnement même de ces IA. On les utilise comme si elles
étaient infaillibles alors que ce sont des modèles probabilistes
biaisés. Ce qui me frappe, c'est à quel point les gens ne se
demandent ni qui a conçu l'outil qu'ils utilisent, ni pour quoi
faire, ni avec quelle intentionnalité.
SVHS
: Quels effets observe-t-on sur notre cerveau en cas d'usage répété
d'IA génératives ?
M.P. :
L'usage régulier d'une IA générative induit ce que les neurosciences
appellent une forme d'externalisation cognitive. En d'autres termes,
nous déléguons certaines fonctions mentales - formulation, mémoire
de travail, exploration sémantique - a un outil externe. L'étude IRM
publiée en 2024 par le MIT Media Lab. ("Your Brain on ChatGPT :
Accumulation of Cognitive Debt when Using an Al Assistant for Essay
Writing Task") montre une baisse d'activation du cortex préfrontal
dorsolatéral, zone-clé de la planification et de la prise de
décision, lorsqu'un utilisateur s'appuie sur ChatGPT pour résoudre
un problème complexe. À l'inverse, le réseau du mode par défaut,
associé à la rêverie et à la pensée associative, est davantage
mobilisé, ce qui suggère une posture mentale plus contemplative,
voire passive. Cela change la façon dont le cerveau travaille, sans
forcément l'appauvrir - mais cela le reconfigure.
L'IA
devient une sorte de présence. Ce n'est évidemment pas un vrai lien,
mais c'est perçu comme tel.
Elle
comble un vide
A.C .:
On n'a pas assez de recul scientifique pour conclure à des
transformations durables. On en est encore au stade des intuitions.
Mais il y a un signal faible : à force de déléguer des tâches
cognitives à l'IA, on finit par moins faire travailler son cerveau.
C'est comme arrêter le sport, certaines fonctions peuvent
s'atrophier. Il y a aussi une dimension sociale : aujourd'hui, l'IA
est perçue comme un passage obligé. Beaucoup se sentent forcés de
l'utiliser, sans formation. Résultat : des usages mal maîtrisés, qui
peuvent renforcer la dépendance.
S. T .:
Le principal danger, c'est de renoncer à réfléchir par soi-même.
Cela débute avec le fait de renoncer à accueillir en soi les
émotions contradictoires qui nous habitent face à une question
complexe, d'où va, peu à peu, émerger notre jugement. C'est une
forme de désafférentation, on laisse de côté les émotions, on
cherche la réponse immédiate. On ne rencontre plus d'hésitation. Or
c'est justement dans l'hésitation que se développe notre
raisonnement. Quand tout devient trop fluide, trop facile, on perd
l'habitude du doute, de la contradiction, de l'effort.
On
commence par gagner du temps ... et on finit par perdre du jugement.
SVHS
: Notre esprit critique est-il mis en sommeil ?
M.P. :
C'est ce que les psychologues appellent le biais d'automatisation.
Il s'agit d'un raccourci cognitif : "Si c'est généré par une
machine, c'est probablement juste." Ce biais est renforcé par notre
histoire collective avec les outils numériques. Or, ChatGPT ne
raisonne pas, il fait des statistiques. Ses réponses peuvent être
fausses avec un ton parfaitement assuré. Le paradoxe, c'est que plus
une IA est fluide, plus elle gagne notre confiance ... même quand
elle se trompe.
A.C .:
Nous avons été éduques a faire confiance aux machines. Une
calculatrice ne se trompe jamais. Alors quand une IA générative
donne une réponse bien tournée, on lui attribue une forme
d'autorité. C'est là que réside l'enjeu d'acculturation : comprendre
ce qu'est cette IA, comment elle fonctionne, et pourquoi elle
produit cette réponse.
S.T. :
Les utilisateurs, parfois très cultivés, n'osent pas contredire
l'IA. Par exemple, lorsqu'elle donne manifestement une mauvaise
réponse, ils n'osent pas lui demander pourquoi, comme s'ils étaient
en face d'un professeur, d'un expert ... ou même d'un parent qu'ils
auraient peur de fâcher. On observe une forme de soumission molle.
C'est inquiétant. D'autant que l'IA ne dit jamais "je ne sais pas",
elle ne s'arrête jamais de donner des réponses, et toujours avec la
même assurance. C'est extrêmement déroutant. On est face a une forme
de brouillard cognitif.
SVHS
: L'IA vient-elle combler une forme de solitude sociale ?
S.T. :
L'IA conversationnelle arrive a un moment-clé. Nous sommes dans une
époque ou les liens sociaux sont de plus en plus distendus. Beaucoup
de gens souffrent d'un manque d'écoute, même dans leur entourage
proche. Dans ce contexte, une IA qui répond tout de suite, qui ne
juge pas, qui ne se fatigue jamais devient une sorte de présence. Ce
n'est évidemment pas un vrai lien, mais c'est perçu comme tel. Elle
comble un vide.
A.C .:
Ces outils sont conçus pour maximiser l'engagement. Le ton, le
style, le tutoiement, tout est étudié pour créer un lien émotionnel.
Ce n'est pas un hasard : l'interface est conçue pour capter notre
attention. Et cela répond à un modèle économique très clair, fonde
sur le temps passe par l'utilisateur. Plus vous restez, plus l'outil
atteint son objectif. Pour cela, il s'appuie sur tout ce que l'on
sait en sciences cognitives : nos biais de confirmation, notre
besoin d'appartenance, notre envie d'être compris.
M.P .:
C'est frappant de constater la vitesse avec laquelle l'IA s'installe
dans nos processus mentaux, dans le monde professionnel et dans le
monde intime. Beaucoup d'utilisateurs parlent à ChatGPT comme à un
coach, un psy ou un journal de bord. Cette tendance au compagnonnage
mental me fascine autant qu'elle m'inquiète : elle révèle une
solitude cognitive, une recherche de réassurance permanente. Mais
elle ouvre aussi une piste : et si l'IA devenait un levier
d'autoréflexion, a condition d'être utilisée consciemment ?
SVHS
:L'IA pourrait-elle remplacer des humains ?
S.T. :
Beaucoup de gens se servent de l'IA comme d'un psy. Ils lui confient
leurs émotions, leurs souvenirs, leurs peurs. Elle devient un
réceptacle de leur intimité, avec cette particularité : elle ne
contredit pas. Mais elle n'interprète pas non plus. Elle ne peut pas
relancer le sujet de manière pertinente, mais elle l'invite toujours
à se confier davantage. Ce n'est pas un usage qui soigne, mais un
usage qui soulage. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant.
SVHS
: Que révèle notre fascination pour des IA omniscientes,
infaillibles ... voire divines ?
A.C. :
Nous avons fabriqué des outils plus puissants que notre capacité à
en comprendre les limites. Ce que constate un chercheur américain,
c'est une forme de "chaos ontologique" : on ne sait pas dans quelle
case ranger ces systèmes. Ils parlent comme nous, mais ne vivent
pas. Ils semblent nous comprendre, mais ne ressentent rien. Ce sont
des boîtes qu'on ne sait pas où ranger. Une sorte d'espèce alien,
venue de nous-mêmes, et pourtant étrangère.
S.T .:
L'IA est en train de devenir une sorte de nouvelle figure divine.
Elle est omniprésente, omnisciente - en apparence - et omnipotente
dans certains domaines. Certains y trouvent un refuge, d'autres la
redoutent. Mais dans tous les cas, elle arrive à un moment où nos
repères s'effondrent, où la mémoire collective se délite, où les
liens sociaux se fragilisent. L'IA vient offrir une illusion de
maîtrise nouvelle sur nos vies. Mais elle révèle surtout nos
carences, et sans une éducation à ses usages et à ses pièges, elle
risque de les aggraver.
Serge
Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, université Paris
Cité.
Amélie
Cordier, ingénieure, docteure en IA et fondatrice de Graine d'IA,
université Claude-Bernard Lyon-1.
Maryline Perenet, entrepreneure, experte en neurosciences appliquées
et transformation cognitive.
|
 
Lise Barnéoud
Science & Vie 1298 -
Novembre 2025
|
|

Repenser
l'immunité |
 
par LISE GOUGIS
Science & Vie 1296 -
septembre 2025
|
|
Rythmes scolaires : On a tout faux
L'organisation du temps scolaire est-elle adaptée aux
besoins des élèves ?
Non, répondent de nombreux spécialistes.
Vacances trop longues pour certains, mauvaise
répartition hebdomadaire et quotidienne des heures travaillées ...
Le débat a été rouvert à l'occasion de la récente Convention
citoyenne.
Par Lise GOUGIS
LES 3 CHIFFRES A RETENIR
24
C'est le nombre d'heures de cours hebdomadaires dans
les écoles primaires françaises, le plus souvent réparties sur 4
jours, soit 6 heures par jour, contre 21 heures en moyenne dans
l'OCDE, généralement réparties sur 5 jours (un peu plus de 4 heures
par jour).
12 667 500
C'était, en 2023, le nombre d'élèves en France. Parmi
eux, on en recensait notamment 6 339 900 en primaire, 3 404 800 au
collège et 2 251 800 au lycée. Ils étaient encadrés par environ 866
500 professeurs.
87%:
C'est le pourcentage des communes qui ont fait le
choix de revenir a la semaine de 4 jours suite au décret de 2017.
Seules quelques villes (Paris, Toulouse, Nantes, Lille ... ) ont
conservé un rythme sur 4,5 jours.
SOURCES : OCDE - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE -
VIE PUBLIQUE
Le premier bulletin de notes de l'année est tombé, et
il est gratiné ...
L'élève en question ? Le ministère de l'Éducation
nationale, via les équipes qui s'y sont récemment succède. Le sujet
?
Les rythmes scolaires imposés aux jeunes Français.
Les profs qui notent la copie ? Les experts en
chronobiologie et chrono-psychologie de l'enfant.
Les résultats ? Vacances : passable. Semaines : tout
faux. Journées : à revoir.
Bref, le travail rendu ne mérite pas même les
encouragements.
Ce corrigé ne surprend personne - à part, peut-être,
les notés eux-mêmes. En mai dernier, dans son tout premier rapport
consacre a l'enseignement primaire (de la petite section de
maternelle a la sixième), la Cour des comptes pointait déjà la
nécessaire refonte des rythmes scolaires, "en décalage avec les
besoins des élèves".
Car ces derniers en sont les principales victimes :
lors du dernier test Pisa (Programme international pour le suivi des
acquis des élèves) de 2022, piloté par l'OCDE et destiné à évaluer
le niveau des collégiens de 15 ans dans 85 pays, les jeunes Français
se sont classes 23e en mathématiques, 28e en lecture et 26e en
sciences - des résultats médiocres.
8 SEMAINES DE CONGES INTERMEDIAIRES
Et selon les experts, il ne suffira pas d'un petit
tour de passe- passe pour redresser la barre, le problème serait
profond.
"Les rythmes entiers ont été pensés au bénéfice des
lobbies du tourismes des familles les plus aisées, qui ont les
moyens d'occuper les enfants le mercredi, de partir en week-end et
en vacances, considère Agnès Florin, considère Agnès Florin,
professeure en psychologie de l'éducation à Nantes université,
présidente du Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco).
Alors que l'on sait très bien, d'un point de vue scientifique, quels
sont les rythmes adaptés aux besoins et aux possibilités des enfants
en fonction de leur âge." Quel est l'emploi du temps idéal, selon la
science ?
Commençons par évacuer le rythme a l'année, et donc
la question des vacances - le seul sujet qui ne fait pas consensus.
Si nos élèves bénéficient de vacances d'été plutôt courtes (voir S&V
n°1293, p.40), ils cumulent en revanche 8 semaines de congés
intermédiaires, contre 5 en moyenne dans les 38 pays de l'OCDE.
"Nous sommes le seul pays à en avoir autant, avec
quatre fois deux semaines dans l'année", souligne Claire Leconte,
professeure émérite de psychologie de l'éducation a l'université de
Lille 3. C'est trop, estime-t-elle : "Les vacances de la Toussaint,
notamment, arrivent vite âpres la rentrée, on n'aurait pas besoin de
deux semaines".
"Un rythme d'environ sept semaines de cours suivies
de deux semaines de vacances, c'est l'idéal, rétorque René Clarisse,
maître de conférences émérite en psychologie a l'université de
Tours. Il faut prés d'une semaine pour se désynchroniser du rythme
de l'école, et autant pour se remettre dedans." En réalité, dans ce
domaine, un seul ajustement fait l'unanimité : modifier les congés
de Noël. "On pourrait les rallonger d'une semaine. C'est une période
de vulnérabilité, avec beaucoup de déplacements, ce ne sont pas des
vacances reposantes", décrit René Clarisse. "Ou pourquoi pas les
faire débuter toujours a la même date, le 23 décembre, comme le font
beaucoup de pays, renchérit Claire Leconte. De cette manière, ca ne
fluctue pas tous les ans et on évite que les enfants fassent parfois
leur rentrée le 2 janvier, ce qui est une aberration."
Des efforts sont a faire dans le domaine des
vacances, donc, mais nous ne sommes pas totalement hors sujet. Cela
semble par contre être le cas en termes de temps consacre a
l'enseignement. Car les petits Français ont beau avoir plus de
congés que leurs camarades de l'OCDE, ils passent plus de temps
qu'eux sur les bancs de l'école : en primaire, ils suivent environ
864 heures de cours par an, contre 805 heures en moyenne pour les
pays membres de l'organisation intergouvernementale ! Au collège,
l'écart reste identique : 968 heures ici, contre 916 ailleurs.
Que font-ils durant ces dizaines d'heures en plus ?
Ils planchent sur les matières dites fondamentales : 59 % du temps
scolaire entre le CP et le CM2 est dédié à la compréhension de
l'écrit (38 %) et aux mathématiques (21 %), alors que dans les pays
de l'OCDE, la moyenne se situe autour de 40 %. Pendant le reste du
collège puis au lycée, les fondamentaux n'occupent plus que 30 % du
temps environ, pour laisser plus de place aux autres matières. Ce
qui reste légèrement supérieur à la moyenne des États membres (27
%), et ce, malgré la baisse de 18 % du nombre d'heures de math au
lycée suite a la reforme de 2018, qui a remplace les filières
traditionnelles par un système de spécialités mis en place à la
rentrée 2019.
JOURNEES TROP DENSES
Sauf que, on le voit, avoir plus d'heures de cours
n'est pas gage de résultats ... La preuve, les petits Coréens et
Finlandais, qui passent moins de temps en classe que la moyenne des
élèves de l'OCDE, obtiennent de meilleurs scores aux évaluations
Pisa. Alors certes, dans ces pays, l'école ne représente qu'une
partie du temps d'apprentissage total.
"En Corée, par exemple, des cours particuliers
réguliers et nombreux complètent l'enseignement formel", pointe un
rapport de l'organisme publié en juin dernier.
Mais surtout, quantité n'est pas synonyme de qualité.
"Consacrer plus de temps à l'étude des mathématiques ne signifie pas
nécessairement que l'on comprendra mieux ou que l'on obtiendra de
meilleurs résultats, si les méthodes d'enseignement ne sont pas
efficaces ou si les ressources pédagogiques sont insuffisantes",
souligne ce même rapport.
Les méthodes d'enseignement seraient-elles alors a
blâmer ? Pas si sur : un professeur peut bien donner le meilleur
cours de mathématiques au monde, si la classe n'est pas réceptive,
cela ne sert a rien. Or, en France, quand il s'agit de repartir les
heures sur une semaine, c'est bien simple : "On a tout faux!"
s'insurge Agnès Florin. Le problème, d'après elle ? La semaine de 4
jours, adoptée par la grande majorité des écoles françaises depuis
qu'en 2017, Jean-Michel Blanque, alors ministre de l'Education
nationale, a laisse le choix aux communes. "Nous sommes le seul pays
de l'OCDE à avoir une telle organisation hebdomadaire", regrette la
professeure.
La conséquence de cette réforme, c'est que les heures
de cours se sont concentrées sur des journées plus longues, plus
denses ... et les capacités attentionnelles des élèves ne suivent
plus. "On fait de l'apprentissage condense", assène René Clarisse.
En 2014, le chercheur et son équipe ont comparé l'impact des
semaines de 4 jours et de celles de 4 jours et demi sur des
écoliers, qui se sont révélés davantage attentifs dans le second
cas. "Du point de vue des rythmes, plus il y a de régularité tous
les jours de la semaine, mieux c'est pour le développement et les
apprentissages formels comme la lecture et les maths, car cela
favorise les répétitions quotidiennes", note Stéphanie Mazza,
professeure de neuropsychologie à l'université de Lyon 1.
TRAVAILLER LE SAMEDI
Voila aussi pourquoi il est préférable de suivre des
cours le samedi matin plutôt que le mercredi. "Nos travaux révèlent
que les élèves qui travaillent le mercredi matin sont moins
concentrés le lundi, car ils sont désynchronisés par le week-end de
deux jours", expose René Clarisse. Mieux pour alléger encore les
journées et maintenir une régularité dans les apprentissages, une
semaine de 5 jours composée seulement de longues matinées serait
l'idéal. C'est le choix fait par la plupart des communes de
Polynésie française depuis 2023, en concertation avec les parents et
les enseignants.
Des vacances pensées pour être vraiment reposantes,
des semaines allongées pour que les élèves restent concentrés ... Et
sur une journée alors ? La encore, la copie française est bourrée
d'erreurs. D'abord, elle ne respecte pas les rythmes biologiques des
élèves, et ce, dès leur plus jeune âge. En maternelle, "des écoles
décident de supprimer la sieste des la moyenne section, alors que
certains enfants en ont encore besoin jusqu'à 6 ans", prévient
Stéphanie Mazza . Chez les 3-6 ans, la capacité d'attention est
maximale en début de matinée, elle baisse avant midi puis repart
l'après- midi, ont montre les études. Mais d'autant mieux s'ils ont
fait la sieste, estime la spécialiste : "S'ils restent éveilles, ils
ne seront pas en mesure d'apprendre quoi que ce soit".
DÉCALAGE BIOLOGIQUE
C'est seulement à partir du CP que les capacités
d'attention des enfants se rapprochent de celles des adultes : elles
montent au fur et à mesure de la matinée, diminuent à partir de
midi, puis repartent dans l'après-midi. Avec une particularité
lorsque l'âge ingrat pointe le bout de son nez.
"La puberté entraîne un décalage de l'horloge
biologique, c'est-à-dire que les ados vont devenir couche-tard, car
ils ressentent la fatigue plus tard le soir, souligne Stéphanie
Mazza. En les faisant lever toujours aussi tôt, on les met en dette
de sommeil chronique, ce qui a des répercussions a la fois sur leur
sante physique et mentale, leurs performances cognitive set
académiques. Surtout, on s'imagine que si l'on décale l'heure de
début des cours, les adolescents vont se coucher plus tard, mais ce
n'est pas le cas." Exagère, ce besoin de grasse matinée pour les
ados ? Loin de là : dans une étude menée avec le soutien du Conseil
scientifique de l'Education nationale et publiée en mai dernier,
Stéphanie Mazza a suivi quatre classes d'un internat en
Seine-et-Marne : deux ont maintenu un début des cours à 8 h, deux
autres ont testé un démarrage a 9 h après les vacances de la
Toussaint, sans pour autant terminer plus tard.
En mars, et alors que les élèves qui pointaient à 8 h
étaient toujours en dette de sommeil, un tiers de ceux du groupe de
9 h annonçaient dormir plus de 8 heures par nuit. Avec d'importantes
répercussions : ils étaient moins sujets à la somnolence, a
l'anxiété ... et ils obtenaient de meilleurs résultats aux tests
cognitifs auxquels les chercheurs les soumettaient.
"Les élèves sont plus concentrés s'ils ont leur quota
de sommeil, cela leur donne un cadre temporel plus propice aux
apprentissages. De la même manière, bien dormir est essentiel pour
consolider ce que l'on a appris dans la journée", explique la
neuropsychologue, qui espère que la mesure sera généralisée. Elle
est en tout cas devenue la norme dans le Colorado, aux Etats-Unis,
où des expérimentations similaires ont été menées.
CHARGE COGNITIVE
Reste maintenant à placer les matières dites
fondamentales, comme le français et les maths [et les sciences !
ndlr], dans cet emploi du temps.
Faudrait-il leur réserver les créneaux où nos
capacités d'attention atteignent leur pic ? "C'est plus compliqué
que cela, nuance Rene Clarisse. Si le français et les maths
mobilisent une charge cognitive importante, c'est également le cas
de l'éducation physique et sportive : il faut réfléchir a qui faire
une passe dans un sport collectif, par exemple." Et dans cette
matière, l'inattention peut mener à des blessures.
Ainsi, à partir du CP, l'idéal serait d'éviter de
placer des tâches cognitivement exigeantes en début de matinée.
"On pourrait faire des révisions pour commencer la
journée puis monter en charge peu à peu", poursuit le spécialiste.
Sans oublier les pauses.
'Nos études ont montre qu'instaurer deux breaks dans
la matinée, en faisant une activité ludique, par exemple, permet de
relancer l'attention. Sans pause, la concentration va être a son top
pendant une trentaine de minutes avant de vite retomber. C'est bien
pour cela que les contrôleurs aériens en font souvent ... ", glisse
René Clarisse.
Pour le spécialiste, une pause méridienne d'une heure
et demie, voire deux heures, serait également nécessaire, étant
donné que c'est le créneau ou l'attention chute. "Il faut aussi
éviter de faire du sport entre 13 h et 15 h, car c'est à ce moment
de la journée que l'on observe le plus d'accidents", ajoute-t-il. Et
reprendre les activités plus exigeantes cognitivement en milieu
d'après-midi, lorsque l'attention repart.
ART PLASTIQUE, MUSIQUE
Pour autant, l'idée n'est pas non plus de saturer
toutes ces périodes propices à l'apprentissage des maths et du
français.
"Il faut les intercaler avec de l'art plastique, de
la musique, de la découverte du monde, de manière que les écoliers
puissent relâcher la pression, souligne Claire Leconte. Dans les
écoles lilloises ou l'on a expérimente ce rythme, les enfants
étaient beaucoup plus concentrés".
Voilà donc le corrigé dont le ministère de
l'Éducation nationale ferait bien de s'inspirer. Bien entendu, il ne
suffirait pas de l'appliquer à la lettre pour propulser nos élèves
sur le podium du Pisa ... Nos voisins allemands, qui ont fait le
choix d'une organisation en cinq longues matinées pouvant s'étendre
de 7 h 30 à 13 h 30 - une solution en apparence vertueuse -,
affichent des résultats à peine meilleurs que les nôtres : alors que
nous sommes 23e en mathématiques, 28e en lecture et 26e en sciences,
ils sont respectivement 22e, 24e et 19e.
"Le problème auquel nous faisons face est
multifactoriel, observe Agnès Florin. Les rythmes scolaires sont un
facteur parmi une quinzaine d'autres, dont les classes surchargées,
puisque cela laisse moins de temps aux enseignants pour interagir
avec chaque enfant, en particulier avec ceux en difficulté."
Parmi les pays de l'UE faisant partie de l'OCDE,
l'Hexagone est en effet celui qui compte le plus d'élèves par classe
à l'école élémentaire (22 contre 19 en moyenne) et au collège (26
contre 21 en moyenne). "Reste que l'organisation du temps scolaire
est un levier important d'amélioration de l'efficacité et de
l'équité des systèmes éducatifs, insiste l'experte.
Or, au sein des membres de l'organisme
intergouvernemental, la France est championne des inégalités
sociales à l'école."
En math, l'écart entre élèves d'origine très
favorisée et très défavorisée est ainsi de 113 points dans
l'Hexagone, contre 93,5 en moyenne dans l'OCDE. "La question que
l'on doit maintenant se poser, c'est quel rythme nous voulons pour
favoriser le développement harmonieux des enfants et faire en sorte
qu'ils aient tous les mêmes chances à l'école ?" conclut Rene
Clarisse. La science, elle, a déjà tranché. À voir si les politiques
lui porteront une écoute attentive - c'est ce qui fait la différence
entre un cancre et un bon élève.
|
 
Charlotte MAUGER
Science & Vie 1295 -
juillet 2025
|
|
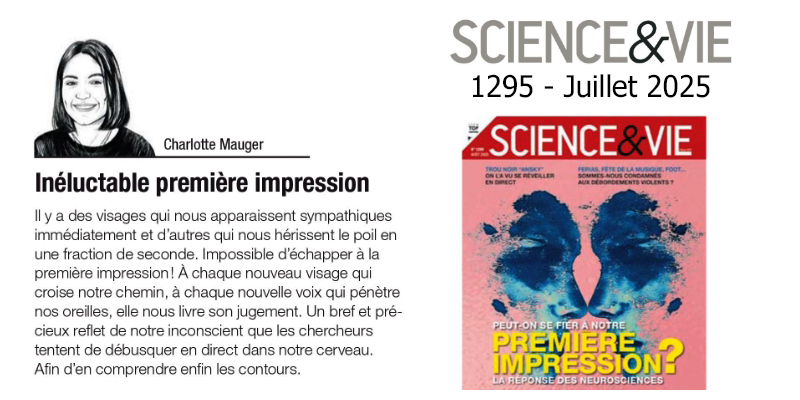
La différence entre la méfiance, la confiance, ou
encore un coup de foudre ?
Un regard
suivi de quelques millisecondes d'influx cérébraux -en bref, une
première impression !
Face à un
visage inconnu, c'est la même rengaine : on scrute, et l'on sait.
Vraiment ?
Car si
nos premières impressions tombent parfois juste, elles sont aussi
bourrées de biais ...
Alors
pour comprendre son fonctionnement, psychologues et
neuroscientifiques traquent son émergence dans le cerveau,
décortiquent son fonctionnement à l'aide des IA, et pistent son
apparition dans l'évolution.
De quoi
les contrôler, ces jugements hâtifs. Et peut-être même ... les
dépasser.
68
Décryptage d'un réflexe cérébral
76 À quel
point peut-on s'y fier?
80 Vers
une nouvelle théorie des premières impressions
|
 
Thomas ALLARD
Science & Vie 1293 -
juin 2025
|
|
Vacances scolaires
Sont-elles trop longues ?
PAR Thomas ALLARD
Le gouvernement français
envisage de lancer une concertation sur le temps scolaire, et
notamment sur les "grandes vacances". Leur longueur serait, pour
certains, source d'inégalités sociales et responsable des mauvais
résultats de notre pays aux fameuses enquêtes Pisa. Un jugement
quelque peu hâtif, si l'on en croit les chiffres. Qu'en disent les
spécialistes?
56%
C'est la part de Français se déclarant
favorables à la réduction des vacances scolaires d'été, selon un
sondage de l'institut Cluster17 en 2023. Dans le groupe de ceux qui
y adhèrent le plus, les 50-64 ans sont davantage représentés.
23e
C'est la place de la France au dernier
classement Pisa (le programme international pour le suivi des acquis
des élèves). Les résultats des élèves de I 'Hexagone sont en baisse
dans toutes les matières par rapport à l'édition 2018.
12
C'est, en millions, le nombre d'élèves
scolarisés en France. Parmi eux, 6,35 millions sont à l'école
primaire, 3,4 au collège et 2,25 au lycée.
21
C'est le nombre de jours de vacances
d'été perdus entre l'année scolaire 1960-1961 (79 jours) et
2023-2024 (58 jours). Les vacances intermédiaires, elles, sont
désormais plus longues de 20 jours.
Trop longues, trop oisives ou encore
trop inégalitaires ! C'est peu dire que les vacances scolaires
d'été, ces deux mois doux qui font encore piaffer d'impatience les
écolières et écoliers qui sommeillent en nous, attisent le débat.
"Les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour
les élèves les plus fragiles", soulignait ainsi la ministre de
l'Éducation nationale Élisabeth Borne, en janvier dernier. Dans la
foulée de cette allocution, la ministre annonçait le lancement d'une
"grande concertation sur le temps scolaire". Avec un horizon: les
vacances d'été 2026, qui pourraient être raccourcies de deux
semaines en fonction des discussions. La mesure est plutôt
populaire: selon un sondage Cluster17 réalise l'an dernier pour
l'hebdomadaire Le Point, 56% des Français verraient d'un bon il de
réduire la durée des vacances d'été.
UNE QUESTION BRÛLANTE
Aurions-nous donc oublie l'enfant en
nous? La question n'est pas la; il s'agit plutôt de savoir si la
mesure aurait un impact réel. "Cela fait près de vingt ans que l'on
se demande s'il faut Franchir le pas", rappelle Eric Charbonnier,
analyste à l'OCDE au sein de la Direction de l'éducation et des
compétences. Les ministres de l'Education Gabriel Attal en 2023,
Vincent Peillon sous le mandat de François Hollande en 2013, ou Luc
Chatel en 2011 s'y sont essayés, sans succès. Il faut dire que
l'enjeu est complexe, pour ne pas dire brulant. "Toucher au
calendrier scolaire implique de modifier les rythmes de travail de
plus de 12 millions d'élèves et de près de 1 million de personnes en
charge de leur scolarité", souligne Georges Fotinos, ancien chargé
de mission d'inspection générale au sein de l'Éducation nationale et
membre de l'Observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants
et des jeunes (ORTEJ). "Mais ce n'est pas tout: cela revient aussi à
remettre en jeu les équilibres de vie et de travail de 17 millions
de parents d'élèves, et à provoquer des changements sur des pans
entiers de l'économie, dont les secteurs du tourisme, des
transports, de la culture et du sport."
SOURCE D'INÉGALITÉS
Bref, toucher vacances scolaires, ce
n'est pas seulement risquer la plus grande grève de lycéens,
collégiens et peut-être même d'élèves du primaire jamais vue! C'est
bousculer la vie de millions de Français. Mieux vaut, donc,
s'assurer qu'une réduction serait efficace avant toute décision ...
Sur les inégalités scolaires d'abord, l'argument phare du
gouvernement et un sujet decisif pour l'Education nationale. Les
deux derniers résultats Pisa, publiés en 2018 et en 2023, montrent
que la France est l'un des pays de l'OCDE ou l'origine
socio-économique des élèves a le plus d'impact sur les résultats
scolaires. En outre, des 2011, les conclusions du rapport de la
Conférence nationale sur les rythmes scolaires pointaient la durée
des vacances d'été comme étant une source d'inégalités. Les
rapporteurs opposaient notamment "les vacances culturelles et les
activités enrichissantes" pour les plus riches à "la vacuité d'un
temps non mobilisé, télévision et ennui" pour les moins aisés ...
"On constate une perte de niveau à des degrés très divers entre les
élèves qui ont bûché sur leurs cahiers de vacances ou participé à
des stages de remise à niveau, et ceux qui sont restes éloignés de
toute préoccupation culturelle et scolaire", acquiesce Georges
Fotinos. Un constat corroboré en 2023 par une large enquête
concernant l'effet des grandes vacances sur le niveau scolaire entre
la fin du CP et l'entrée en CE1, réalisée par le service d'études
statistiques de l'Éducation nationale, la Direction de l'évaluation,
de la prospective et de la performance (DEPP). "Celle-ci montre que
si les différences de niveaux entre élèves issus des réseaux
d'éducation prioritaire et les autres se réduisent au fur et a
mesure de l'année de CP, les vacances d'été contribuent à recreuser
cet écart", détaille Julien Cahon, chercheur en sciences de
l'éducation à l'université de Picardie Jules-Verne.
TROP SIMPLISTE
Le résultat est net: il faut les
raccourcir. Et tant pis pour les jeunes d'aujourd'hui, ils auraient
dû être aussi studieux que nous pour les mériter! Sauf que, bien
entendu, cette conclusion est à relativiser: "C'est trop simpliste
de considérer que la durée des congés est le seul facteur
déterminant, tempère Julien Cahon. Ces vacances ne font qu'accentuer
des inégalités sociales qui sont constatées par ailleurs tout au
long de l'année." En 2017, la DEPP a tache de mesurer les effets
produits par la réorganisation généralisée des rythmes scolaires
depuis la rentrée 2014. Les résultats étaient peu probants:
"L'impact était minime, et largement inférieur aux différences de
réussite liées aux caractéristiques sociales des élèves", souligne
le chercheur. Bref, pour résoudre les problèmes d'inégalités
sociales, cibler les vacances -et seulement elles paraît un peu
léger ... Mais leur durée pourrait par contre expliquer les
résultats souvent décevants de notre pays dans les rapports Pisa,
visant a classer l'efficacité des systèmes d'éducation de nombreux
États ...
PAS SI LONGUES
Las, cette piste semble tout aussi
trompeuse. D'abord parce que les vacances scolaires d'été des élèves
français sont loin d'être extraordinairement longues: "Avec 8
semaines, la France se situe juste en dessous de la moyenne des pays
de l'OCDE, qui est de 9 semaines", indique Éric Charbonnier.
Ensuite, parce qu'aucune corrélation entre durée des vacances et
performances scolaires n'a été avérée jusqu'ici. Le dernier
classement Pisa en est l'illustration: "Le pays européen le mieux
classé, l'Estonie, est aussi celui qui a les vacances les plus
longues, avec 12 semaines en été, constate Julien Cahon. A
l'inverse, les Pays-Bas ont les vacances les plus courtes d'Europe
et des résultats assez similaires à ceux de la France." Difficile,
donc, de mettre sur le dos des vacances d'été les mauvais résultats
des écoliers français ... Les autres congés seraient alors peut-être
à blâmer: notre pays offre un nombre record de semaines de vacances
intermédiaires -8, contre 4 en moyenne dans l'OCDE! Résultat: alors
que les élèves scolarisés dans ces pays disposent en moyenne de 13
semaines de vacances au total dans l'année, les petits Français en
ont 16 ...
BONNES POUR LA SANTÉ
Il est vrai que les périodes de repos se
révèlent essentielles au bien-être des élèves: de plus en plus de
travaux prouvent les bienfaits des congés aussi bien chez les
enfants que chez les adultes. Ils améliorent notamment la qualité du
sommeil et diminuent le stress en abaissant le niveau de cortisol
dans l'organisme -des bénéfices ressentis jusqu'à 4 semaines après
le retour de vacances, ont montre des études. Les congés ont aussi
des effets bénéfiques sur la santé cardio-vasculaire: selon une
enquête américaine réalisée en 2000, prendre des vacances au moins
une fois par an réduit le risque global de décès d'environ 20 %, et
celui de mourir d'une maladie cardiaque de 30%. Reste que si les
petits Français ont bien plus de congés que les autres, ils
devraient par conséquent travailler divan Tage. La démonstration
tiendrait ... s'ils n'étaient pas les élèves de l'OCDE qui passent
le plus de temps en classe! Entre le CP et la 3°, ils y sont 8 192
heures, contre 7 634 heures en moyenne dans tous les Etats membres
de l'organisation. En France, le temps consacre aux apprentissages
fondamentaux est également l'un des plus élevés au monde: "Au total,
59 % du temps scolaire est consacre a de la lecture, de l'écrit, de
la littérature ou des mathématiques, contre 41 % dans le reste de
l'OCDE", souligne Georges Fotinos.
Bref, la durée des vacances est certes
élevée dans notre pays, mais le rythme de travail y est aussi
particulièrement soutenu. Or, tout comme le raccourcissement des
vacances, l'augmentation du rythme scolaire n'est pas gage
d'excellence: les enfants français ont beau être parmi ceux qui
étudient le plus, notre pays se situe au 23e rang du dernier
classement Pisa, loin derrière Singapour, le Japon, la Corée du Sud
et l'Estonie, qui caracolent en tête! "Les performances scolaires ne
sont pas non plus liées au nombre d'heures de cours, observe Éric
Charbonnier. Et les pays où l'on fait le plus de mathématiques ne
sont pas les plus performants dans cette matière."
BÂTIMENTS NON ADAPTÉS
Sans révision en profondeur de la
cadence scolaire, raccourcir les vacances semble donc de plus en
plus malavisé ... D'autant que dans le contexte de réchauffement
climatique actuel, la mesure pourrait engendrer d'autres problèmes !
"Les salles de classe surchauffent à la période estivale, précise
Julien Cahon. L'état du bâti scolaire n'est pas du tout adapté pour
faire cours durant ces périodes où les fortes chaleurs et les
canicules seront de plus en plus fréquentes."
Dans les pays du sud de l'Europe, les
vacances d'été sont d'ailleurs bien plus longues qu'en France: les
élèves espagnols disposent de 11 semaines, les italiens de 12
semaines et les portugais de 13 semaines. "Même les employés
profitent de rythmes allégés et d'horaires décalés, détaille Éric
Charbonnier. Ces mesures sont généralisées dans toute la société au
sein de ces pays-là, car la chaleur est un vrai problème."
AMÉLIORER LEUR QUALITÉ
Alors, que faire? En réalité, plutôt que
raccourcir les vacances d'été, les experts recommandent d'en
améliorer la qualité. "Il serait intéressant de développer davantage
es vacances collectives sur des thèmes sportifs et culturels",
souffle Georges Fotinos. "Les associations d'éducation populaire,
les collectivise locales et les municipalités ont pendant longtemps
financé des séjours à prix abordable et des colonies de vacances
afin de réduire les inégalités, rappelle Julien Cahon. Mais on
observe depuis quelques décennies un désengagement politique sur ces
questions, ce qui a eu pour effet d'écarter progressivement les
enfants des classes moyennes et des classes populaires de cet accès
aux vacances collectives," Pour remédier à cela, l'ancien ministre
de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a lancé, en 2020, les
Colos apprenantes. Leur principe: permettre aux jeunes issus des
familles les plus modestes de participer à des séjours en grande
partie financés par l'État, et durant lesquels des activités
culturelles, sportives et écologiques sont proposées aux enfants.
Près de 300 000 jeunes y ont participé entre 2020 et 2023. "C'est
une excellente idée, mais étant donné que ces dispositifs coutent
beaucoup d'argent, ils restent encore peu développés", déplore Éric
Charbonnier.
PROBLÈMES D'EFFECTIFS
Enfin, pour réellement remédier aux
inégalités scolaires et améliorer le niveau global, d'autres moyens
seraient plus efficaces que deux semaines de bonheur juvénile en
moins ... "La France figure dans le top 10 des pays de l'OCDE où les
classes sont les plus chargées. L'un des principaux leviers est donc
la question de la taille des classes, indique Julien Cahon. Les
effectifs réduits sont souvent bénéfiques, car cela permet aux
enseignants de se concentrer davantage sur les besoins de chaque
élève." Reviennent également souvent dans les discussions les
programmes scolaires, la pédagogie et la formation des enseignants
comme axes d'améliorations. Enfin, les rythmes biologiques des
enfants nécessiteraient aussi d'être mieux pris en considération:
"Les études montrent que chez les enfants âgés de 3 à 7 ans, il
existe un optimum de concentration le matin, rapporte Éric
Charbonnier. Pour les adolescents, par contre, on va observer un pic
de concentration le matin, puis un deuxième en milieu d'après-midi."
Ces différents éléments seront-ils pris en compte par les
parlementaires dans la grande concertation à venir sur le temps
scolaire? Et pourquoi pas -s'ils ont pu se relaxer et de ressourcer
leur esprit pendant de longues et bonnes vacances ...
---------
L'économie du tourisme tremble
Les réformes du calendrier scolaire ne
touchent pas que les élèves et leurs parents: le secteur
touristique, qui représente 3,6% du PIB français, est lui aussi
directement impacté ! Et il fait entendre sa voix: nul doute qu'il
mettra son véto si le gouvernement cherche à couper dans les congés
d'été. "Une réduction des vacances d'été conduirait à une baisse de
fréquentation des lieux touristiques, et donc à un manque à gagner
pour le secteur", souligne Julien Cahon. Une solution serait de
"découper" les académies en trois zones de congés d'été distinctes,
ce qui permettrait de mobiliser les équipements touristiques aussi
longtemps qu'actuellement. Avec un peu moins de monde sur les
plages?
-------
GEORGES FOTINOS Ancien chargé de mission
d'inspection générale à l'Éducation nationale
Il serait intéressant de développer
davantage les vacances collectives sur des thèmes sportifs et
culturels
|
 
Amour, colère, burn
out... au crible de la science
Science & Vie
HS 314
|
|
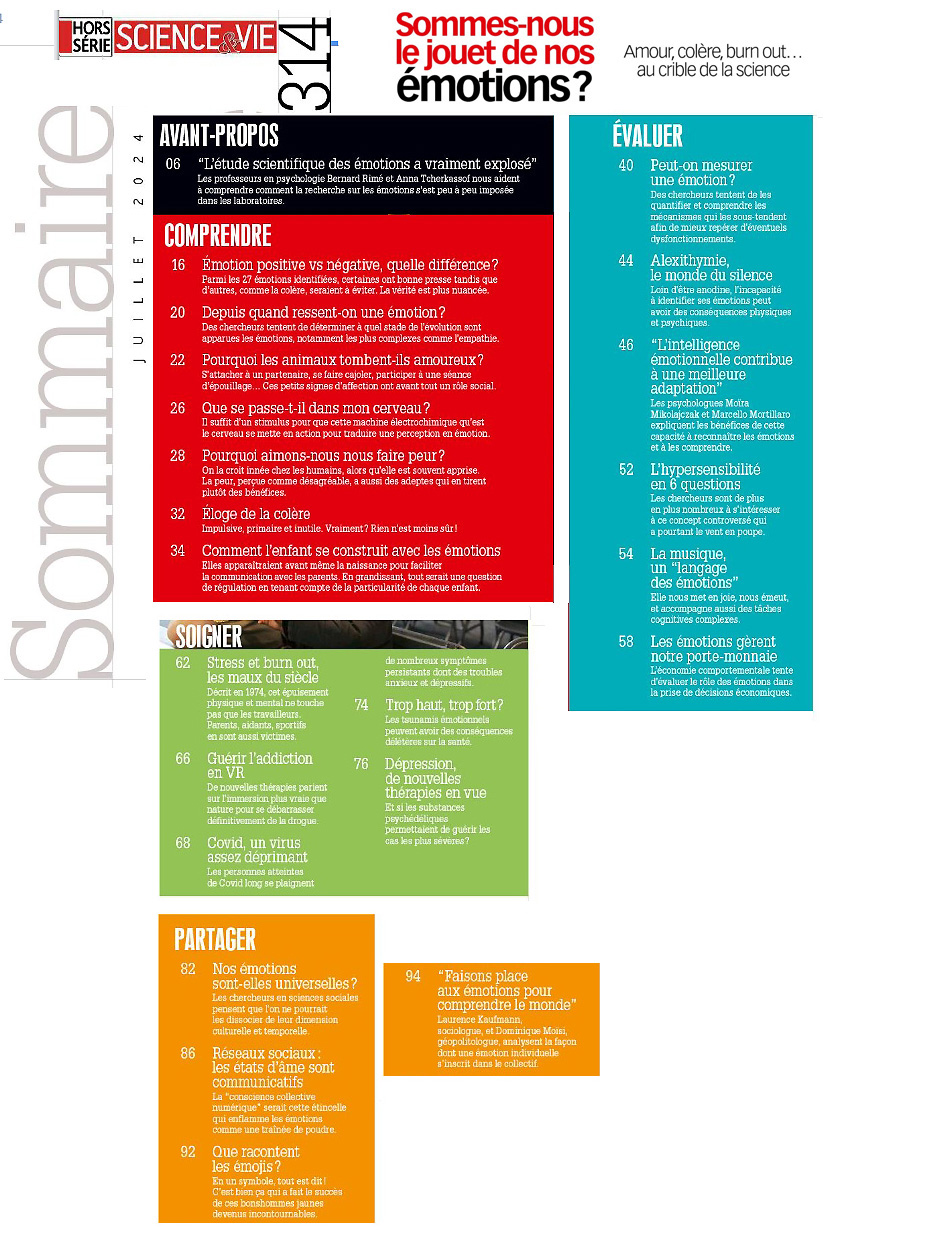
Comment l'enfant se construit avec les émotions
Présentes
dès la grossesse, les émotions sont le nerf de l'apprentissage.
L'enfant
doit apprendre à les accueillir et à les réguler.
PAR
OLIVIER DESCAMPS
Les
émotions ne sont pas un bruit dans le système, elles
alimentent les processus cognitifs de manière vertueuse
Certains débats
pédagogiques ne cessent de faire rage.
D'un côté, les tenants d'un
apprentissage basé sur les savoirs.
De l'autre, les adeptes
d'une éducation centrée sur les attentes et les besoins des élèves.
D'un point de vue scientifique, ce clivage semble caricatural, car
il n'existe pas de distinction entre les cerveaux émotionnel et
cognitif. Même s'ils le souhaitaient, enseignants et élèves ne
seraient pas capables de laisser leurs émotions au vestiaire.
Tant
mieux, d'ailleurs, car il faut s'en servir.
"Les émotions ne sont
pas un bruit dans le système, insiste Édouard Gentaz, professeur de
psychologie du développement à l'université de Genève. Au contraire,
elles alimentent les processus cognitifs de manière vertueuse."
Sans s'en rendre compte,
les parents appliquent ce principe des le plus jeune âge de leur
enfant. Personne n'aurait l'idée d'expliquer à un bébé que, pour
marcher, il doit soulever le pied droit, se pencher vers l'avant,
trouver un équilibre ... Avec des sourires et des propos rassurants,
on l'encourage. On prend acte du fait que le plaisir de réussir est
la base de l'apprentissage.
Et ça commence très tôt
... peut-être même avant la naissance !
En 2022, des chercheurs du
département de psychologie de l'université de Durham, en
Grande-Bretagne, ont enregistré via une échographie 4D les
expressions faciales de 100 ftus après que leurs mères ont mangé
soit de la carotte, soit du choukale. Résultat : les bébés qui
avaient "dégusté" la carotte affichaient un large sou- rire, là où
ceux qui avaient reçu le chou kalé montraient un visage triste.
LES
MIMIQUES DU FTUS
Déjà en 2011, ce même
laboratoire avait relevé, grâce à des caméras à ultrasons, les
mouvements des muscles faciaux de deux ftus. Dans leur étude,
publiée dans la revue Plos One, les chercheurs ont montré
l'évolution des expressions faciales au cours de la grossesse,
notamment entre le 24° et la 36° semaine de gestation : peur,
tristesse, sourire ... qui entraineraient bébé, in utero, à
communiquer à la naissance.
Directeur du laboratoire
de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant (LaPsyDE,
Sorbonne Université), Grégoire Borst regrette que, l'enfant
grandissant, la confiance dans les émotions s'étiole et qu'à
l'école, notation et sanction finissent par prendre le dessus.
Bien entendu, il ne faut
pas mettre l'élève dans une situation où il ne se trompe jamais, car
les erreurs sont formatrices. Ce reproche est souvent adressé à
l'éducation positive qui fait de la compréhension des émotions et de
la bienveillance les moteurs de l'apprentissage. Celle-ci est
notamment accusée d'être une fabrique à enfants égocentriques et
sans limites. Une critique un peu injuste, estime le chercheur, car
elle ne cherche pas à comprendre les nuances qu'apportent les
tenants de ce concept : "L'erreur ne doit pas être stigmatisée. On
doit proposer à chaque enfant une sécurité émotionnelle lui permet-
tant d'essayer. L'enseignement, ce n'est pas du dressage",
insiste-t-il.
À l'école comme à la
maison, parents et enseignants doivent trouver l'équilibre. Jongler
entre des émotions comme la joie d'apprendre ou de faire plaisir, le
regret et le soulagement, la curiosité ... Le tout "en tenant compte
de la particularité des enfants qui ressentent tous des émotions
différentes", recommande Edouard Gentaz. S'il est important
d'apprendre a réguler, voire a filtrer ce que l'on ressent, plus
question d'enfouir ses sentiments, comme l'ont trop longtemps
recommandé les pédagogies traditionnelles. Les éducateurs doivent au
contraire aider les enfants à accepter leurs émotions pour se
construire. Faute de quoi ils risquent de ne pas être prêts quand
elles débordent et génèrent ce que la pédiatre Catherine Gueguen
appelle une "tempête émotionnelle".
MANGER
POUR OUBLIER
L'intolérance à ses
propres émotions, cela peut rendre malade. C'est, par exemple, l'une
des causes des troubles du comportement alimentaire (TCA) qui
touchent notamment les jeunes filles. Au-delà des prédispositions
génétiques et des facteurs socioculturels, la recherche a mis en
évidence qu'une per- sonne obese ou en surpoids peut manger pour
oublier des émotions qui la dépassent. "Comme ce moyen de défense
est très efficace, la personne a tendance à l'utiliser pour des
événements de moins en moins importants, et développe une
addiction", décrit Gérard Apfeldorfer, psychiatre et président
d'honneur du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids
(Gros). Dans ce cas, se focaliser sur le seul comportement
alimentaire, sans tenir compte de la problématique émotionnelle est
contre- productif. Ainsi un régime finit-il le plus souvent ... par
faire grossir, explique le médecin, "pour des raisons purement
biologiques". Dans le système sanguin, en effet, la perte de poids
génère une période d'euphorie. La rai- son ? La production de corps
cétoniques, des substrats énergétiques alternatifs qui apportent de
l'énergie au cerveau. Quand le jeune s'arrête, le TCA refait
surface, surtout s'il est amplifie par un sentiment d'échec ou des
discours culpabilisants. A contrario, une thérapie comportementale
peut "aider à vivre avec ses émotions négatives, sans chercher à les
fuir. Car si on lutte contre, on les empêche de disparaître". "
A
ladolescence, les émotions emportent tout !
L'adolescence est une
période turbulente, durant laquelle tout change: explosion du
système cognitif, éveil à la sexualité, ouverture sur le monde. La
grande difficulté, pour l'adolescent, est de faire face aux bouffées
d'émotions qui résultent de cet environnement mouvant. "Le système
limbique qui les traite finit son développement vers 10-12 ans,
tandis que le cortex préfrontal qui régule les fonctions
émotionnelles se développe jusqu'à 20-25 ans, décrit le professeur
Gregoire Borst.
Cela crée un décalage.
Avant 12ans, on peut estimer que l'on a un équilibre.
Après 20-25 ans, on en a
un autre.
Entre les deux, c'est
plus compliqué". Comme aux autres âges de la vie, un mécanisme
d'habituation se met en place, qui permet d'apprivoiser les émotions
que l'on a déjà rencontrées, mais cette régulation peut prendre du
temps. "En particulier si l'adolescent n'a pas eu, dès le plus jeune
âge, des parents (ou d'autres personnes qui l'ont éduqué) pour le
protéger", dixit Lauriane Vulliez Pédopsychlatre et professeure au
CHU de Besançon, celle-ci se réfère à la théorie de l'attachement,
formalisée aux États-Unis dans les années 1960, et qui montre qu'un
enfant se construit durant les périodes de détresse en s'appuyant
sur les réponses d'un adulte auquel il s'attache. Les ados capables
de vivre cette période de crise sans trop de dommage sont ceux qui
ont appris, grâce à ces "figures tutélaires", à se laisser traverser
par leurs émotions, a les exprimer et à les réguler. "Cela ne les
empêche pas d'entrer en conflit avec leurs parents, mais ils savent
aussi quils peuvent s'appuyer sur eux", insiste-t-elle.
OLIVIER DESCAMPS
---------------
LES SOFT SKILLS
PEUVENT-ELLES S'APPRENDRE ?
Héloïse
Rambert
Dans 1000 écoles
maternelles et primaires, depuis janvier dernier, des petits
Français reçoivent des cours d'empathie. Le dispositif est appelé à
se généraliser à la rentrée prochaine.
But affiché du
gouvernement: sacraliser à l'école un "temps où l'on apprend à
respecter les différences de l'autre" et "une culture de
l'apaisement quand il y a des conflits", notamment pour lutter
contre le harcèlement scolaire.
L'empathie est ce qu'on
appelle une soft skill -"compétence douce" ou compétence
psychosociale en bon français. "La liste de ces compétences est
longue", souligne Solenne Bocquillon-Le Goaziou, entrepreneuse,
conférencière, autrice de Préparez aujourd'hui vos enfants au monde
de demain et attachée au laboratoire de psychologie du développement
et de l'éducation de l'enfant du CNRS.
"On distingue les
compétences cognitives, qui incluent par exemple la confiance en
soi, l'esprit critique et la persévérance. Les compétences
émotionnelles, comme l'accueil des émotions et la résilience. Et
enfin, les compétences relationnelles, qui permettent de collaborer
et résoudre les conflits avec les autres." Le terme "Ife skills",
parfois utilisé, résume bien l'utilité de ce bagage: il permet de
vivre avec soi et avec les autres.
Les soft skills sont
particulièrement recherchées en entreprise, où les hard skills-comprendre
les diplômes et les compétences pures et dures, techniques et
acquises-ne suffisent plus. "Avec l'arrivée de l'intelligence
artificielle, ces savoir-faire connaissent l'obsolescence de plus en
plus rapidement", souligne Nelly Magré, psychologue du travail,
consultante en ressources humaines et autrice des Softskills pour
les nuls. "Des compétences comme la créativité, qui permet
d'alimenter 11A, ou l'esprit critique, pour prendre du recul sur ce
qu'elle produit, vont être de plus en plus intéressantes."
Utiles, voire
indispensables, les soft skills s'apprennent-elles? "La littérature
scientifique montre que plus tôt on les cultive, meilleure est
l'insertion", affirme Solenne Bocquillon-Le Goaziou. Quel que soit
l'âge, un travail d'introspection -aidé ou non par des professeurs
ou des outils numériques-, du bon sens et une mise en pratique en se
focalisant sur ses points forts permettent de développer ses soft
skills.
Encore faut-il en avoir
vraiment envie. "Apprendre à devenir empathique, si on n'a pas
sincèrement envie de s'intéresser aux autres, sera difficile",
estime Nelly Magré.
Héloïse
Rambert
---------------
Stress
et burn out, les maux du siècle
Épuisement
professionnel, parental, étudiant ...
Sommes-nous
entrés dans "l'âge de l'anxiété" ?
Les
"émotions positives" peuvent-elles nous protéger?
PAR KHEIRA
BETTAYEB
Le stress
correspond à une réaction physiologique tout à fait naturelle et
utile ... quand il est ponctuel
Somatisation, difficultés a se concentrer, cynisme, perte de
l'estime de soi ... le burn out survient après une exposition
répétée et prolongée à des facteurs stressants.
Décrit pour la première
fois en 1974, le burn out ("se consumer" en anglais) fait
aujourd'hui un triste carton.
C'est l'un des exemples les
plus emblématiques des maux liés à des émotions négatives.
"Epuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un
investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes
sur le plan émotionnel" : voilà comment la Haute Autorité de santé
(HAS) le définit. Dit aussi syndrome d'épuisement professionnel, car
décrit pour la première fois dans le milieu du travail, ce trouble
est désormais connu pour toucher également les parents, les
étudiants et les sportifs. Mais, bonne nouvelle : "la gestion des
affects négatifs et les émotions positives peuvent nous en
protéger", assure Patrick Légeron, psychiatre à l'hôpital
Sainte-Anne de Paris et coauteur d'un rapport de l'Académie de
médecine sur le burn out, paru en 2016.
Dans le détail, il se
caractérise par "un épuisement complet à la fois du corps et du
psychisme, une perte des émotions allant jusqu'à l'indifférence et
au cynisme ainsi qu'un sentiment de non- réalisation de soi
accompagné d'une baisse de l'estime de soi", développe le médecin.
Il survient après une exposition répétée et prolongée à des facteurs
stressants, comme une charge de travail jugée insurmontable, de
mauvaises relations avec des collègues ou son manager, un manque
d'autonomie ou une perte de sens dans son activité.
"Le stress, lui, correspond
à une réaction physiologique tout à fait naturelle et utile ...
quand il est ponctuel", souligne le médecin.
À distinguer de l'anxiété
et de l'angoisse-respectivement, une peur diffuse et une
manifestation d'un malaise. "Le stress induit la libération de
diverses hormones (adrénaline, cortisol ... ) qui augmentent les
fréquences cardiaque et respiratoire, le niveau de vigilance et le
taux de sucre sanguin ; ce qui permet de mobiliser nos ressources
pour réaliser une tâche, ou combattre ou fuir un danger, précise
Patrick Legeron. En revanche, s'il devient permanent, le stress est
néfaste : submergé en permanence d'hormones 'activatrices', le corps
entre alors dans une phase d'épuise- ment. Si celle-ci persiste
pendant plusieurs mois, c'est le burn out."
LONG ET
DIFFICILE A TRAITER
En 2017, les conclusions du
rapport de la mission d'information relative au syndrome
d'épuisement professionnel déposé à l'Assemblée nationale notaient
la complexité de ce syndrome difficile à cerner au niveau biologique
avec, néanmoins, des anomalies fonctionnelles au niveau du système
immunitaire et une physiopathologie qui "s'apparente à celle de la
dépression ou du syndrome de stress post-traumatique", note le
rapport. Selon une étude de 2022, menée par Opinion Way, pas moins
de 34% des salariés français seraient concernés, dont 13% seraient
en burn out "sévère". Les plus exposes sont les moins de 29 ans, à
59% (+5% comparé à 2021) ; les femmes, à 46% (-1,5%) ; les
télétravailleurs, à 45% (+5%) ; et les managers, à 43% (+10%).
Concernant le burn out parental, en 2022, une étude de l'Ifop a
révélé que 45% des mères françaises s'estimaient concernées ...
Les causes du récent boom
de ce trouble ?
"Cela pourrait s'expliquer
notamment par plusieurs mutations importantes survenues ces
dernières années, qui ont rendu notre quotidien plus stressant : le
phénomène d'hyper connexion à internet, responsable d'une charge
cognitive permanente ; l'anxiété liée a la crise environnementale et
au contexte économique et géopolitique actuel (guerres, inflation
... ); ou encore le recul dans nos sociétés de divers facteurs
autrefois protecteurs contre le stress, telle la solidarité entre
humains, l'empathie, l'entraide dans les familles, etc.", répond
Patrick Légeron.
Une fois installe, le burn
out est long et difficile à traiter : "plusieurs études montrent
qu'il faut en moyenne un arrêt du travail durant deux ans,
potentiellement combiné à des antidépresseurs et des thérapies
comportementales et cognitives pour apprendre à se protéger du
surmenage émotionnel et augmenter l'estime de soi", précise le
psychiatre.
Le mieux est donc de le
prévenir. Règle n°1 : adopter un mode de vie protecteur contre le
stress (exercice régulier, bien dormir, relaxation ... ). Règle n° 2
: au bureau, à l'usine, construire des environnements qui ne le
favorisent pas - "mais ce n'est pas une priorité dans le monde du
travail", déplore le médecin. Une autre arme peut aider : les
émotions positives. "Les travaux en psychologie positive nous ont
appris que les émotions positives sont extrêmement protectrices
vis-à-vis du stress. Il faut donc les cultiver." Comment,
concrètement ?
"En se
remémorant chaque soir des souvenirs positifs pour ne pas se
focaliser sur les événements négatifs de la journée. Et en
pratiquant des activités qui favorisent la survenue d'affects
positifs (sorties entre amis, hobbies, etc.)", propose Patrick
Légeron.
Rien de très
difficile en soi. Le tout est d'y penser avant l'épuisement. "
KHEIRA
BETTAYEB
---------------
LES
EMOTIONS GÈRENT NOTRE PORTE-MONNAIE
Lorsqu'il est question d'argent, nos décisions sont loin d'être
rationnelles. La peur, la colère, l'envie ou la joie jouent un rôle
fondamental, comme le montre l'économie comportementale.
PAR
GABRIELLE TROTTMANN
Vu que les émotions ont
longtemps été perçues comme des éléments perturbateurs : on
considérait qu'il fallait les éliminer pour prendre de bonnes
décisions ... ", rappelle Marie-Claire Villeval, directrice du
groupe d'analyse et de théorie économique Lyon-Saint-Étienne (Gate-Lab).
La réalité est plus complexe, comme le démontre l'économie
comportementale. L'objectif de cette science à part ?
Évaluer le rôle des
émotions (culpabilité, joie, empathie ... ) lors des prises de
décisions économiques.
De quoi mettre à mal le mythe de l'Homo economicus, selon lequel nous tenterions de maximiser notre profit
de façon rationnelle en toutes circonstances. Chaque année, des
dizaines d'expériences sont réalisées par la quinzaine de chercheurs
et de doctorants du Gate-Lab. Ceux-ci proposent à des volontaires de
participer à des jeux qui les confrontent à divers choix. Leurs
émotions sont passées au crible de différents appareils : des
bracelets pour mesurer les pulsations cardiaques, des oculomètres
pour savoir ce qui retient le plus longtemps leur regard, etc.
Voici, par exemple, une énigme que les chercheurs ont récemment
tente de résoudre : prêter serment, comme le font certains banquiers
aux Pays-Bas et en Belgique, rend-il plus honnête? Réponse : "Oui,
car le sentiment de culpabilité et la peur d'être jugé retiennent
les participants de rompre leur promesse", explique MarieClaire
Villeval (les premiers résultats de cette étude sont en phase de
prépublication).
Autre découverte
intéressante : quand les cours de la Bourse évoluent de façon
inattendue, les investisseurs qui subissent des pertes prennent
davantage de risques que ceux qui observent les dégâts de
l'extérieur. En cause, la colère et la peur, qui se répandent de
manière contagieuse, selon une autre étude publiée en septembre 2023
dans The Economic Journal.
LE "JEU
DE L'ULTIMATUM"
L'économie
comportementale doit beaucoup à l'essor de la psychologie et des
neurosciences. Voici un demi-siècle, elle est popularisée par une
célèbre expérience : "le jeu de l'ultimatum". Principe : un premier
joueur se voit proposer une somme d'argent, à partager avec un
second joueur. Il doit décider quelle part il conserve et quelle
part il donne à l'autre. Celui-ci peut alors accepter ou refuser le
deal, mais dans ce dernier cas, aucun des deux joueurs ne reçoit
d'argent.
Or, cette expérience
démontre que l'on préfère généralement ne rien gagner, plutôt que
d'accepter une répartition inégale des richesses, surtout si elle
est en notre défaveur ... Le sentiment d'injustice serait donc plus
fort que l'appât du gain. Une idée pas si révolutionnaire : les
premiers économistes, en effet, jugeaient utile d'étudier nos états
d'âme. Dès le XVIII* siècle, l'économiste écossais Adam Smith a
écrit une Théorie des sentiments moraux qui souligne le rôle
fondamental de l'empathie dans la définition des intérêts
individuels. Et dans le futur? "L'intelligence artificielle ouvre
des champs de recherche prometteurs pour l'économie
comportementale", poursuit Marie-Claire Villeval.
"Avec le développement
rapide de l'IA dans tous les domaines, nos choix en matière de
consommation et d'investissement seront de plus en plus délégués aux
machines. Quel contrôle garderons-nous sur ces choix?
Apprendrons-nous a
mieux discerner les fausses images ou, au contraire, serons nous de
plus en plus fragiles face au risque de désinformation sur les
réseaux? Car les émotions restent fondamentales, conclut la
chercheuse, même face aux robots."
GABRIELLE TROTTMANN
---------------
La
musique, un "langage des émotions"
Elle a
le pouvoir de nous émouvoir ou de nous égayer, mais cette propriété
sert bien d'autres fonctions, notamment cognitives.
MATHIAS
CHAILLOT
Quelques notes, et
c'est parti: la jambe s'agite, les souvenirs remontent et, parfois,
les émotions nous écoute musicale déclenche une symphonie
électrochimique dans notre cerveau. Pour commencer, elle stimule,
dans le lobe temporal (dédié à la perception et à la mémoire), le
cortex auditif primaire pour les sons simples, puis le cortex
auditif secondaire, qui traite le rythme et l'harmonie. La partie
émotionnelle s'active plus vite que les fonctions cognitives : la
synchronisation cérébrale peut se produire en 250 millisecondes. "La
musique est capable de nous faire voyager de manière très efficace
dans un espace émotionnel, via ses expédients musicaux", explique
Laura Ferreri, maîtresse de conférence en psychologie cognitive à
l'université Lumière-Lyon II. "Un mode majeur et un tempo rapide
auront une valence plus positive qu'un mode mineur et un tempo lent.
Cela permet à la
musique non seulement de transmettre une émotion, mais aussi de
l'induire." Une musique jugée agréable active le circuit de la
récompense, impliquant le striatum ventral, le mésencéphale,
l'amygdale, l'aire orbito frontale droite et le cortex préfrontal
ventro médian. La dopamine est alors libérée dans le noyau accumbens
: plus elle est diffusée, plus l'on ressent le "frisson musical".
Laura Ferreri et ses collègues ont d'ailleurs démontré, dans une
étude publiée en 2019 dans Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS), que l'inhibition de la dopamine empêche d'éprouver
du plaisir à l'écoute de la musique, et qu'à l'inverse,
l'administration d'un précurseur de la dopamine augmente son effet.
En 2016, le chercheur Matthew Sachs, de l'université de Californie
du Sud, cosignait un article dans le journal Social Cognitive and
Affective Neuroscience, où il rendait compte des résultats obtenus
dans une enquête menée auprès de 237 personnes, pour évaluer les
réactions émotionnelles (y compris les frissons) à la musique.
Il a ainsi remarqué que
les personnes qui ressentent le plus d'émotions musicales ont un
nombre accru de fibres reliant les aires sensorielles au cortex
préfrontal, région de la gestion des émotions. Et, selon le type
d'émotion véhiculée, l'activité évolue : une musique angoissante
activera plus spécifiquement l'amygdale-qui contrôle les sentiments
de peur et d'anxiété-, tandis qu'une musique dissonante stimulera le
gyrus temporal supérieur. L'anticipation joue un rôle primordial.
Comme avec le langage, la structure musicale nous amène à anticiper
les prochaines notes; un processus géré par le cortex auditif et le
lobe frontal, connectes au système limbique. Lorsque les prédictions
sont confirmées, la dopamine est relâchée. Une résolution
inattendue, mais plaisante, entraînera une libération encore plus
importante du neurotransmetteur.
ANCRAGE
ANCESTRAL
La musique ne se
contente pas de nous émouvoir : elle accompagne des taches
cognitives complexes. En renforçant les connexions synaptiques, la
dopamine favorise la potentialisation a long terme dans
l'hippocampe. "Plus il y a de dopamine en circulation, plus grande
est cette force synaptique, meilleure est la mémoire, rappelle Laura
Ferreri. L'amygdale, connectée à l'hippocampe, permet aussi de mieux
mémoriser des épisodes d'une forte valence émotionnelle. En modulant
les émotions, la musique impacte donc les mécanismes de
mémorisation." Un morceau peut ainsi réveiller des souvenirs très
anciens, même chez des patients aux facultés cognitives dégradées,
comme des malades d'Alzheimer, témoignant du puissant lien entre
musique, émotions et mémoire.
Ecouter et produire de la musique est
une caractéristique humaine depuis sans doute des milliers d'années.
"Un des premiers ancêtres de l'homme a probablement utilisé pour la
première fois sa voix pour produire de véritables cadences
musicales, c'est-à-dire pour chanter", pensait déjà Charles Darwin
en 1871.
Cet ancrage ancestral pourrait expliquer pourquoi le ftus
réagit à la musique avant la naissance. "Du point de vue évolutif,
elle joue un rôle-clé dans la prise en charge des nourrissons, en
modulant leurs émotions de façon plus efficace que le langage. Sans
parler de son impact social sur la cohésion d'un groupe", précise la
chercheuse en psychologie cognitive. D'ou le fait qu'un chant
collectif ou une chorale agit plus activement sur la libération
d'endorphines, apaisantes, et sur la baisse du taux de cortisol, lié
au stress.
Les travaux de l'unité des neurosciences cognitives et
affectives de l'université de Zurich, publiés dans PNAS en février
dernier, ont également démontré qu'une musique provoque plus
d'émotions lorsqu'elle est interprétée en direct par un musicien
soucieux de s'adapter à son public. Des volontaires ont écoute une
série de morceaux, sans savoir s'il s'agissait d'un enregistrement
ou d'une version live.
Un pianiste observait leur activité
cérébrale, captée par IRM, et faisait évoluer son jeu en
conséquence. Résultat : l'activité émotionnelle dans l'amygdale
était alors plus intense.
Les morceaux live stimulaient aussi un
échange d'informations dans tout le cerveau, témoignant d'un
traitement émotionnel et cognitif plus profond. La musique est donc
bien un "langage des émotions", mais pas seulement : elle favorise
également de nombreuses fonctions cérébrales et peut, après nous
avoir émus, nous aider à penser et à agir.
MATHIAS
CHAILLOT
---------------
Dépression - De nouvelles thérapies en vue
Avec elle, l'émotion vire au noir ! La dépression est
aussi commune qu'ardue à comprendre et soigner.
Kétamine, psychédéliques,
stimulation magnétique ... de nouvelles thérapies se développent.
PAR FRANÇOIS MALLORDY
Entrée dans le vocabulaire médical et courant depuis le XIXe siècle,
la dépression n'est pas un coup de barre auto- diagnostique !
Aujourd'hui, l'épisode dépressif caractérisé (EDC) est un trouble
mental évalué sur la base de critères précis inscrits depuis 2013
dans le DSM-5, la dernière édition du Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux. En 2021, en France, 12,5 % des
18-85 ans auraient vécu un EDC au cours des 12 derniers mois - une
proportion en augmentation depuis 2010. "Dans un EDC, un patient
doit remplir au moins cinq des neuf critères diagnostiques présents
dans le DSM-5 sur une même période de 2 semaines, un des symptômes
étant une tristesse ou une perte d'intérêt de manière intense et
prolongée. Ces symptômes doivent avoir un retentissement important
sur l'individu d'un point de vue social, professionnel ou
personnel", résume Philippe Fossati, professeur des universités,
chef du service de psychiatrie adulte à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière (Paris) et directeur de l'équipe de recherche
"contrôle cognitif -interception- attention" a l'Institut du cerveau
et de la moelle épinière (ICM).
En
premier traitement d'un EDC, les recommandations actuelles
conseillent différents médicaments antidépresseurs, notamment les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), les
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
(IRSNa), les imipraminiques et les inhibiteurs de monoamine-oxydase.
Malgré des modes d'action différents, tous régulent l'humeur en
agissant au niveau des synapses- ces zones de contact entre deux
neurones. Et pas n'importe lesquelles: les synapses mono-
aminergiques, où les neurones communiquent par des monoamines, une
famille de molécules comprenant la sérotonine et la noradrénaline.
Certains spécialistes considèrent qu'une activité anormale de ces
médiateurs chimiques, et notamment de la sérotonine, cause la
dépression : c'est l'hypothèse monoaminergique. Toutefois, cette
dernière est aujourd'hui remise en cause, et les effets
antidépresseurs des médicaments "standards" restent mal compris. Ils
apparaissent après plusieurs semaines, avec une proportion
importante d'échecs : de 40% à 70% des patients ne répondent pas au
premier traitement, et de 10% à 30% des patients présentent une
dépression résistante à plusieurs traitements. Pour ceux chez qui
les médicaments traditionnels ne suffisent plus, de nouvelles
options apparaissent en recherche et en clinique. Au premier rang
des espoirs figurent ... d'authentiques drogues, les
psychédéliques-des substances hallucinogènes-et la ketamine ! De
plus en plus d'essais cliniques indiquent que ces molécules peuvent
agir de manière rapide et durable contre l'EDC. Ainsi, une étude
publiée dans la prestigieuse revue médicale The New England Journal
of Médicine (NEJM), en octobre 2023, a conclu à l'efficacité
supérieure contre la dépression résistante, par rapport à la
médication recommandée, d'un spray nasal à l'esketamine- forme
particulière de la ketamine- en association avec un ISRS ou un IRSNa.
"DĖCROÛTER"
LA PERCEPTION NEGATIVE DE SOI
Psilocybine (principe actif des "champignons magiques"), LSD,
ayahuasca ... Par rapport à la kétamine, les psychédéliques sont
moins avances en thérapie -ils ne sont pas encore déployés dans les
cliniques en France, en raison des précautions vis a-vis du "trip"
hallucinatoire de quelques heures qu'ils provoquent. Mais c'est
précisément cette expérience qui produirait des effets
thérapeutiques: "Les psychédéliques entrainent un bouleversement
aigu du réseau du mode par défaut, un ensemble de régions cérébrales
qui intervient dans la conscience de ses propres états mentaux et
qui est hyper connecté chez les personnes déprimées", détaille
Philippe Fossati. En reconfigurant ce réseau par l'augmentation de
sa connexion à d'autres zones cérébrales, les psychédéliques
pourraient "décrouter" la perception négative de soi des personnes
déprimées. Après un premier grand essai concluant pour la
psilocybine contre la dépression résistante publié dans NEJM en
novembre 2022, des essais internationaux ont commencé en 2023.
Plusieurs hôpitaux français, dont la Pitié-Salpêtrière, le service
hôpital- universitaire de Sainte-Anne (Paris) et le CHU de Nîmes se
joindront prochainement à ces études en proposant un accompagnement
spécifique des patients -une dose unique, répétée ultérieurement,
sera administrée dans une salle à l'hôpital sous la surveillance de
professionnels de la santé mentale, tandis que les patients seront
suivis en psychothérapie. "Cela illustre que différents types de
traitements, ici un médicament et une psychothérapie, peuvent être
associés pour perfectionner la prise en charge", remarque Philippe
Fossati.
Des
approches non médicamenteuses dans le traitement de l'EDC
s'améliorent aussi, comme la stimulation magnétique transcrânienne
répétée (rTMS). Celle-ci consiste à envoyer des impulsions
magnétiques sur certaines régions du cortex cérébral pour en
modifier l'activité neuronale. "Le problème de la rTMS actuelle,
c'est comment, quand et où stimuler pour observer des effets
thérapeutiques", constate Philippe Fossati. Depuis 2021, un nouveau
protocole dit "de Stanford" réveille la discipline. Ce dernier
entraîne un taux de réponse et de rémission de l'EDC beaucoup plus
important que les précédents, ravivant les espoirs placés dans la
rTMS. Enfin, l'arrivée du numérique en santé mentale pourrait
optimiser le soin et améliorer la détection des rechutes, "à
condition que l'intelligence artificielle ne s'immisce pas dans la
relation avec le patient au point que l'on ne voie plus le malade,
ce qui est nécessaire en psychiatrie", prévient Philippe Fossati.
Lance en 2019 par une start-up de l'ICM, ViK Dépression propose par
exemple un compagnon virtuel pour aider les patients dépressifs à
suivre leur traitement. En attendant la démocratisation de ces
nouveaux traitements et outils, la recherche continue, avec toujours
plus de pistes explicatives de la dépression : "L'inflammation dans
le cerveau pourrait jouer un rôle important dans la dépression, de
même qu'une dysrégulation du métabolisme, ou à un degré moindre le
microbiote intestinal", énumère Philippe Fossati. Des hypothèses qui
s'accompagnent d'idées thérapeutiques originales, avec plusieurs
essais cliniques évaluant des anti-inflammatoires ou des
probiotiques dans le traitement de l'EDC ... sans résultats notables
pour l'instant.
La
stimulation magnétique transcranienne répétée (rTMS) est utilisée au
centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital
Ambroise-Pare, a Boulogne-Billancourt. En 2020, des chercheurs de
l'université de Stanford annoncaient un taux de rémission de plus de
80% chez 19 patients dépressifs sur 22 grâce à cette technique.
Ci-dessus. une molécule d'eskétamine, utilisée comme anesthésiant,
mais aussi en cas de dépression sévère.
Ci-contre, les champignons psilocybes. dont la substance active
psychotrope est testée depuls 2023.
Les
psychédéliques entraînent un bouleversement aigu du réseau du mode
par défaut
FRANÇOIS
MALLORDY
---------------
"L'intelligence
émotionnelle contribue à une meilleure adaptation"
Selon
Moïra Mikolajczak*, de l'université catholique de Louvain,
et
Marcello Mortillaro, de l'université de Genève,
l'intelligence émotionnelle est bénéfique pour la santé mentale,
physique, et pour les relations sociales et amoureuses.
PARRIVA
BRINET-SPIESSER
Nous ne
disons pas qu'il faut toujours exprimer et réguler ses émotions,
mais avoir la capacité de le faire permet de l'utiliser à bon
escient
SVHS:
Comment définir le terme d'intelligence émotionnelle ?
Moïra Mikolajczak :
C'est une notion
globale qui revêt en réalité un ensemble de compétences distinctes.
Il s'agit de notre capacité à reconnaître des émotions, à les
comprendre, à les exprimer et, ensuite, à les réguler, que ce soit
pour ses propres émotions ou pour celles des autres. Attention, nous
ne disons pas qu'il faut toujours exprimer et réguler ses émotions,
mais avoir la capacité de le faire permet de l'utiliser à bon
escient.
SVHS :
La notion d'intelligence émotionnelle acété popularisée dans les
années 1990 par l'ouvrage du docteur en psychologie et journaliste
Daniel Goleman. Le succès de ce livre n'a-t-il pas galvauda ce
courant de la psychologie ?
M.Mi. : Cet ouvrage a
fait autant de bien qu'il a causé de tort. Il a mis en lumière
l'importance de ce sujet pour notre société, mais beaucoup
d'affirmations n'avaient aucun fondement scientifique, comme le fait
que le quotient émotionnel (QE) serait deux fois plus important dans
la prédiction du succès que le quotient intellectuel (QI).
L'approche de Goleman a vite été démontée, cela a créé un débat ...
auquel, au final, on doit beaucoup !
Marcello Mortillaro: De
mon point de vue, la popularité de ce livre n'a pas forcement fait
du bien a la recherche. Pendant longtemps, une partie des chercheurs
ont considéré que ce courant manquait de fondement scientifique.
Encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes s'autorisent à
parler d'intelligence émotionnelle parce qu'elles considèrent avoir
une expérience personnelle du sujet. Or, avoir une opinion basée sur
du vécu n'a rien à voir avec émettre une vérité scientifique.
SVHS:
Pourquoi s'intéresser autant a cette "autre" forme d'intelligence ?
M.Mo. : Parce que nous
disposons d'un nombre exceptionnel de meta-analyses qui vont toutes
dans le même sens : elles montrent qu'avoir une bonne intelligence
émotionnelle apporte de nombreux bénéfices dans les domaines les
plus importants de la vie. Nous l'étudions justement pour mieux
comprendre comment tout cela se met en place.
M.Mi. : Les bénéfices
d'une bonne intelligence émotionnelle sont en effet très documentés
: des gains sont prouves sur la sante mentale, la santé physique,
dans le domaine des relations sociales et amoureuses. Dans le milieu
professionnel, l'intelligence émotionnelle contribue à une meilleure
adaptation et renforce la productivité et la satisfaction au
travail. En réalité, tous ces bénéfices sont imbriques : avoir une
meilleure santé mentale vous rend par exemple moins sensible au
stress et permet une meilleure relation entre collègues.
SVHS:Cette intelligence émotionnelle pourrait-elle prendre le pas
sur l'intelligence cognitive, celle que l'on mesure par le QI ?
M.Mo. : Je ne crois pas
qu'il faille mettre en compétition les différentes formes
d'intelligence. Nous savons aujourd'hui que la réussite d'un
individu ne peut être expliquée uniquement par l'intelligence
cognitive et qu'il faut intégrer d'autres notions, comme
l'intelligence émotionnelle ou les traits de personnalité. Pour nous
améliorer, nous devons travailler ces trois paramètres
simultanément.
M.Mi. : Accorder la
prééminence à l'une ou l'autre de ces notions masquerait les
variabilités interpersonnelles qui sont fortes. Certaines personnes
peuvent avoir un QI modeste, mais compenser par une intelligence
émotionnelle plus élevée, et vice versa. Ceci n'est vrai que dans
une certaine mesure, car chaque forme d'intelligence repose sur des
processus distincts.
SVHS :
Mesurer l'intelligence émotionnelle comme on mesure le QI est-il
aujourd'hui possible ?
M.Mi. : Nous y
travaillons, mais ce n'est pas chose aisée. L'enjeu est de réussir à
capter l'intelligence émotionnelle par des tests simples et
prédictifs du comportement et de la réussite d'un individu.
Il faut que nos tests
prévoient ce que l'intelligence émotionnelle est censée prédire :
une bonne santé, de meilleures relations, etc.
De plus, mesurer une
compétence émotionnelle est chose délicate : comment puis-je évaluer
la capacité d'un individu à comprendre ses émotions alors que je ne
sais pas moi-même ce qu'il ressent? Quant à mesurer la capacité à
reconnaître les émotions des autres, nous faisons face à des
stratégies très variables selon les personnes. Certaines observent
les expressions faciales, d'autres les variations de la voix,
d'autres encore sont très douées pour déduire de l'information à
partir du contexte dans lequel se trouve l'individu. Certes, nos
tests ne sont pas encore aussi bons que ceux développés par les
chercheurs en intelligence cognitive ... Mais ceux-ci ont des
décennies d'avance !
M.Mo. : Je serai moins
critique ! Tout ce que nous affirmons aujourd'hui sur les bénéfices
de l'intelligence émotionnelle vient du fait que l'on a pu mesurer
ces compétences. Nous avons à disposition des tests solides
d'auto-évaluation des émotions, et des tests de performance où l'on
doit, par exemple, identifier la plus probable émotion sur le visage
de quelqu'un d'autre. Nous avons certes des progrès à accomplir,
mais pour certains aspects de l'intelligence émotionnelle, nous
pouvons faire confiance aux tests scientifiques dont nous disposons.
SVHS :
Ces compétences émotionnelles sont-elles innées ou a-t-on une chance
de pouvoir les développer au cours de sa vie ?
M.Mi. : Nous disposons
de peu d'études, mais celles réalisées suggèrent une composante
héréditaire de l'ordre de 40%, ce qui est un peu plus faible que
pour l'intelligence cognitive. Les 60 % restants sont liés à des
facteurs environnementaux.
M.Mo. : J'accorde peu
d'importance aux chiffres pour définir la part de l'inné et de
l'acquis. Pour moi, l'intelligence émotionnelle est avant tout une
potentialité que chacun de nous possède à la naissance et qui se
développe très vite si l'influence de notre environnement familial
le permet. Le cas du petit garçon qui s'interdit de pleurer, car "ça
ne se fait pas pour un homme", est un exemple criant. Ensuite, les
opportunités d'interaction que la vie nous offre permettent de
développer plus ou moins ces compétences.
M.Mi. : Il existe aussi
des ateliers de groupe pour travailler son intelligence
émotionnelle. Les études montrent que les résultats se maintiennent
dans le temps, au-delà d'une année, des lors que les formations
abordent les compétences dans leur ensemble et non séparément. Cela
s'explique par le fait qu'elles sont liées entre elles : pour
réguler l'émotion de l'autre, je dois la reconnaître, la comprendre
et réguler d'abord la mienne.
SVHS:
Comment envisagez-vous l'avenir des recherches sur l'intelligence
émotionnelle ?
M.Mo. : Nos
connaissances scientifiques sont maintenant suffisamment robustes
pour les faire sortir de nos laboratoires ! On trouve sur internet
des dizaines de formations sur l'intelligence émotionnelle sans
connaître leur bien-fondé. J'aimerais que l'on propose des offres
accessibles à la société qui soient validées scientifiquement. Il y
a un grand mouvement aux Etats-Unis, soutenu par le Yale Center for
Emotional Intelligence, pour intégrer le "social emotional learning"
dans les écoles et proposer un ensemble d'outils aux enseignants. Il
faudrait aller au-delà du cadre scolaire et le développer dans le
milieu du soin, par exemple, dans lequel la charge émotionnelle est
très élevée, avec la possibilité de faire un suivi des résultats
observés.
M.Mi. : Nous devons
résoudre un autre problème : 95 % des recherches sur l'intelligence
émotionnelle sont issues du monde occidental, les continents
africain et sud-americain sont sous-représentés. On se prive de tout
un savoir, complémentaire au nôtre, alors que l'on sait qu'il y a
des différences culturelles dans le traitement des émotions ;
celles-ci ne sont pas valorisées ou proscrites de la même manière
que chez nous. "
* Docteure en
psychologie et professeure à l'université catholique de Louvain.
** Responsable de
l'unité sciences affectives appliquées au centre inter facultaire en
sciences affectives (Cisa) de l'université de Genève.
95% des recherches sur
l'intelligence émotionnelle sont issues du monde occidental, les
continents africain et sud-américain
sont sous-représentés
PARRIVA
BRINET-SPIESSER
|
 
Yves Sciama -
Science & Vie
1284 - Septembre 2024
|
|
Champignons Les secrets
de leurs génomes se dévoilent
Le réseau biologique
d'Yves Sciama
Fabrication de
médicaments, création de matériaux, élimination des déchets,
réduction des émissions de CO2 ... C'est à tout cela que participent
les champignons. Et on commence à comprendre pourquoi.
Admirez ce parterre de champignons, avec
leur tronc fin et leur chapeau jaunâtre. Vous les avez sûrement déjà
croises lors de vos balades champêtres. Il s'agit de mycènes, un
genre très commun compose d'une myriade d'espèces. A priori, ils
n'ont rien de particulier. Et pourtant, ils ne cessent de nous
stupéfier. Voyez plutôt : en juin dernier, des chercheurs ont révélé
que la plupart de ces mycènes possèdent un génome gigantesque,
jusqu'à 97 030 gènes codants. L'humain, lui, n'en a qu'environ 20
000, soit cinq fois moins !
Comment est-ce possible ? Selon les
scientifiques, ce serait grâce a de fascinantes stratégies
génétiques. D'abord, les mycènes se seraient dotes, au cours de
l'évolution, d'un nombre et d'une proportion (environ 60 %)
exceptionnels de "gènes sauteurs" ou transposons. Ce type de gènes,
que l'on retrouve aussi chez l'humain, sont capables de se déplacer
dans le génome, d'y proliférer, et de générer de nombreuses
mutations, donnant ensuite naissance à des gènes inédits, parfois
très utiles. De véritables catalyseurs de l'évolution. "On estime
que ces transposons ont donné les familles de gènes impliquées dans
la dégradation de la matière organique et celles spécialisées dans
la colonisation des racines des plantes. Cela expliquerait leur
talent de décomposeurs et leur aptitude à la symbiose", s'émerveille
Francis Martin, écologue forestier a l'Inrae Nancy et coauteur de
l'étude.
TRANSFERT GÉNÉTIQUE
HORIZONTAL
Ce n'est pas tout : les mycènes auraient
aussi emprunte des centaines de gènes à d'autres familles de
champignons. Cette prouesse - dite du "transfert génétique
horizontal" - peut se faire de différentes façons : par la
transmission d'un fragment d'ADN d'un filament mycélien a un autre,
via un virus transportant des morceaux de génome ou lors de
l'absorption d'un organisme mort.
Cette méthode leur aurait permis de
gagner encore en compétence, renforçant par exemple leurs défenses
face à certains parasites. Voila donc un génome gigantesque et riche
de compétences dont les scientifiques commencent à peine a mesurer
l'ampleur !
Reste que le champignon que l'on voit en
foret n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit de
l'organe reproducteur qui sert a porter les spores, analogues a des
graines. Pour trouver d'ou viennent ses pouvoirs, il faut plonger a
la base de son pied : enfonce dans la terre se trouve le mycète,
l'organisme a l'origine de toutes les stupéfactions. C'est un énorme
réseau de filaments invisibles (les hyphes), constamment en train de
s'allonger, de se fragmenter et de se remodeler - un vrai alien ! Il
est si différent des animaux et des plantes qu'au milieu du XXe
siècle, les scientifiques ont crée pour lui un règne à part dans la
classification du vivant, le règne fongique.
DES AS DU RECYCLAGE
Des décennies plus tard, les champignons
passent un nouveau cap. Pour la plupart des chercheurs, ce groupe a
beaucoup moins été l'objet de recherches que les animaux et les
plantes, alors que ses superpouvoirs pourraient résoudre bien des
problèmes de l'humanité. Et dans de nombreux domaines ! A commencer
par le recyclage : "Grace a leur cocktail de puissantes enzymes et
d'acides, les mycètes peuvent décomposer des substances parmi les
plus récalcitrantes", décrit Merlin Sheldrake, mycologue à
l'Université libre d'Amsterdam (Pays-Bas), dans son fascinant livre
Le Monde cache. Rien - ou presque ! - ne leur résiste, du pétrole
brut aux polyuréthanes, en passant par l'explosif TNT ou la lignine,
le composant le plus résistant du bois.
Et les chercheurs ont déjà réussi a
faire décomposer toutes sortes de plastiques et de polluants
problématiques (lire p. 105) par des mycètes qui les convertissaient
en molécules biodégradables. Car la ou les plantes se sont
spécialisées dans l'assemblage de grandes molécules - avec l'énergie
solaire pour moteur -, les champignons ont plutôt choisi la voie du
désassemblage, récupérant l'énergie au passage. Un rôle précieux,
car les molécules simples issues de leur travail peuvent ensuite
être réabsorbées par les plantes ou les animaux. C'est clair : sans
eux, les plantes n'auraient pas accès à nombre de minéraux. Surtout,
le vivant ne tarderait pas à suffoquer sous le poids de ses déchets
: végétaux morts et cadavres encombreraient prairies et forêts.
Privées des nutriments qu'ils contiennent, les plantes
s'étioleraient peu à peu.
De plus, le mycète se comporte de façon
très étrange, défiant notre logique habituelle. Ainsi, il ne se
nourrit pas comme nous, en incorporant ses aliments. Il pousse au
contraire a travers eux, les digère a l'extérieur de son corps en
sécrétant des enzymes, puis les intègre. Son organisme est une sorte
de chimiorécepteur géant : lorsqu'il détecte la présence d'eau ou de
nutriments, il pousse dans la direction du gisement puis s'y ramifie
pour en absorber le maximum avant de poursuivre sa quête. Chaque
tète de filament est a la fois une partie du tout et un organisme a
part, qui "choisit" vers ou se diriger, a quelle vitesse, et s'il
faut se diviser ou pas. Et ce, "sans que l'on comprenne vraiment
quels types de signaux circulent et régissent ces changements",
décrit Merlin Sheldrake. Selon lui, il pourrait aussi bien s'agir de
communication chimique qu'électrique ... La recherche tente encore
de déceler les mécanismes en jeu. Enfin, si un coup de bêche, par
exemple, coupait le mycète en deux, chaque partie poursuivrait sa
vie, désormais indépendante.
L'UN DES FONDEMENTS DE LA
VIE SUR TERRE
Mais l'un des talents les plus
remarquables des mycètes - conséquence sans doute de leurs dons de
chimistes -, est la créativité avec laquelle ils interagissent avec
les autres êtres vivants. Ce sont des champions de la relation,
aussi habiles a s'allier et servir diligemment qu'à trahir,
manipuler, parasiter, et parfois tuer ... Quantité d'amateurs de
champignons imprudents en ont fait les frais. Par ailleurs, de
nombreux médicaments, aussi bien antibiotiques qu'anticancéreux ou
psychotropes, nous viennent de cette inventivité chimique.
On le comprend a présent, la relation
intime des mycètes avec les plantes est l'un des fondements de la
vie sur Terre : les premiers végétaux - des algues -, dépourvus de
racines, se sont allies avec les champignons pour sortir des eaux,
troquant leurs sucres contre la protection, les sels minéraux et
l'ancrage que ceux-ci leur offraient. Cette relation s'est raffinée
et diversifiée durant plus de 500 millions d'années de coévolution :
aujourd'hui, les filaments mycéliens colonisent plus de 90 % des
végétaux terrestres selon une diversité de modalités extraordinaire,
soit en entrant au cur des cellules des plantes, soit en circulant
entre leurs parois, soit en enveloppant leurs racines ... voire les
trois à la fois.
"Les mycètes sont des ingénieurs
ecosystemiques, ajoute Toby Kiers, biologiste a l'Université libre
d'Amsterdam, et grande spécialiste de ces organismes. Ils permettent
aux plantes de manger la roche grâce à leurs capacités chimiques. Et
ils stockent une partie importante du carbone terrestre dans leurs
filaments, formant des sortes d'échafaudages avec leurs hyphes, qui
retiennent les sols et les structurent." C'est ce qu'elle a montré
avec ses collaborateurs en 2023 : les mycètes enfouiraient chaque
année le tiers des émissions de dioxyde de carbone de l'humanité,
soit 13 milliards de tonnes de CO ! "Une estimation sans doute très
prudente", juge Toby Kiers, qui est persuadée que l'on pourrait
considérablement booster, en s'appuyant sur les mycètes et leurs
relations avec les plantes, l'absorption naturelle des gaz à effet
de serre.
Enfin, les matériaux synthétises par les
mycètes commencent à être explorés par quelques start-up
bio-inspirées.
"L'agriculture pourrait connaître une
véritable révolution mycologique", affirme Marc-André Selosse,
écologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais il
faudrait, pour cela, que les agronomes parviennent à mettre aux
services des plantes cultivées les capacités d'adaptation a la
sécheresse et à la recherche de nutriments des mycètes.
Ces derniers sont, selon le chercheur,
l'une des clés pour réduire drastiquement la consommation en eau et
en engrais de nos cultures. De quoi se dire que, 500 millions
d'années âpres la grande symbiose que les mycètes ont nouée avec les
plantes, le temps est venu d'une alliance entre eux et les humains.
Les champignons ont la faculté de ...
... s'allier avec les plantes 90 % des végétaux sur Terre forment
des symbioses avec les champignons : en échange de carbone, les
plantes récupèrent davantage d'eau et de nutriments. ... recycler le
vieux bois
Les enzymes des mycètes décomposent les
molécules du bois qualifiées de "récalcitrantes" par les
scientifiques - car elles résistent particulièrement à la
décomposition, à l'instar de la lignine - et les rendent
assimilables par les plantes.
... stabiliser et nourrir le sol
Les mycètes le protègent contre
l'érosion, aggravée par l'intensification des pluies liée au
dérèglement climatique. Ils agrègent les particules minérales et
organiques avec leurs secrétions, et les enserrent dans leur réseau
filamenteux.
... manipuler certains animaux
Certains mycètes peuvent, par exemple,
forcer les fourmis qu'ils ont parasitées à monter sur des végétaux
afin qu'elles soient mangées par les animaux. Ainsi, les champignons
sont disséminés via les excréments de ces derniers.
... coloniser la plupart des surfaces
Les mycètes ont réussi a se développer
sur bon nombre de surfaces, parfois 'inhospitalières. C'est
notamment le cas des roches nues où l'on retrouve des lichens
(alliance mycète/ plante), sur lesquels s'accrochent d'autres
végétaux.
... décomposer la roche mère
En s'insinuant dans les failles et les
pores des pierres, tout en secrétant des acides et des enzymes, les
mycètes fragmentent les roches. Ce faisant, ils rendent certains
éléments disponibles pour les plantes.
Ils ont conquis le monde
Grace notamment a leur génome très
étendu, les champignons se sont adaptes a quasiment tous les
environnements terrestres, colonisant la presque totalité du globe,
des déserts aux montagnes jusqu'aux régions de l'Arctique.
Exploiter leurs superpouvoirs nous
permettrait de ...
De plus en plus de matériaux en mycélium
- mélange de chitine, de glucanes, de sucres et de lipides - sont
mis sur le marché car ils offrent une alternative intéressante à
certains plastiques. Issus de déchets organiques (sciure, paille ...
), ils sont entièrement biodégradables et possèdent de nombreuses
propriétés : isolants, élastiques, imperméables, riches en carbone,
etc.
... créer des matériaux verts
... synthétiser des médicaments
Ils sont une mine de substances
pharmaceutiques. Pour se protéger, ils produisent de nombreux
antibiotiques et des substances antifongiques. Habiles a coloniser
d'autres organismes, ils fabriquent aussi des immunosuppresseurs et
sont source de psychotropes puissants (photo : Psilocybe cubensis ),
sans doute pour manipuler le système nerveux de leurs hôtes.
... lutter contre les ennemis des
cultures
De nombreux mycètes ont la capacité de
parasiter, voire de tuer de manière ciblée certains insectes et
végétaux. C'est le cas des champignons entomopathogènes Cordyceps et
Purpureocillium. S'inspirer de leurs stratégies de biocontrôle
pourrait nous fournir des armes biologiques pour lutter contre les
parasites qui dévorent les cultures.
... recréer des sols fertiles
Grâce à leurs hyphes, les mycètes
maintiennent la cohésion du sol. De plus, les champignons
synthétisent ou rendent bio disponibles nombre de molécules
indispensables aux plantes, permettant au réseau racinaire de se
déployer (photo). La réhabilitation des sols épuisés par
l'agriculture intensive suppose donc de rétablir des populations de
mycètes diversifiées.
... améliorer des aliments
Certains aliments (pain, bière, fromage
... ) sont issus de la fermentation par des champignons. Cette
technique favorise la conservation en éliminant les pathogènes et
produit des nutriments essentiels, tels que les acides aminés.
Davantage s'en inspirer nous permettrait d'améliorer la qualité de
notre alimentation.
... éliminer nos déchets
Les mycètes seraient capables de digérer
des substances très résistantes à la biodégradation (plastiques,
mégots, couches-culottes, pesticides ... ) et certains produits
toxiques (médicaments, phénols, métaux lourds ... ). Ici, des
Trametes versicolor, efficaces pour éliminer le fioul.
|
 
LE LIBRE ARBITRE A LEPREUVE DES
NEUROSCIENCES
ANNE DEBROISE -
Science & Vie
1280 - mai 2024
|
|
SOMMES-NOUS MAITRES DE
NOS CHOIX ?
LE LIBRE ARBITRE A
LEPREUVE DES NEUROSCIENCES
PAR ANNE DEBROISE
« Illusoire », assènent les uns ! "Tout
à fait réel", s'écrient les autres ! Le libre arbitre, cette faculté
qui nous permettrait de faire des choix en toute conscience, agite
les débats dans les neurosciences depuis 50 ans. Or voilà que de
nouvelles techniques d'imagerie et d'analyse l'éclairent sous un
nouveau jour. Certes, toutes nos décisions sont influencées par
notre inconscient, nos émotions, ou encore la société. Mais ça ne
signifie pas qu'un libre arbitre n'existe pas pour autant ...
Plongeons dans les méandres du cerveau humain, à sa rencontre.
Avez-vous eu le choix
d'attraper ce magazine, de l'ouvrir et de lire ces quelques lignes ?
Bien évidemment !
Et d'ailleurs, pour cette décision comme
pour les autres, vous êtes même capable d'identifier les motivations
qui vous ont guidé. N'est ce pas là la preuve de notre libre
arbitre, ce merveilleux phénomène qui fait que chacun d'entre nous
est absolument unique? Pas sûr: tout ceci pourrait n'être qu'une
illusion, une simple histoire que nous nous racontons pour justifier
nos actions après coup. C'est en tout cas la théorie développée par
le neuroendocrinologiste américain Robert Sapolsky, dans son livre
Determined (Déterminés), publié fin 2023. Le chercheur y soutient
que nous n'avons aucune prise sur nos choix.
Selon lui, nos actions seraient le
résultat de l'influence de nos émotions, de notre état
physiologique, de notre génétique, de nos expériences, et d'une
culture dont les racines plongent très loin dans le passé. Le
chercheur en arrive même à appeler à une réforme de la justice: si,
finalement, l'humain n'est pas libre de ses choix, alors il ne peut
être tenu responsable de ses actions!
Evidemment, cette théorie provocatrice
ne fait pas consensus et, fin 2023, un autre chercheur a publié un
livre à la conclusion dia Free Agents (Agents libres), Kevin
Mitchell, professeur assistant de génétique et de neurosciences au
Trinity Collège de Dublin (Irlande), défend l'existence d'un libre
arbitre dans l'humanité. Mais pas seule ment: prenant comme point de
départ l'évolution, il argumente que celle-ci a doté tous les
organismes vivants, jusqu'aux bactéries, de la capacité de faire des
choix éclairés.
L'ONDE DE PRÉPARATION
Après avoir fasciné philosophes,
sociologues et théologiens, voilà donc que l'existence du libre
arbitre déchire la communauté scientifique. Et si nos deux experts
semblent se répondre par livres interposés, ce n'est pas un hasard:
les neurosciences sont en train d'aborder un véritable tournant.
Grâce aux nouvelles techniques, les chercheurs peuvent désormais
enregistrer l'activité individuelle de chaque neurone. Et avec
l'essor des outils d'analyse de données, ils espèrent pouvoir
rattacher ces enregistrements à des comportements humains. Ainsi,
l'espoir de dénicher le signal qui mettra tout le monde d'accord n'a
jamais été aussi grand. Car depuis un demi-siècle, c'est un autre
signal qui attise les débats dans la communauté: celui obtenu dès
1983 par le psychologue amé ricain Benjamin Libet. Dans une
expérience devenue célèbre, le chercheur demandait à des
participants d'appuyer sur un bouton mais aussi de retenir, à l'aide
d'une horloge, l'instant précis où ils avaient décidé de le faire.
Pendant ce temps, des électrodes posées sur la surface du crane des
volontaires enregistraient les courants électriques de leurs
neurones sous jacents. Résultat: l'onde de préparation, un signal
typique qui précède un mouvement, se formait ... 200 ms avant la
prise de décision !
LOIN DE NOTRE MAÎTRISE
D'où cette conclusion qui a mis le feu
aux poudres: l'intention d'agir n'est pas la cause de l'action, il
se passerait quelque chose avant, loin de notre maîtrise. Autrement
dit, nos décisions tiendraient de l'in conscient ... et le libre
arbitre n'existerait pas. Bien entendu, depuis les années 1980,
cette expérience a été répliquée de nombreuses fois, à l'aide de
nouvelles techniques, notamment avec l'arrivée des IRMf (qui
permettent de visualiser l'activité des neurones). Et son résultat
est toujours resté identique. Sauf que certaines variantes l'ont
tout de même contestée ! Par exemple, si le volontaire sait que
presser le bouton va avoir des conséquences comme déclencher une
donation, le signal préparatoire ne précède plus la décision. Alors
quoi? "Le concept de libre arbitre renvoie à des comportements
autrement plus élaborés que de bouger le poignet", fustige Bernard
Feltz, professeur émérite à l'Institut supérieur de philosophie de
l'UC Louvain. Depuis 50 ans, les deux écoles s'affrontent donc à
coups d'arguments bien rodés. Par tons a leur rencontre, à la
recherche de ce libre arbitre si difficile à capturer. Il vous
suffit de tourner la page vous avez le choix ...
DE MULTIPLES INFLUENCES
DERRIERE CHACUN DE NOS CHOIX
S'ils paraissent souvent
réfléchis et éclairés, nos choix résultent toujours, en fait, d'un
complexe engrenage cérébral gouverné par notre inconscient.
Rester à la maison ou sortir ? Fromage
ou dessert? "Je le veux" ou non?
Qu'ils soient anodins ou déterminants
pour notre futur, tous nos choix résultent d'une opération
cérébrale. Les psychologues suspectaient donc l'existence, dans le
cerveau, d'un mécanisme évaluant les différentes options et
orientant le choix vers celle qui avait notre préférence ...
Or, ces dernières années, les
neuroscientifiques ont prouvé que c'était bien le cas. Mieux:
plusieurs des structures cérébrales impliquées dans le processus de
décision ont été identifiées. Et contrairement à ce que l'on
pourrait croire, certaines d'entre elles prennent racine très
profondément dans le cerveau, là où même la lumière de la conscience
ne pénètre pas. Nos choix s'appuient donc sur une large part
d'inconscient.
DANS LE CORTEX
ORBITO-FRONTAL
Toutefois, avant de s'aventurer dans les
tréfonds de notre encéphale, encore faut-il définir ce qu'est la
conscience. Si plusieurs théories s'affrontent à son sujet, toutes
la définissent comme la capacité à nous rapporter nos propres états
et ressentis mentaux. Et toutes la voient émerger dans le cortex
cérébral, c'est-à-dire la couche supérieure des hémisphères
cérébraux. Particulièrement développée chez les humains, cette
région est désignée comme le siège des "fonctions supérieures",
c'est-à-dire du raisonnement, du langage, de la mémoire, de la
commande des mouvements volontaires, etc. Forcément, c'est d'abord
là que les neuroscientifiques ont traqué les neurones spécialisés
dans la prise de décision. Et qu'ils les ont trouvés! "Dès qu'il y a
un choix à faire, que ce soit chez l'homme ou l'animal, nous voyons
que le cor tex orbitofrontal s'active, témoigne Sylvie Granon, de
l'université Paris Saclay. Cette région semble chargée, entre
autres, de représenter la valeur des différentes options." Plusieurs
expériences ont per mis d'illustrer ce processus, dont celles
réalisées en 2006 par Camillo PadoaSchioppa à l'université Harvard,
aux Etats-Unis. Le chercheur offrait à des singes rhesus
l'opportunité de goûter une variété de bois sons: jus de citron
sucré, de raisin, de fruits exotiques, de pomme, de canneberge, de
l'eau, du thé et même de l'eau salée. À l'heure du choix, des
électrodes implantées dans leur cerveau enregistraient alors une
flambée d'activité dans le cortex orbitofrontal.
COMPÉTITION DE VALEURS
Plus encore: en mesurant l'activité de
931 neurones au moment précis où le primate choisissait sa boisson
préférée, entre deux propositions, l'équipe a démontré que
l'activité de certains neurones était proportionnelle à la valeur
attribuée par le singe à l'option choisie. Ainsi, chez les singes
rhésus, le jus de raisin suscite visiblement plus d'enthousiasme et
davantage d'activité de certaines cellules cérébrales que le the.
Quelle conclusion tirer de cette expérience? "Dans le tissu
cérébral, toutes les options sont valorisées puis intégrées, décrit
Thomas Boraud, neuroscientifique à l'université de Bordeaux. Il y a
ainsi une compétition entre plu sieurs populations de neurones, et
celle qui gagne entraîne la décision."Cette compétition est
permanente, les options étant réévaluées constamment, complète
Sylvie Granon: "Si vous essayez un nouveau dessert au self, qu'il
vous attire, vous allez lui attribuer une valeur a priori. Mais si
vous êtes déçu, elle chutera. De même, si vous abusez d'un aliment
que vous aimez beau coup, il deviendra moins attractif. Au
contraire, si un bien est rare, sa valeur augmentera." Enfin, la
valeur de chaque option fluctue aussi selon l'état physiologique de
chacun au moment du choix, souligne Mathieu Wolff, chercheur à
l'université de Bordeaux: "Un aliment n'aura pas la même valeur si
j'ai faim ou si je suis rassasie." Un constat aussi fait par Camillo
Padoa Schioppa: au réveil, quand les animaux avaient soif, une
simple gorgée d'eau s'avé rait nettement plus attractive. Bon, le
cortex orbitofrontal est bien la région où le choix prend forme, où
les valeurs des différentes options s'affrontent ... Mais sur quels
arguments s'appuie-t-il pour attribuer les valeurs initiales? Un
mécanisme fondamental l'influence particulièrement : l'anticipation
du plaisir attendu, qui exploite le circuit cérébral de la
récompense. Très exploré par les spécialistes des addictions, c'est
lui qui fournit la motivation nécessaire pour déclencher des
comportements visant à rechercher des sensations plaisantes et à
éviter les désagréments.
LE CIRCUIT DE LA RÉCOMPENSE
Or ce circuit de la récompense, qui
implique des neurones communiquant via la dopamine, relie des
régions diverses et très éloignées ! Il est, par exemple, alimenté
par des signaux venus des aires de décryptage sensoriel vision,
audition, goût ... Il interagit aussi avec le système limbique, au
centre du cerveau, impliqué dans les émotions et la mémorisation à
long terme. Toutes ces structures cérébrales alimentent constamment
le cortex orbitofrontal en informations, afin de lui permettre
d'attribuer une valeur pertinente aux différentes propositions qui
s'offrent à nous. La conséquence, c'est que nous faisons parfois nos
choix consciemment. Quant à savoir pourquoi nous avons fait ce
choix, pourquoi cette option a davantage retenu notre attention ...
là, c'est une tout autre histoire, de l'ordre de l'inconscient.
FAIRE UN CHOIX, C'EST
OBEIR A SON CORPS
Nombre d'actes quotidiens
n'ont d'autre but que satisfaire nos besoins primaires.
Ce matin, en vous levant, vous avez
peut-être bu un verre d'eau. La scène est ordinaire, pourtant le
mécanisme sous-jacent interroge : avez-vous le souvenir d'avoir pesé
le pour et le contre afin de faire un choix conscient et
éclairé-boire de l'eau? Probablement pas, et c'est bien normal:
"Seules les décisions les plus lourdes sont scrutées par notre
conscience, tranche Mathieu Wolff, de l'université de Bordeaux.
Les petits conflits du quotidien sont,
eux, rapidement gérés en mode automatique, c'est ce qui nous permet
de réagir et de décider rapidement."
Ce mode "auto" court-circuite le
processus de décision habituel: vous avez "imprimé" qu'au réveil,
votre corps est déshydraté et qu'il faut boire. Il suit une décision
primaire prise il y a longtemps, qui obéissait, elle, aux
injonctions de l'hypothalamus, une structure cérébrale qui orchestre
les grands équilibres de la survie (la faim, la soif, le rythme
cardiaque, la gestion du stress, etc.) "La plupart des décisions
visent avant tout à maintenir l'équilibre physiologique du corps,
indique Sylvie Granon, de l'université Paris-Saclay. Si une personne
vous est désagréable, vous aurez tendance à l'éviter pour faire
baisser le niveau de cortisol [l'hormone du stress, ndlr] et faire
baisser votre rythme cardiaque qui s'est emballé. Si votre glycémie
chute, vous allez ouvrir un paquet de gâteaux; si vous vous sentez
seul, vous allez chercher le contact social ... "
INFLUER SUR NOS DILEMMES
MORAUX
Cette boussole inconsciente irait même
jusqu'à influer sur nos dilemmes moraux. "La morale, notamment la
notion d'injustice, est de l'ordre du ressenti primaire. Les singes
y sont d'ailleurs très sensibles", souligne la chercheuse. C'est ce
que constatait le primatologue Frans de Waal dans les années 2000, à
l'aide d'une expérience restée célèbre. Le chercheur proposait à un
singe capucin des morceaux de concombre en échange d'un caillou.
Mais quand celui-ci se rendait compte que son voisin recevait, pour
la même tâche, un morceau de pomme, bien plus savoureux, il entrait
dans une colère noire et lançait le concombre à la tête de
l'expérimentateur. Avait il réellement le choix de réagir autrement?
FAIRE UN CHOIX, C'EST
ECOUTER SES ÉMOTIONS
Loin d'être opposées à la
rationalité, les émotions nous aident à identifier les valeurs
associées à chaque scénario, puis à choisir entre eux.
Eliott était un cadre commercial
brillant... jusqu'à ce qu'on lui découvre une tumeur au cerveau.
Celle-ci a pu être extraite par
chirurgie, et ses connaissances et sa capacité de raisonnement sont
restées intactes. Par contre, il a perdu toute faculté à ressentir
des émotions ... Pourquoi? La zone touchée par son cancer, le cortex
préfrontal ventromédian, est densément reliée au système limbique,
où se trouve notamment l'amygdale, impliquée dans la peur et
l'agressivité, ou encore l'hippo campe, essentielle pour la
formation de la mémoire à long terme. Sauf que voilà : en plus de
perdre ses émotions, Eliott, dans la foulée. Celle de l'opération,
ne parvenait plus à faire des choix cohérents. Des lors, il cumulera
les échecs professionnels et affectifs ... Cette histoire, que le
neuroscientifique Antonio Damasio raconte dans son livre L'Erreur de
Descartes (publié en 1994), marque un tournant dans la manière
d'envisager la prise de décision. Les émotions y joueraient un rôle
prépondérant.
STRESS ET PERFORMANCES
De nombreux autres cas cliniques
similaires à celui d'Eliott sont depuis venus alimenter cette thèse:
tous présentent des lésions du cortex préfrontal ventro-médian, et
des déficits à la fois dans la perception des émotions et la prise
de décision. Le rôle des émotions dans nos choix a même été entériné
grâce au fameux "test du casino de l'Iowa", développe par Antoine
Bechara à l'université de l'État américain du même nom. Dans cette
expérience, les chercheurs placent devant les participants quatre
tas de cartes, faces cachées, sur lesquelles figurent soit un gain
soit une perte d'argent. Le but est alors de gagner le maximum
d'argent. Or les tas ne sont pas identiques : certains sont nette
ment plus avantageux que d'autres. Une fois la partie lancée, les
sujets sains réalisent très rapidement la supercherie, et se
concentrent vite sur les meilleurs tas pour maximiser leur profit.
C'est là que les chercheurs corsent l'expérience: ils annoncent aux
participants qu'après ce jeu, chacun devra tenir un discours devant
une assemblée ceci afin d'augmenter leur stress. Et voilà soudain
que les sujets perdent en efficacité et mettent plus de temps a
s'orienter vers les tas les plus avantageux! Par la suite, d'autres
études ont encore affine cet effet: si un stress important détériore
nos per formances, il semble qu'un stress léger les améliore.
NUANCES DE JOIE
Mais il y a plus subtil encore: en 1999,
Rajagopal Raghunathan et Michel Tuan Pham, deux psycho logues
exerçant a New York, ont montre que l'état psychique d'un individu
jouait aussi sur ses décisions. Les personnes de nature plutôt
triste avaient ainsi tendance à opter pour des emplois a haut risque
mais avec un gain potentiel élevé; tandis que les individus anxieux
préféraient les options comportant peu de risques, mais aussi moins
de gains. Deux émotions à connotation négative peuvent donc pousser
à faire des choix diamétralement opposés ! Ce qui révèle l'ampleur
du phénomène: pour élucider le rôle exact de chaque émotion, il
faudrait pouvoir identifier les myriades de nuances de tristesse, de
dégoût, de culpabilité, de joie, de sérénité ... et les rattacher à
une panoplie de choix allant de la couleur d'une chemise à une
demande en mariage ! Le diktat des émotions sur la décision réserve
encore bien des surprises.
FAIRE UN CHOIX, C'EST
NEGOCIER AVEC SA GENETIQUE
Notre génome détermine
notre appartenance à l'espèce humaine. Il structure également notre
cerveau, le siège des décisions.
Qui devrait-ton juger plus sévèrement?
Un automobiliste qui fonce volontairement sur une foule mais ne
blesse personne, ou un automobiliste renversant un piéton qui s'est
jeté sous ses roues ? La tendance, chez les adultes, est de blâmer
le premier: l'intention de faire du mal est jugée plus sévère ment
que la seule réalisation. Sauf que ce parti pris n'est pas clair
pour tout le monde: en 2012, Martin Reuter et son équipe de
l'université de Bonn, en Allemagne, ont même démontre qu'il pouvait
être influencé ... par la génétique ! Pour parvenir à une telle
conclusion, les psychologues se sont intéressés au récepteur à
l'ocytocine l'hormone impliquée dans la confiance, l'empathie, la
générosité et la sexualité, dont le gène existe en plusieurs
variantes dans l'humanité. Ils ont alors séquencé le génome de 154
volontaires, puis leur ont demandé de juger les automobilistes dans
le dilemme exposé précédemment. Résultat: les porteurs d'une des
variantes génétiques du gène codant pour le récepteur à l'ocytocine
(l'allèle C) avaient tendance à être plus sévères avec les personnes
causant du tort de manière non intentionnelle! Bref, ils seraient
moins empathiques du fait de leur seule génétique et cela pourrait
peser sur leurs choix ...
RÉSEAUX NEURONAUX MALLÉABLES
Forcément, cette influence de notre
génome est l'un des arguments contre l'existence du libre arbitre
martèles par le neuro endocrinologiste américain Robert Sapolsky
(voir interview p. 78). La génétique affecte non seulement la
transmission des messages hormonaux mais aussi celle des messages
nerveux. C'est aussi elle qui détermine la structuration du réseau
de neurones lors du développe ment du système nerveux, avant et
après la naissance. Or, dans la compétition à laquelle se livrent
les groupes de neurones lors d'une prise de décision (voir p. 81),
cette structuration est essentielle. Reste que celle-ci n'est pas
figée: "La structure du cerveau est d'abord déterminée par un
substrat génétique mais par la suite, elle est plus ou moins
transformée par le développement", confirme Thomas Boraud, directeur
de l'Institut des maladies neurodégénératives. "Ainsi des vrais
jumeaux, dotés d'un programme génétique identique, peuvent
développer des personnalités et des maladies mentales différentes.
Par exemple, l'un peut devenir schizophrène. l'autre non", abonde
Kevin Mitchell, professeur assistant au Trinity College de Dublin.
Et pour cause: pendant le développement, la moindre fluctuation
suffit pour modifier la migration des cellules précurseurs des
neurones. En découlent alors des connexions inédites et un cerveau
sensiblement différent. Ce n'est pas fini: tout au long de la vie de
chaque individu, les souvenirs consolideront certains liens
neuronaux, en créeront d'autres, et feront disparaître ceux qui ne
sont pas stimules. Les apprentissages d'une langue, de principes
moraux, d'histoires ou les expériences marquantes, en particulier
les traumatismes, viennent ainsi renforcer certains de nos
comportements. Et peut-être même que le simple fait de le savoir en
ayant lu ces lignes influencera vos prochains choix.
FAIRE UN CHOIX, C'EST
INTEGRER UNE SOCIÉTÉ
Si nos raisonnements nous
engagent à chercher notre intérêt individuel, ils n'échappent pas au
poids du collectif.
Voici 3 . Vous pouvez les garder ou, si
vous le souhaitez, en faire don à une ONG. Que faites vous? Eh bien
tout dépendra ... du regard des autres! Si personne ne vous voit, il
y a de fortes chances que vous les empochiez, tandis qu'en présence
d'autres individus, vous serez plus enclin à les donner. C'est ce
qu'a démontre Keise Izuma, en 2008, à l'Institut des sciences
physiologiques d'Okazaki, au Japon. De quoi démontrer que nous
sommes toutes et tous constamment guidés par notre environnement
social. "Les relations qu'on a avec les autres influencent
énormément nos choix, confirme Fabio Galeotti, du Groupe d'ana lyse
et de théorie économique Lyon St-Étienne. À cause d'elles, nous
prenons des décisions qui peuvent parfois sembler irrationnelles, en
tout cas qui ne servent pas nos intérêts matériels."
TOUT DÉPEND DU PARTENAIRE
Ceci car des considérations qui ne
concernent plus notre propre physiologie entrent en compte: "Les
règles apprises, l'importance que l'on accorde à sa réputation, les
émotions qui surgissent dans nos rapports aux autres, etc.", liste
Sylvie Granon. Sous cette influence de la société, nos choix peuvent
même devenir si étonnants qu'ils défient la "théorie des jeux", une
hypothèse mathématique de prédiction des réactions. Voyez plutôt:
dans le jeu dit "de la confiance", une somme d'argent est confiée à
l'un des joueurs, nommé l'investisseur, qui peut choisir d'en donner
une partie à un autre individu. Or, s'il le fait, la somme
transférée est multipliée par dix et le partenaire peut en retour en
faire profiter l'investisseur à la hauteur qu'il décidera
l'opération peut donc s'avérer rentable pour celui qui a investi!
Bien entendu, tout dépend du partenaire; et la théorie mathématique
postule que l'investisseur n'a pas intérêt à donner s'il ne le
connaît pas et n'a aucune certitude sur ses intentions. Reste que la
pratique est bien différente: pour peu que les participants
possèdent un point commun, tout peut basculer: "On constate que plus
on a d'affinités avec le partenaire, parce qu'on supporte la même
équipe de foot par exemple, plus la somme partagée sera grande",
confirme Fabio Galeotti.
L'INFLUENCE DU NOMBRE
À cette influence de l'autre s'ajoute
encore l'influence du nombre. C'est ce qu'a montre Jean-Claude
Dreher, de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod à Lyon,
en 2017. Grace à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf),
le chercheur a sondé le cerveau de volontaires à qui l'on demandait
de statuer, comme des jurés, sur des affaires criminelles. Après
avoir rendu leur verdict, ceux-ci étaient alors informés de celui
des autres membres du jury, puis avaient la possibilité de réviser
leur jugement. Ce qui fut régulièrement le cas ... Or les images
cérébrales obtenues suggèrent qu'il ne s'agissait là pas d'une
simple imitation: une excitation importante du cortex fronto polaire
une zone qui traite les informations de la vie en société se
produisait dans le cerveau des jurés au moment du choix de rendre un
nouveau verdict. Selon Jean-Claude Dreher, cette région soupèserait
la crédibilité des informations don nées par les autres, une
information ensuite intégrée à la prise de décision, tel un
paramètre supplémentaire dont le poids dépend du degré de certitude.
Effectivement: plus les jurés étaient nombreux à rendre un verdict
différent, plus leur influence sur le nouveau choix était grande.
Nos convictions, aussi solides que nous les pensions, paraissent
soudain bien fragiles ...
VERS UNE NOUVELLE
CONCEPTION DU LIBRE ARBITRE
Entre facteurs
biologiques, socioculturels et inconscients, la liberté de choix
peut sembler réduite. Mais elle n'est pas illusoire pour autant.
Bye bye le libre arbitre ? Car après les
besoins physio logiques, le diktat des émotions, les conseils de
l'expérience ou encore le regard des autres, soit toutes les
influences qui s'agitent derrière chacune de nos décisions, quelle
place pourrait il lui rester? En fait, sa marge de manuvre, quoique
ténue, se nicherait bien entre toutes ces influences, estiment
certains chercheurs. Ce qui n'entrerait pas en contradiction avec le
déterminisme, une doctrine philosophique selon laquelle toute action
est strictement déterminée par une chaîne d'événements antérieurs.
"Il faut bien comprendre que le libre arbitre n'est pas la liberté
absolue de faire ce qu'on veut, sans contraintes, rappelle le
biologiste et philosophe Bernard Feltz, de l'Institut supérieur de
philosophie de l'UC-Louvain. Au contraire : le déterminisme dessine
les différentes voies du possible, et le libre arbitre naît
justement de la possibilité de choisir entre les options façonnées
par le champ des déterminations."
LA THEORIE DU CHAOS
Serge Ahmed, de l'université de
Bordeaux, pousse la réflexion plus loin encore et invite à
différencier deux niveaux de déterminisme: "Je considère que je suis
libre de mon choix si aucune cause externe ne me contraint à prendre
une direction précise. En revanche, mon choix va dépendre de mes
causa lités internes, mon passé, mon histoire, et même de ma
biologie." Bon. Mais nos contraintes internes ne seraient-elles pas,
elles aussi, de l'ordre du déterminisme? Pas sûr ... D'abord, à
mesure des avancées scientifiques, on s'aperçoit que la matière dont
nous sommes faits n'est pas aussi réglée que ce que les manuels
scolaires nous laissent croire. Après tout, à l'échelle
microscopique, le comportement de cette dernière s'affranchit des
règles de la mécanique classique pour embrasser le champ, peu
intuitif, de la physique quantique, où une particule peut être dans
deux états a la fois ... Le déterminisme s'envole alors : les mêmes
causes ne produisent plus nécessairement les mêmes effets. Il suffit
ensuite de remonter la chaîne: si le comportement des particules est
indéterminé, il y a donc une chance pour que celui des atomes, des
molécules, des organes et finalement des êtres le soit aussi. Mais
attention: "Qu'il y ait une part de hasard dans la causalité des
événements ne résout pas le problème du libre arbitre", conteste
Kevin Mitchell, professeur assistant au Trinity College de Dublin.
"Ce qui est important ici, c'est que si les liens de causalité et de
hasard ne suffisent pas à déterminer un événement, c'est qu'il reste
de la place pour le choix." Une autre particularité des systèmes
biologiques laisse la porte ouverte au libre arbitre: la théorie du
chaos. Illustré par le célèbre "effet papillon", qui postule qu'un
batte ment d'ailes de papillon sur la côte africaine peut provoquer
un cyclone aux Antilles, le chaos fait intervenir, sur une chaîne
d'événements considérée comme linéaire, des boucles de rétroaction
amplifiant certaines fluctuations et en annihilant d'autres, jusqu'à
provoquer des événements absolument inattendus et des changements
d'échelle.
SCIENCE RÉDUCTIONNISTE
Or quel meilleur endroit pour faire
naître le chaos que le cerveau humain, merveille de complexité? "Il
regorge d'interactions complexes et de boucles de rétroaction",
appuie Serge Ahmed. Au sein des fluctuations amplifiées par ce
désordre pourrait alors s'immiscer le libre arbitre. Hélas, pour
l'heure, ce phénomène échappe encore aux méthodes d'investigation de
la science, qui pèche par réductionnisme: un phénomène complexe est
souvent décrit en l'étudiant par "morceaux". Sous ce regard, la
biologie ne peut que rester le résultat de réactions chimiques, qui
elles-mêmes résultent de la physique des particules. "On est
pourtant obligé d'envisager qu'il y ait quelque chose de plus qui
émerge de la somme des parties: un phénomène mental qui, bien qu'il
soit dépendant de mécanismes sous-jacents, possède des propriétés
nouvelles", confie Serge Ahmed. Alors, en attendant de savoir si du
chaos, de l'effondrement de la causalité quantique ou d'un autre
phénomène encore, naît notre libre arbitre, il s'agit de faire un
choix: y croire ou pas.
|
 
CORALIE HANCOK -
Science & Vie
1278 - mars 2024
|
|
Depuis la
dernière évaluation de l'OCDE, en 2018, les scores des élèves
français ont reculé d'environ 4% en mathématiques et en français. Un
résultat qui corrobore l'impression d'une baisse de niveau générale,
que le gouvernement s'est fixé d'endiguer. Des spécialistes de
l'éducation analysent les mesures envisagées ...
CORALIE HANCOK |
|
LES 3
CHIFFRES A RETENIR
21
C'est le nombre de points perdus par les
élèves français en maths entre 2018 et 2022 aux évaluations
internationales Pisa. Leur moyenne est ainsi passée de 495 a 474.
En outre, 19 points ont été perdus en
compréhension de l'écrit, et 6 points en sciences.
7%
C'est la proportion d'élèves français
considères comme "très performants" en maths et en compréhension de
l'écrit. Ce taux grimpe à 41 % à Singapour pour les maths. A
l'inverse, 29% des élèves français se trouvent en grande difficulté
en maths, et 27% en français.
67%
C'est, parmi les élèves français ayant
passe les évaluations Pisa, la proportion de ceux qui ont étudie
dans des collèges ou l'enseignement a été, selon leurs chefs
d'établissement, entrave par un manque de professeurs. Ce taux
n'était que de 17,1% en 2018.
-3%
C'est la chute des résultats français
entre les évaluations Pisa passées en 2006 et celles passées en
2022.
Une tendance similaire à celle de
l'ensemble des pays de l'OCDE (-3,2%).
DES PERFORMANCES EN BAISSE
Moyenne des résultats aux tests Pisa en
France et dans les pays de l'OCDE entre 2006 et 2022.
OCDE (les 23 pays originaux) France
 |
|
Le
niveau des élèves français dégringole
"Les petits Français sont nuls en
maths"; "Ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent et ne savent
plus écrire" ...
Dans la bouche des politiques comme dans
les medias, cette rengaine revient régulièrement. Notamment chaque
fois que paraissent les résultats des évaluations internationales
mesurant les performances des enfants d'âge scolaire.
La dernière publication n'a pas fait
exception à la règle: le 5 décembre dernier, les résultats de
l'étude internationale Pisa (Programme for International Soudent
Assessment], qui mesure le niveau des élèves de 15 ans en
mathématiques, lecture et culture scientifique dans 81 pays ou
territoires de l'OCDE, ont de nouveau fait état des mauvais
résultats de nos élèves.
Ainsi, en mathématiques, leur moyenne a
baissé de 21 points par rapport à l'édition 2018 (passant de 495 en
2018 à 474 en 2022, soit une baisse de 4,2%), et ce alors qu'elle
avait été relativement stable entre 2006 et 2018.
La chute est presque aussi vertigineuse
en compréhension de l'écrit, qui choit de 19 points par rapport à
2018 (passant de 493 à 474], dans une tendance déjà à la baisse
depuis 2012. Les résultats en sciences sont moins dramatiques: 6
points "seulement" ont été perdus en 4 ans (passant de 493 à 487).
|
|
TOUS LES PAYS DE L'OCDE
SONT CONCERNÉS
Il faut l'avouer, la
chute est spectaculaire ... Certes, elle doit être relativisée: les
résultats des élèves français restent dans la moyenne des pays de
l'OCDE et sont très proches de ceux obtenus dans des pays
culturellement voisins -en mathématiques, la France a obtenu 474
points, contre 471 en Italie, 473 en Espagne et 475 en Allemagne.
Plus encore, le déclassement ne concerne pas que la France, la
tendance est à la baisse partout dans le monde.
Ainsi, entre 2018 et
2022, la moyenne des 35 pays de l'OCDE ayant participé aux deux
sessions a diminue de 15 points en mathématiques (472) et de 10
points en compréhension de l'écrit (476).
"Même si elle
n'explique pas tout, la fermeture des établissements scolaires
pendant la pandémie a indéniablement joue un rôle dans cette
dégradation globale du niveau des élèves", indique Eric Charbonnier,
analyste au sein de la direction de l'Éducation de l'OCDE. Toujours
est-il que la dégringolade de l'Hexagone est particulièrement
marquée.
Ce qui est prévu pour
l'endiguer? En fin communicant, le désormais ex-ministre de
l'Éducation nationale Gabriel Attal avait justement choisi le jour
de la publication des résultats Pisa pour annoncer les mesures qui,
selon lui, permettraient d'améliorer le niveau des élèves français
et de créer un "choc des savoirs".
Des mesures présentées
comme l'aboutissement de la mission Exigence des savoirs lancée
quelques semaines plus tôt et coordonnée, entre autres, par
Stanislas Dehaene, chercheur en neuropsychologie à l'Inserm et
président du Conseil scientifique de l'Education nationale (CSEN)
-mais qui ont fait bondir certains membres de ce même conseil et
conduit trois d'entre eux à la démission.
Parmi ces mesures,
deux ont particulièrement retenu l'attention du public et
cristallise les oppositions: le retour du redoublement et la
création de groupes de niveaux en mathématiques et en français
-c'est-à-dire la séparation des élèves en différentes classes selon
leur niveau.
|
|
LE REDOUBLEMENT EN DÉBAT
Si l'on en croit la
consultation lancée par le ministère, la première est relativement
populaire auprès de la communauté enseignante. Ainsi, 69,7% des
enseignants ayant participé à la consultation ont répondu "non" à la
question: "Pensez-vous que le redoublement est suffisamment
préconisé aujourd'hui pour les élèves en grande difficulté
scolaire?" Étonnamment, pourtant, "les pays les plus performants
dans les évaluations Pisa ne pratiquent pas, ou très peu, le
redoublement", souligne Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au
Laboratoire de mathématiques d'Orsay et viceprésidente de la Société
mathématique de France.
Les résultats de la
recherche menée sur cette question montrent de plus son
inefficacité: "Environ une dizaine de publications scientifiques ont
conclu que les bénéfices du redoublement sont nuls ou faibles,
confirme Julien Grenet, directeur de recherche au CNRS, professeur à
l'École d'économie de Paris et membre démissionnaire du CSEN.
Et lorsqu'ils
existent, ils sont non seulement transitoires -trois ou quatre ans
après, on ne les observe plus-mais aussi conditionnés à des mesures
de remédiassions fortes. Par exemple, en Floride, les élèves dont le
redoublement avait eu un effet positif faisaient 90 minutes de
lecture par jour, étaient suivis par des enseignants très qualifiés
et bénéficiaient d'heures de soutien supplémentaires."
Pire, le redoublement
peut avoir des effets négatifs, a la fois a court terme
-stigmatisation, baisse de la motivation et de l'estime de soie à
long terme. "Redoubler, c'est aussi entrer une année plus tard sur
le marche du travail, ce qui se traduit par une perte de revenus",
ajoute Julien Grenet.
JULIEN
GRENET Directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Ecole
d'économie de Paris
Une dizaine de
publications scientifiques ont conclu que les bénéfices du
redoublement sont nuls ou faibles
|
|
LE RISQUE D'AGGRAVER LES
INEGALITÉS
Le chercheur est aussi
très critique vis-à-vis des groupes de niveaux. D'abord parce qu'ils
risquent d'aggraver les inégalités. "Si l'on se base sur les tests
réalisés à l'entrée en 6e, 1 élève défavorise sur 2 se retrouvera
dans le groupe des élèves faibles, contre seulement 13% des élèves
favorisés", indique l'économiste.
Autrement dit, les
groupes de niveaux seront aussi des groupes de classes sociales.
"Par ailleurs, même si les résultats de la recherche sont moins
solides que sur la question du redoublement, ils tendent à montrer
que lorsque les groupes de niveaux sont constitues de façon rigide,
c'est-à-dire quand les élèves restent dans le même groupe toute
l'année, il n'y a pas d'effets positifs sur les forts et des effets
plutôt négatifs sur les faibles", ajoute Julien Grenet.
"Dans un groupe
faible, il n'y a plus d'émulation, d'apprentissage par les pairs. Or
on sait que les élèves apprennent mieux si les connaissances ne
viennent pas seulement des enseignants mais aussi des autres
élèves", renchérit Sébastien Planchenault, ancien président de
l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement
public.
En insistant sur la
dimension flexible des groupes et en utilisant la terminologie
"groupes de besoins" plutôt que "groupes de niveaux", le ministère
semble avoir entendu ces arguments.
"Sauf que, connaissant
la lourdeur du fonctionnement des établissements scolaires, le
risque est grand que les groupes restent identiques tout au long de
l'année ou que les changements de groupe ne se fassent qu'a la
marge", s'inquiète Sébastien Planchenault.
"Nous aurions préféré
une diminution du nombre d'élèves par classe, cela aurait permis aux
enseignants de faire de la différenciation pédagogique sans séparer
les élèves." À l'école élémentaire, le dédoublement des classes de
CP et CE1 -les effectifs y ont été plafonnés à 12 élèves par classe
dans les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+) a d'ailleurs
été une mesure phare du premier quinquennat Macron.
"C'est un dispositif
qui fonctionne assez bien, même s'il semble que les effets sont plus
importants à l'école élémentaire qu'au collège", indique Julien
Grenet. "
Il n'y a pas de
corrélation entre les résultats aux évaluations Pisa et le nombre
d'élèves en classe, tempère Eric Charbonnier. D'ailleurs, en Asie,
les classes sont souvent plus chargées et les résultats très bons.
Mais il faut reconnaître qu'il y a moins de problèmes de discipline
dans les pays asiatiques."
|
|
DES
CLASSES DE COLĻÈGE ENCORE TRÈS CHARGEES
En Europe, la France
est l'un des pays où les classes de collège sont parmi les plus
chargées -25 élèves, contre 21 en moyenne dans l'UE quand l'Estonie
et la Suisse, deux pays qui ont obtenu de très bons résultats aux
évaluations Pisa, sont à 19 élèves par classe. Parmi les autres
mesures annoncées en décembre, figurent également la modification
des programmes et la labellisation des manuels ..
Pour l'enseignement
des mathématiques, l'une des pédagogies souvent mise en avant est
"la méthode de Singapour", qui s'inspire de la façon d'enseigner
dans la cité-État. Il faut dire que ce petit pays d'Asie arrive en
tête a quasiment chaque évaluation internationale. "Les bons
résultats de Singapour ne s'expliquent pas nécessairement par leurs
méthodes pédagogiques, pointe néanmoins Sébastien Planchenault.
C'est en effet un petit pays très riche. L'hétérogénéité entre
élèves y est probablement moins grande et la pression scolaire mise
sur les enfants y est très forte."
"Il n'y a pas de
méthode miracle et encore moins si elle est imposée aux enseignants,
ajoute Mélanie Guenais. Ce qui fonctionne, c'est quand les
enseignants maîtrisent les objectifs mathématiques à transmettre et
utilisent une méthode avec laquelle ils se sentent à l'aise."
Stéphane Cyr, professeur de didactique des mathématiques à
l'université du Québec et titulaire d'une chaire Unesco spécialisée
dans l'étude des systèmes éducatifs, est moins catégorique. Son
pays, le Canada, obtient lui aussi de très bons résultats aux
évaluations Pisa, en particulier en mathématiques. "Je pense que
cela s'explique au moins en partie par le fait que les mathématiques
y sont présentées de façon moins austère qu'en France. L'accent est
davantage mis sur la résolution de problèmes concrets, indique le
chercheur. L'approche est aussi plus égalitaire : les mathématiques
ne sont pas utilisées pour séparer les bons des mauvais élèves ni
pour créer une élite, l'objectif étant que tous les enfants accèdent
aux mathématiques." Ce qui explique aussi probablement le moindre
écart entre élèves favorisés et défavorisés observé au Canada. Un
point de levier fait tout de même l'unanimité parmi les chercheurs
et enseignants interrogés: celui de la formation des enseignants et
de l'attractivité du métier.
"La méthode de
Singapour, c'est aussi 100 heures de formation continue par an pour
les enseignants, contre 3 jours obligatoires en France, cingle
Melanie Guenais. Leur salaire est aussi bien plus élevé et le métier
très valorisé. Outre les effets de la pandémie, la baisse des
résultats aux évaluations Pisa est également corrélée à un problème
de recrutement des enseignants. Même s'il s'observe dans d'autres
pays européens, il est très important en France."
|
| LA NÉCESSITÉ D'UNE VISION A LONG
TERME
Problème: parmi les
mesures du "choc des savoirs", aucune n'aborde ces questions. "On
assiste à une succession de mesurettes de rapiéçage qui attirent
l'attention, se diffusent vite et disparaissent presque aussitôt,
sans prendre le temps de traiter les problèmes structurels en maths,
lecture, valorisation du métier d'enseignant, etc. se désole Claude
Diebolt, économiste et directeur de recherche au CNRS.
Il faudrait une vision
concertée pour les décennies à venir."
Alors que le
portefeuille de l'Éducation nationale vient d'être confié à Amélie
Oudéa-Castéra,
également ministre des
Sports et déjà bien occupée par l'organisation des Jeux olympiques,
celle-ci pourra-t-elle avoir une vision a long terme et défendre la
cause de l'école? Son bulletin de notes nous parviendra ... sous la
forme des prochains résultats Pisa.
La baisse des
résultats aux évaluations Pisa est aussi corrélée à un problème de
recrutement des enseignants |
| La France, championne des inégalités
sociales
C'est le domaine où la
France bat des records : la différence de niveau entre les élèves
issus des classes socio-économiques favorisées et ceux issus des
classes défavorisées-au désavantage de ces derniers, bien sûr.
Ainsi, en 2022, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, l'écart moyen
entre leurs résultats était de 93 points en maths, contre 113 en
France! "Cela équivaut à une différence de trois et quatre années
d'acquis scolaires, souffle Nadir Altinok, spécialiste à
l'université de Lorraine. De façon assez contre-intuitive, les
inégalités sont plus fortes dans les pays sociaux-démocrates que
dans les pays anglo-saxons."Par exemple, en Irlande et au Canada,
l'écart entre les classes socio-économiques est inférieur à 76
points. |
|
Ministère vs recherche: quelles mesures pour améliorer le niveau ?
En décembre 2023, le
ministère de l'Education nationale a annonce mise en place de
mesures dans le but d'améliorer le niveau des élève français.
Problème : les chercheurs estiment qu'elles seront inefficace et en
réclament d'autres qui ont davantage fait leurs preuves.
|
|
Selon le ministère
Encourager les
redoublements
Le ministère veut "sortir d'une doctrine
de passage quasi-systématique en classe supérieure «et "rendre le
dernier mot aux professeurs «pour la prescription du redoublement.
Aujourd'hui, 10,8% des élèves français de 15 ans ont déjà redoublé
au moins une fois dans leur scolarité, contre 33 % en 1993.
Instaurer des groupes de
niveaux
À partir de la rentrée 2024, le
ministère veut organiser les cours de maths et de français en
groupes de niveaux flexibles tout au long du collège, avec des
effectifs réduits à une quinzaine d'élèves pour les groupes les plus
faibles".
Refondre les programmes
scolaires
Le ministère souhaite une modification
de tous les programmes scolaires entre la rentrée 2024 et 2026 ainsi
que la labellisation des manuels. En maths, les fractions et les
nombres décimaux seront par exemple abordés plus tôt "en favorisant
une approche concrète et imagée".
|
Selon les chercheurs
Diminuer le nombre
d'élèves par classe
La France est l'un des pays d'Europe où
les classes de collège sont parmi les plus chargées : 25 élèves,
contre 21 en moyenne dans l'Union européenne. Or la recherche montre
que la baisse des effectifs est corrélée à une amélioration du
niveau des élèves, surtout à l'école primaire.
Développer le soutien
scolaire
L'aide aux devoirs, les cours de
rattrapage en petits groupes ou la prise en charge par des
enseignants spécialisés permettraient d'améliorer le niveau des
élèves les plus faibles. En France, le ministère a bien mis en place
certains de ces dispositifs, mais dans des proportions moindres que
dans d'autres pays.
Repenser la formation des
enseignants
Une réforme de la formation initiale des
enseignants se trouve actuellement dans les tiroirs du ministère.
Les enseignants souhaiteraient également une meilleure formation
continue, avec notamment du temps dédié afin d'éviter que ces heures
n'empiètent sur leur temps de cours ou leur temps libre.
|
|
Des
résultats en baisse partout dans le monde
|
|
États-Unis
Mis à part en maths,
où les élèves ont perdu en moyenne 13 points entre 2018 et 2022
(passant de 478 à 465), les États-Unis sont l'un des rares pays de
l'OCDE dont les résultats Pisa ne varient que très peu depuis 15
ans.
France
Après une forte
remontée en compréhension écrite entre 2006 et 2012 (passant de 488
à 505 points), les résultats des élèves français, toutes matières
confondues, n'ont quasiment fait que baisser.
Albanie
Entre 2018 et 2022,
les résultats du pays se sont effondrés : -52 points en moyenne ! En
cause, principalement, un séisme en 2019 qui a provoqué de lourds
dégâts, notamment sur les écoles, obligeant jusqu'en 2022 les élèves
à étudier ailleurs avec des horaires réduits.
Japon
C'est l'un des rares
pays a s'être améliore entre les évaluations Pisa 2018 et 2022: +13
points en moyenne (passant de 520 à 533) ! Ceci grâce à une courte
fermeture des écoles pendant la crise du Covid et un enseignement à
distance très efficace, selon les chercheurs.
|
Qatar
Bien qu'en dessous de
la moyenne des pays de l'OCDE (478 points en 2022), les élèves
qataris sont ceux qui se sont le plus améliorés depuis 2006 : + 96
points en moyenne (passant de 326 à 422)!
Singapour
C'est le haut du
podium, comme quasiment à chaque session. Singapour doit notamment
son succès à l'état d'esprit et à l'investissement rigoureux de ses
enseignants, parmi les mieux rémunérés de l'OCDE.
ÉVOLUTION DES RÉSULTATS PISA
EN
FRANCE ENTRE 2006 ET 2022
Lecture
Maths Sciences

|
 
KHEIRA BETTAYEB
-
Science & Vie
1278 - mars 2024
|
|
Les
clés pour comprendre le sport chez les Français
KHEIRA BETTAYEB
Prés de 6 Français
sur 10 de plus de 15 ans font du sport régulièrement en 2023. Un
chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2018, qui traduit un
engouement certain pour l'activité physique depuis le Covid,
conjugué à la diversification de l'offre sportive et de ses
modalités d'accès.
Dans quelques mois,
le monde entier aura les yeux rives sur la France et les J.O. de
Paris 2024. Mais le sport n'est pas réserve qu'aux athlètes ! Alors
que le président Emmanuel Macron a récemment incite tous les
Français a faire "au moins 30 minutes de sport par jour", qu'en
est-il vraiment de notre activité physique ? En décembre 2023,
l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep)
a publie son 4e Baromètre national des pratiques sportives 2023,
réalisé par le Credoc. Menée auprès de 4 000 Français, l'enquête
révèle le profil des sportifs de 2023 ainsi que leurs sources de
motivation et les disciplines les plus plébiscitées. Ses conclusions
?
"Nos chiffres
montrent une évolution marquée des pratiques, note Amélie Mauroux,
cheffe de la mission enquêtes à l'Injep.
Le sport à
domicile, qui a décolle pendant le Covid, s'est maintenu à un niveau
élève et est donc confirme. Les activités hors structures sportives
-encadrées par des applications ou sur internet et à la télévision -
ont, elles aussi, augmenté. "
Décryptage.
1
Les
Français sont sportifs !
59%
déclarent faire du sport régulièrement
11%
occasionnellement
30 %
jamais
Plus de la moitie
des citoyens feraient du sport régulièrement : et la majorité de
leurs séances durerait plus de 45 Min
2
Les
pratiques sont variées
31%
Course et marche
22%
Activités de la forme et gymnastique
10%
Sports de cycle ou motorisés
10%
Sports aquatiques ou nautiques
7%
Sports collectifs
5%
Sports de raquettes
2%
Sports d'hiver ou de montagne
31%
ne pratiquent pas de sport
28%
ne pratiquent qu'un sport
19%
pratiquent deux sports
23%
pratiquent trois sports
Les sports les plus
prises sont la marche et la course à pied. En club, la l° place
revient au football.
|
3
...
et ont de plus en plus d'adeptes
Ages
en années

Notamment les
sports "doux" et faciles d'accès, davantage adaptes aux 40 ans et
plus (marche, yoga, etc. ).
4
Les
possibilités ont augmenté ...
Comment les Français font du sport
DANS
UNE STRUCTURE
21%
Avec un club ou une association
9%
Dans des centres de remise en forme, de fitness ou de gymnastique
HORS
STRUCTURE
56%
Vie une pratique autonome (non encadrée)
7%
Avec une application (Zwift, Strava, Garmin Connect, Trainingeaks,
etc...)
4%
Par des cours assurés via interne ou la télévision
3%
Selon les instructions d'un Youtubeur ou en suivant des tutoriels
sur internet
Applications, cours
en ligne, influencer ... De nos jours, les moyens de faire du sport
sont plus nombreux, ce qui permet de s'affranchir de certains freins
: couts, contraintes professionnelles ou familiales, horaires
imposes, manque d'offres de proximité, activités inadaptées a son
niveau, etc.
5
...
et la principale motivation reste la Santé
52%
LA SANTE
34%
LA DETENTE
29%
L'AMELIORATION DE L'APPARENCE
"L'activité
physique protège de l'obésité, du diabète, des maladies
cardio-vasculaires et du cancer", rappelle Martine Duclos, médecin
du sport.
|
 
CORALIE HANCOK -
Science & Vie
1277 - février 2024
|
|
Éducation à la sexualité : l'école doit mieux faire
Contraception, IST, consentement ... Nombre d'experts
estiment qu'il est essentiel d'éduquer les enfants à la sexualité le
plus tôt possible.
Or, malgré la législation qui prévoit un enseignement
tout au long de la scolarité, la France accuse un retard important.
Le Conseil supérieur des programmes planche sur le sujet.
PAR CORALIE HANCOK |
|
C'est un sujet qui
traîne sur la table de Gabriel Attal depuis son arrivée au ministère
de l'Éducation nationale : l'été dernier, son prédécesseur Pap
Ndiaye avait officiellement demande au Conseil supérieur des
programmes (CSP) d'élaborer un projet d'éducation à la sexualité
depuis le cours préparatoire jusqu'a la terminale. Or, au moment ou
nous écrivons ces lignes, le CSP n'a pas encore rendu ses
propositions : les enseignants ne disposent donc pas de programme
officiel a cet enseignement, a l'exception des notions sur le corps
humain et la reproduction incluses dans les cours de sciences.
L'éducation sexuelle est pour tant censée être enseignée à l'école,
et ce, depuis la circulaire Fontanet, qui date de 1973 ... Avec
l'apparition du sida, d'autres ont suivi. Puis, en 2001, les
parlementaires ont introduit dans la loi sur l'IVG et la
contraception un article spécifique rendant obligatoire au moins
trois séances annuelles dans les écoles, les collèges et les lycées.
OBLIGATION LÉGALE
Vingt-trois ans plus
tard, et en dépit de nombreuses autres circulaires et décrets ayant
confirmé et précisé cette obligation légale, force est de constater
que l'éducation a la sexualité reste trop peu dispensée dans les
établissements.
En septembre dernier, un baromètre réalise par
l'institut de sondage OpinionWay auprès de 2 148 jeunes de 16 à 20
ans révélait que ces derniers n'avaient reçu en moyenne que 3,2
séances sur la totalité de leur parcours scolaire ...
En 2016, un
rapport du Haut conseil a l'égalité montrait que, sur 3 000
établissements scolaires interrogés, 25 % n'avaient mis en place
aucune action ni séance particulière. Et en juillet 2021, un rapport
émanant de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche, indiquait que seuls 13,5 % des élèves de primaire, 18,2 %
des collégiens et 13,1% des lycéens avaient bien bénéficié, en
2020-2021, des trois sessions prescrites par la loi.
Pourtant, l'éducation à
la sexualité a fait ses preuves.
"En termes de santé publique, elle
permet de répondre aux questions liées à la reproduction, à la
contraception, à l'IVG ou à la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles (IST), énumère Frederic Galtier,
sexologue et formateur au sein de l'Instance régionale d'éducation
et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Or les sondages réalises
par Sidaction montrent que les connaissances des 15-24 ans sur le
VIH décroissent d'année en année." Des lacunes que pourrait combler
ce type de programme : dans une méta-analyse de l'université
américaine Johns Hopkins publiée en 2014, les auteurs concluent que
les adolescents ayant suivi à l'école des cours d'éducation à la
sexualité ont une meilleure connaissance du VIH et se sentent
davantage capables d'exprimer leur non-consentement. Ils ont aussi
permis d'augmenter de 34 % l'usage du préservatif et - contrairement
aux idées reçues -de repousser l'âge des premiers rapports chez les
adolescents.
GROSSESSES PRECOCES
Aux Etats-Unis, où le
Département de santé finance depuis 2009 une revue sur la prévention
des grossesses adolescentes, un rapport publie en avril 2023 montre
que, sur 18 nouveaux programmes identifies, au moins 7 ont eu un
effet favorable sur l'utilisation de moyens de contraception.
Enfin, les Pays-Bas -
qui ont mis en place d'ambitieux programmes d'éducation sexuelle
depuis des années - sont parmi les pays enregistrant le moins de
grossesses précoces : 3 adolescentes (de 15 a 19 ans) néerlandaises
sur 1000 donnent naissance a un enfant chaque année, contre 8 en
France, 11 au Royaume-Uni et 17 aux États-Unis (source Unicef,
2019).
Des chiffres qui s'expliquent notamment par un meilleur
recours à la contraception : 11 % seulement des adolescents
néerlandais n'en avaient pas utilisé lors de leur dernier rapport,
contre 26 % des jeunes français. Et selon l'OMS, entre 2015 et 2019,
le taux d'IVG tous âges confondus était deux fois plus faible aux
Pays-Bas (7/1 000 femmes de 15 à 49 ans) qu'en France, (14/1 000).
Évidemment, ces enjeux
concernent bien plus les lycéens que les écoliers ; alors pourquoi
vouloir commencer des le CP ? Les enfants s'interrogeant sur la
sexualité dès le plus jeune âge, il est primordial de les éduquer le
plus tôt possible. "Le problème, c'est que, très souvent, la
sexualité est trop reliée à la génitalité et aux relations entre
adultes.
Lorsqu'un jeune enfant
demande comment on fait les bébés, ce qui l'intéresse, ce n'est pas
comment les adultes ont fait pour le concevoir mais pourquoi et
comment il est né", souligne Sonia Lebreuilly, sexologue et
éducatrice en santé sexuelle.
"À 5 ans, une
explication qui parle d'amour entre un papa et une maman qui donnent
chacun une petite graine suffit à satisfaire leur curiosité, assure
Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre et professeur émérite à l'Université
catholique de Louvain, en Belgique. Mais l'éducation à la sexualité,
c'est bien plus qu'expliquer les différences entre le corps des
garçons et celui des filles, ou comment on fait les bébés. Ainsi, je
pense que le terme même d'éducation à la sexualité est trop
restrictif : l'un des objectifs de l'école, c'est aussi de former
des citoyens, de leur inculquer des valeurs fondamentales comme le
respect de soi et des autres."
|
Ce que confirme la
sexologue Véronique Baranska :
"L'éducation sexuelle, c'est tout simplement une éducation à la vie,
au vivre ensemble.
C'est
aussi apprendre aux enfants quels sont leurs droits."
Dans ce cadre, on peut,
des la maternelle, aborder la question du consentement, par LE DROIT
DE DIRE "NON" exemple en leur expliquant qu'ils n'ont pas le droit
de toucher les fesses de leurs camarades ou de faire un bisou à
quelqu'un si celui-ci n'est pas d'accord, et qu'ils ont aussi le
droit de les refuser. "De telles séances participent a la lutte
contre les violences sexuelles et les incestes, avance Sonia
Lebreuilly.
Si les enfants ne savent
pas nommer leurs parties intimes ou s'ils ne s'autorisent pas a dire
non aux adultes, ils ne peuvent ni se défendre contre les violences
qu'ils subissent ni même les reconnaître ou les dénoncer."
L'éducation à la
sexualité permet également d'informer les enfants sur des sujets
sociétaux : "Notamment l'égalité des genres et la lutte contre les
discriminations : une éducation sexuelle efficace, ça serait moins
de féminoïdes et moins de LGBT-phobie", estime Veronique Baranska.
"Lutter contre les
discriminations sexuelles, c'est aussi déconstruire les stéréotypes
de genre. On peut tout a fait, des la maternelle, faire réfléchir
les enfants aux métiers dits masculins ou féminins", ajoute Frederic
Galtier.
Au collège, la question
de la pornographie peut également être abordée.
Alors qu'un enfant de 12
ans sur trois a déjà été confronté à des images pornographiques, de
nombreuses craintes se font entendre quant a leur impact sur les
comportements des jeunes. "Il n'y a pas de preuve réelle que le
porno augmente les violences sexuelles. En revanche, les entretiens
que nous avons mènes auprès des jeunes montrent une influence claire
sur l'image du corps : puisque les pornos plaisent aux garçons, les
filles se disent que leur corps doit correspondre a ceux que l'on
voit dans ces films, autrement dit qu'elles doivent être minces,
avoir de gros seins et être intégralement épilées, énonce Arthur
Vuattoux, maître de conférences en sociologie à l'université Paris
13. Déconstruire ces images véhiculées par le porno, c'est aussi
lutter contre les dysmorphophobies - les pensées obsédantes sur des
prétendues imperfections physiques - et les troubles alimentaires
induits."
MANQUE DE
MOYENS
Dans ces domaines,
toutefois, les preuves d'efficacité des programmes d'éducation à la
sexualité se font plus rares. "Il arrive que des enfants dénoncent
les violences sexuelles qu'ils subissent à l'issue de ces séances
... ou plusieurs mois après", indique Sonia Lebreuilly.
Difficile, dès lors,
d'établir avec certitude un lien de cause à effet. "D'un point de
vue empirique, les instituteurs font en tout cas état d'un climat
plus apaisé en classe", pointe la sexologue.
Mais alors, compte tenu
de ces nombreux enjeux, comment expliquer que l'éducation sexuelle
n'ait pas trouve sa place a l'école ? "Il y a d'abord un manque de
moyens et un gros déficit de formation. Et puis les enseignants sont
parfois gênés d'aborder ce sujet et peuvent craindre les réactions
des parents", souffle Sonia Lebreuilly.
"Peut-être aussi que
trois séances par an, ce n'est pas une si bonne idée : les
enseignants doivent céder une heure de cours pour qu'elles aient
lieu et l'animation retombe presque toujours sur les infirmières
scolaires, explique Frédéric Galtier. Il y aurait sans doute plus
d'adhésion de la part des élèves et moins de crispation de la part
des parents si l'éducation sexuelle était abordée de façon
transdisciplinaire. Par exemple à travers des textes sur l'amour en
français, des travaux sur la représentation du corps dans la
publicité en cours d'arts plastiques, des notions sur le respect et
l'égalité en histoire et en éducation civique, etc." Les
propositions du Conseil supérieur des programmes iront-elles dans ce
sens ? Réponse bientôt ...
|
|
Les trois volets d'une
bonne éducation à la sexualité
L'approche biologique
si l'on peut parler d'anatomie et de
physiologie dès la maternelle, les questions autour de la
reproduction et de la puberté sont généralement enseignées à la fin
du primaire et au début du collège.
La contraception et les infections
sexuellement transmissibles sont, elles, abordées a la fin du
collège et au lycée.
Les approches
psychoaffective et sociale
Ici, c'est le point de vue de l'individu
sur la sexualité qui est aborde : les 'émotions et les sentiments,
ainsi que les notions de consentement, d'orientation et d'identité
sexuelles. Mais ce champ s'ouvre également à la question de la
sexualité dans la société, à travers la lutte contre les
discriminations, le harcèlement et les violences sexuelles et
sexistes.
|
3,2
C'est, en moyenne, le nombre de séances
d'éducation sexuelle que les jeunes Français de 16 à 20 ans ont reçu
au cours de leur parcours scolaire, selon un sondage réalisé par
OpinionWay en 2023. La loi en prévoit pourtant trois par an
42%
C'est le taux de garçons de 16 a 20 ans
(29 % pour les filles) qui, d'âpres le même sondage, regardent du
porno pour en savoir plus sur le sexe. Selon le gouvernement, près
d'un tiers des enfants de 12 ans ont été exposés à la pornographie.
26 %
C'est, parmi les ados français
sexuellement actifs, la part de ceux qui n'avaient utilise aucune
contraception lors de leur dernier rapport, selon une étude
internationale de 2018, contre 16 % en Allemagne, 11 % aux Pays-Bas
et 8 % au Danemark.
SOURCES: OPINIONWAY - HEALTH BEHAVIOUR
IN SCHOOL-AGED CHILDREN |
|
L'éducation sexuelle, c'est une éducation à la vie, au vivre
ensemble. C'est aussi apprendre aux enfants quels sont leurs droits
VERONIQUE BARANSKA
Sexologue et infirmière formatrice au CHU de Dijon
En revanche, comme on
part des questions des enfants, certains peuvent raconter qu'ils
aiment bien toucher leur zizi/zézette. On va alors les rassurer :
c'est un comportement normal mais qui se fait dans les lieux
d'intimité."
|
Faut-il
avoir peur des dérives ?
Parce qu'ils sont juges
contraires aux valeurs familiales et/ou religieuses, certains
contenus (contraception, explication de l'homosexualité ... )
rencontrent l'opposition de parents.
Opposition parfois
exacerbée par des rumeurs telles que celle, récente, d'un soi-disant
apprentissage de la masturbation a la maternelle.
Les standards européens
pour l'éducation sexuelle publies en 2010 par l'OMS évoquent bien la
"masturbation enfantine précoce", "mais on n'apprend évidemment pas
aux enfants a se masturber, rassure Sonia Lebreuilly.
|
 
Lise GOUGIS -
Science & Vie
1275 - décembre 2023
|
|
L'empathie peut-elle
vraiment s'apprendre à l'école ?
Pour lutter contre le harcèlement, le
gouvernement souhaite développer l'empathie chez les élèves à
travers des cours. Il s'inspire pour cela de programmes déjà
éprouvés à l'étranger. Sauf que de simples cours pourraient ne pas
suffire, le rapport à l'autre étant aussi déterminé par le système
éducatif dans son ensemble.
PAR LISE GOUGIS
Les enfants étant scolarisés de plus en
plus tôt, la sensibilisation aux émotions doit se faire a l'école -
OMAR ZANNA Sociologue à l'université du Mans
La mesure a fait lever quelques sourcils
: en septembre dernier, le gouvernement a annonce l'arrivée de cours
d'empathie au programme scolaire, en maternelle et primaire, dès la
rentrée 2024. L'objectif ? Sensibiliser et lutter contre le
harcèlement scolaire, un fléau qui a encore provoqué le suicide d'un
lycéen dans les Yvelines début septembre. Ce drame rappelle
l'effarante et difficile réalité qui pèse sur notre système éducatif
: le harcèlement toucherait entre 800 000 et 1 million d'enfants
chaque année, soit prés de 10 % des élèves, selon un rapport du
Senat publié en 2021. Alors pour le combattre, le gouvernement veut
plus d'empathie à l'école. "L'empathie, c'est à la fois la capacité
de reconnaître les émotions des autres - ce que l'on appelle
l'empathie cognitive - et celle de ressentir ce que l'autre ressent
et y apporter une réponse adaptée - que l'on nomme l'empathie
émotionnelle", explique Thomas Bourgeron, qui dirige l'unité
Génétique humaine et fonctions cognitives à l'Institut Pasteur.
RIEN DE FIGÉ
Mais l'empathie peut-elle
véritablement s'apprendre ? Sans conteste, il y a une part de
génétique dans cette faculté, qui semble innée au sein de l'espèce
humaine. En analysant le génome de 46 000 personnes ayant passe un
test d'empathie, une équipe internationale de chercheurs, dont
Thomas Bourgeron, a constaté qu'environ un dixième des variations du
niveau d'empathie entre les individus s'expliquait par les gènes.
"Cela signifie qu'il peut être plus complique pour certains de
reconnaître les émotions des autres et leur manifester de
l'empathie, explique Thomas Bourgeron. Mais attention, ce n'est pas
parce que c'est en partie génétique qu'on ne peut rien y faire : ce
n'est pas fige " Et ce n'est pas rien de le dire. Avoir seulement
conscience que notre empathie n'est pas figée suffirait à influencer
nos comportements : "Des travaux américains suggèrent que, parmi des
individus ayant un faible niveau d'empathie, ceux qui considèrent
que cette faculté est malléable ont plus de chances de déjouer leurs
comportements agressifs futurs que ceux qui pensent que c'est une
compétence fixe", pointe Violaine Kubiszewski, maître de conférences
en psychologie à l'université de Franche-Comté. Surtout, avoir une
prédisposition génétique à l'empathie n'offre pas la garantie de
devenir une personne empathique. "Si la disposition n'est pas
entraînée, elle peut s'étioler", affirme Omar Zanna, sociologue à
l'université du Mans.
SENSIBILISATION
Plus que la génétique, l'empathie
est largement influencée par des facteurs environnementaux, en
particulier la famille. Une étude publiée en octobre par des
chercheurs de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, a montre
que les enfants qui étaient proches de leurs parents à l'âge de 3
ans manifestaient plus d'empathie, de gentillesse et de générosité à
l'adolescence.
Le type d'activités pratiquées a aussi
son importance. " En racontant des histoires à nos enfants, nous
leur permettons de se projeter dans la peau des personnages, si bien
qu'ils apprennent progressivement a comprendre l'autre, pointe Omar
Zanna. Cela dépend donc aussi du milieu social - tout le monde n'a
pas le temps de lire des histoires à ses enfants ni les moyens de
les emmener au cinéma ou au théâtre."D'ou le rôle majeur du système
éducatif : "Comme les enfants sont scolarisés de plus en plus tôt,
ce temps de sensibilisation aux émotions qui se faisait surtout à la
maison devrait pouvoir maintenant être réalisé à l'école", poursuit
le spécialiste.
PAR LE CORPS
C'est donc certain : l'empathie peut
s'apprendre, a fortiori à l'école. Mais comment l'enseigner ? "Il ne
s'agit pas de donner un cours d'empathie comme on donne un cours de
maths, décrit Omar Zanna. L'empathie se développe par le corps, dans
le cadre d'interactions." Dans cette optique, le sociologue a
imaginé le jeu des mousquetaires, utilisé en prison avec des mineurs
délinquants avant d'être décliné dans des écoles de la Sarthe.
|
Le principe ? Les élèves sont répartis
en équipes de quatre joueurs. Trois d'entre eux prennent une
position physique difficile à tenir, souvent en équilibre. Le
quatrième doit réussir à repérer celui sur le point de flancher et
le remplacer, au risque de faire perdre son équipe. En plus de ce
jeu, une multitude d'autres approches ont été expérimentées a
l'étranger, notamment dans les pays scandinaves. Ainsi, la France
entend s'inspirer du programme danois "Fri for Mobberi" ("Libéré du
harcèlement" en français), lancé en 2005 et adopté par environ la
moitié des crèches et des écoles pour les enfants de 0 à 9 ans.
MÉTHODES PROBANTES
Cette méthode consiste à développer
l'empathie chez les petits via des activités pratiques, comme
commenter des images montrant des situations de harcèlement. Selon
la Ligue de l'enseignement qui gère le programme en France, "au
Danemark, 70 % des professionnels trouvent que les enfants sont plus
bienveillants les uns envers les autres âpres avoir commence a
travailler avec le programme". Et d'âpres une étude sur l'impact du
programme en 2017, les enfants qui le suivent seraient plus aptes a
gérer les conflits par eux-mêmes et feraient plus preuve d'empathie
envers les autres. Au Canada, le gramme l'empathie", mis en place en
1996 dans les écoles défavorisées de Toronto, consiste à faire venir
une mère et son bébé dans les classes de primaire. "Au fil des
rencontres, les élèves sont sensibilises au développement du
nourrisson et a son état profondément interdépendant. Ils apprennent
a prendre soin d'un être vulnérable, à déchiffrer ses besoins, ses
émotions", détaille Charles-Antoine Barbeau-Meunier, sociologue a l'universite
canadienne de Sherbrooke.
"Les études menées sur ce programme ont
montré qu'il favorise bien le développement de l'empathie en classe,
poursuit le sociologue. Il est associe à un déclin de la violence et
du harcèlement, à une diminution du décrochage scolaire, et à une
augmentation du sentiment d'appartenance et de la solidarité, se
traduisant notamment par une hausse des comportements présociaux ."
Alors, améliorer l'empathie des élèves serait la panacée pour lutter
harcèlement scolaire ? Eh bien oui, il semblerait ! "Des données
empiriques suggèrent des liens entre la propension des témoins à
défendre leurs camarades harcelés et leur niveau d'empathie,
souligne Violaine Kubiszewski. De même, la propension à s'en prendre
à des camarades est souvent associée à des niveaux d'empathie moins
élevés. " Pour autant, ne mettre l'accent que sur cette faculté
serait insuffisant, précise la chercheuse. "L'empathie est une
compétence socio-émotionnelle parmi d'autres - comme la maîtrise de
soi, qu'il serait tout aussi intéressant de développer à l'école. "
De plus, des travaux menés ces dernières années indiquent que, chez
un même individu, l'expression de l'empathie varie selon le contexte
dans lequel il se trouve. "Si une personne qui a un bon niveau
d'empathie se retrouve dans un environnement ou tout transpire la
bienveillance et l'acceptation de l'autre, il y a de grandes chances
que cela se traduise dans ses comportements. À l'inverse, si elle
est placée dans un contexte de compétition et de rejet fréquent de
l'autre, il est moins probable que son empathie s'exprime - les
comportements étant également modèles par les normes sociales",
illustre la chercheuse.
SYSTÈME GLOBAL
Pour Omar Zanna, c'est précisément
ce qui fait la différence entre les systèmes éducatifs français et
danois. "Au Danemark, l'école est basée sur la coopération entre les
élèves, et ces derniers n'ont pas de notes avant leurs 14-16 ans.
Tandis qu'en France, les notes sont présentes très tôt et les élèves
sont souvent inscrits dans des logiques de compétition." Le
classement PISA 2018 met le doigt sur cette différence éducative :
dans l'Hexagone, seuls 45 % des élèves ont déclare coopérer entre
eux dans leur établissement, contre 81% des petits Danois. "C'est
une part importante de l'éducation au Danemark, au même titre
qu'apprendre à lire ou compter. Ainsi, une heure par semaine, les
élèves peuvent exposer les problèmes de toutes sortes qu'ils
rencontrent, et toute la classe essaye d'y trouver une solution",
illustre Jessica Alexander, spécialiste de l'éducation danoise. "Je
suis convaincue que c'est l'une des raisons pour lesquelles le pays
a l'un des plus hauts niveaux d'empathie au monde, mais aussi l'un
des plus faibles taux de harcèlement scolaire."
La méthode "Fri for Mobberi" est
actuellement expérimentée à petite échelle dans des écoles
maternelles d'Île-de- France. Une étude d'impact devrait être
publiée d'ici a la fin 2024. Les attentes sont maigres, mais ne
jugeons pas trop vite ... Ayons un peu d'empathie. 12 mois C'est
l'âge a partir duquel un bébé développe de l'empathie. C'est-a-dire
quand il commence a apprendre a reconnaître les émotions sur le
visage des autres. Cette faculté se construira ensuite jusqu'a ses 7
ans. 40 % C'est la baisse du niveau d'empathie des étudiants
américains entre la génération des années 1970 et celle des années
2000, selon des travaux de l'université du Michigan en 2010.
D'autres études montrent que l'empathie tend à baisser avec l'âge.
22e C'est, sur 63 pays, le rang de la France dans le classement du
niveau d'empathie établi en 2016 par des chercheurs américains. La
1re place revient a l'Equateur, tandis que la Lituanie fait figure
de lanterne rouge.
|
|
3 façons d'apprendre
l'empathie
Repérer un camarade en
position difficile
Dans le jeu des mousquetaires, déjà
expérimenté dans les écoles primaires de la Sarthe, les élèves
forment des équipes de 4, et 3 d'entre eux prennent des positions
difficiles a tenir, comme la chaise ou la planche. Le 4e a pour
mission de repérer celui qui se trouve en passe de lâcher et de le
remplacer, toute chute étant synonyme de défaite de l'équipe.
Reconnaître les
situations de harcèlement
La méthode danoise "Fri for Mobberi",
repose sur des discussions pédagogiques avec les élèves et des
activités pratiques, telles que commenter des images montrant des
situations de harcèlement. Un ours en peluche, qui sert aux petits
de mascotte, est aussi mis a leur disposition quand ils ont besoin
de se confier ou de réconforter un camarade.
Déchiffrer les émotions
d'un nourrisson
La méthode "Racines de l'empathie", mise
en place en 1996 dans les écoles d'un quartier défavorisé de
Toronto, au Canada, consiste a faire venir une mère et son
nourrisson dans des classes de primaire. Au cours des 9 rencontres
qui s'échelonnent sur l'année scolaire, les élèves apprennent a
prendre soin d'un être vulnérable et a déchiffrer ses émotions.
|
 
Lise GOUGIS -
Science & Vie
1271 - aout 2023
|
 |
 
Lise GOUGIS -
Science & Vie
1272 - septembre 2023
|
 |
 
C'EST LUI QUI EST AU COMMANDE !
Anne
DEBROISE -
Science & Vie
1265 - février 2023
|
|
 |
 
Lise GOUGIS -
Science & Vie
1258 - juillet 2022
|
|



|
 
Yves SCIAMA -
Science & Vie
1257 - juin 2022
|
|
 |
 
Yves SCIAMA -
Science & Vie
1255 - mars 2022
Ecologue
forestière Suzanne SIMARD |
|
 |
 
Etienne THIERRY-AYME
-
Science & Vie
1245 - juin 2021 |
|
Voiture
intelligente
Freinage
automatique d'urgence, régulateur de vitesse, régulation adaptative

Extraits |
 
Pierre-Yves BOCQUET
-
- Science & Vie
- Hors Série - Octobre 2018
|
|
OSER LA RUPTURE
Pierre-Yves BOCQUET
Relever deux défis majeurs.
La voiture électrique pour la pollution chronique.
La voiture autonome pour la sécurité.
Sans oublier le rapport charnel et émotionnel qui nous lie à la
voiture.
Tout l'écosystème automobile, de la production à l'utilisation qui
est en mutation.
Bienvenue dans la nouvelle ère automobile !
Voitures électriques et autonomes
Vers un grand big
bang historique
Ce n'est pas seulement une nouvelle offre : c'est une
rupture historique avec le moteur thermique et l'art de conduire.
Toute l'industrie va devoir se réinventer.
|
|
VOITURE PROPRE
Voiture électrique
Hugo Leroux
La grande illusion (batterie
polluante VS une grande autonomie) |
|
OBJECTIF ZERO MORT ?
Muriel Valin
Notre cerveau : premier frein à la Sécurité Routière
Plus un conducteur se sent protégé, plus il prend des
risques.
Tel est le paradoxe mis en lumière par les travaux en psychologie.
Et qui explique que la mortalité routière ne baisse
plus, malgré les mesures prises.
Ce qui est à la mode c'est de vouloir rendre l'humain
parfait. Mais c'est voué à l'échec (Marc Camiolo - Sociologue du
risque - Lab Lorrain)
La belle leçon suédoise : prise de conscience des
usagers.
Faire varier les limites en fonction des tronçons,
des saisons et de la météo afin de réaliser du sur-mesure...
La commission européenne a proposé, en plus de cibler et de
réaménager les routes dangereuses, d'équiper les nouveaux modèles de
voitures de dix-neuf dispositifs de sécurité, notamment le freinage
d'urgence automatisé et l'aide au maintien de la trajectoire. |
|
Voiture autonome
Pierre-Yves Bocquet
Quand l'informatique écrit l'histoire de l'automobile.
Comme si la voiture autonome, à vouloir se passer de l'homme,
oubliait ce dernier dans son équation. |
|
PILOTAGE AUTOMATIQUE
Les accidents sèment le
doute
Etienne Thierry-Aymé
Importance de confronter son modèle au réel.
S'assurer que les données recueillies soient justes.
Je préfère un système qui me dise "je ne sais pas où je suis" à un
autre qui "pense" être au bon endroit au bon moment. (Philippe Xu). |
|
Un permis pour l'I.A. ?
Pauline Martin
Prendre les bonnes décisions au bon moment, tel est le pari
technologique de la voiture sans pilote. Mais peut-on apprendre
l'aléa à une machine ?
L'I.A. mise sur les réseaux de neurones et le "deep learning".
Objectif : passer le pemis.
Pour gérer les cas complexes, l'algorithme fait appel à la "logique
floue". |
|
Congestion urbaine
Brice Perrin
Vers la fin du tout-voiture.
Autrefois symbole de liberté et de mobilité, l'automobile est de
plus en plus décrié en milieu urbain.
La fin d'un règne sans partage : un rééquilibrage de l'espace public
et le développement d'alternatives semblent inexorables.
A Paris, la vitesse moyenne effective culmine à... 15 km/h
Pollution, congestion, occupation de l'espace, perte de temps...
C'est un fait, l'automobile cumule désormais les handicaps.
Le vélo, prochaine panacée ?
Une piste cyclable coûte 200 fois moins qu'une autoroute, 50 fois
moins qu'un métro et 25 fois moins qu'un tramway.
Dans la même logique : véhicule électrique portable.
L'infrastructure doit s'adapter pour offrir une place à chaque
usager.
(Par exemple : en Chine, des montagnes de vélo en libre service). |
|
Réinventer la route
Alexandra Pihen
Exit le bitume : pour se mettre au diapason des voitures électriques
et autonomes, les routes s'annoncent plus vertes et connectées. |
|
Dans S&V 02578 page 50 :
véhicules hybrides : comportement des conducteurs : étude hollandais
TNO : 30% du temps normalement attendu seulement car les
utilisateurs oublient de recharger les batteries.
|
 
Alexandra PIHEN -
Science & Vie 1241 - Février 2021
|
|

 |
 |
 
Vincent NOUYRIGAT
- Science & Vie
1241 -
02-2021
|
|

|
 
Hugo
LEROUX - SCIENCE & VIE 1240 -
12-2020 |
|

|
 
Lise GOUGIS -
SCIENCE & VIE
1236 - Aout 2020
|
|
 |
 
Pierre-Yves BOCQUET
- SCIENCE & VIE HS
|
|

 |
 
Pierre-Yves BOCQUET - HORS SERIE - mars 2020
|
|

|
Elle optimise vos trajets
Tout le monde connait les applis qui permettent de calculer des
itinéraires – Waze, Google Maps, Viamichelin ou Mappy. Derrière leur
apparente simplicité, ces services sont basés sur des algorithmes
d’IA très performants, capables de trouver leur chemin parmi le
grand nombre de trajets possibles d’un point A à un point B, en
tenant compte du trafic…
Elle prend le volant à votre place
Avec les voitures autonomes, les constructeurs ambitionnent de
réduire drastiquement le nombre de morts sur les routes. Remplacer
le conducteur par un algorithme, renseigné sur la circulation par
une armada de radars et de caméras, permettrait en effet de
supprimer tous les aléas liés aux faiblesses de l’être humain. A
condition toutefois que les algorithmes parviennent de leur côté à
corriger les imperfections que leur nature informatique leur
confère, liées à l’imprévisibilité et à l’opacité des réseaux de
neurones qui les font fonctionner.
Elle prédit les accidents de la route
En agrégeant les données du trafic, la cartographie routière, l’état
de l’infrastructure, la météo, l’heure, les évènements exceptionnels
(travaux, match de foot, manifestation…) l’IA est capable de prévoir
le risque d’accident à chaque instant. Et donc d’identifier en temps
réel les portions routières les plus à risque. Ce qui permet ensuite
de développer des politiques de prévention adaptée. Ce type de
solution pourrait être utilisée dans les voitures autonomes, mais
aussi pour informer les conducteurs.
|
 
Pierre-Yves BOCQUET - HORS SERIE - mars 2020
|
|

|
Elle fait du sur-mesure en classe.
Dans un contexte de manque de moyens chronique, qui induit des
programmes identiques pour tous, "l'IA permettrait d'envisager un
enseignement plus personnalisé, avec un algorithme qui traque les
résultats de chaque élève, exercice par exercice, pour mieux comprendre
les concepts sur lesquels il bloque, et pouvoir ainsi conseiller
l'enseignant sur les points précis à renforcer avec chacun", détaille
Yoshua Bengio, de l'institut Québécois d'intelligence artificielle.
|
 
Yves SCAMIA -
SCIENCE & VIE 1230 - 03-2020
|
|

 |
 
Peur des Maths ?
Hugo LEROUX -
SCIENCE & VIE
1230 - mars 2020
|
 |
 
Coline BUANIC -
SCIENCE & VIE
1230 - mars 2020
|
|

|
 
Keyra BETTAYEB -
SCIENCE & VIE
1230 - mars 2020
|
|

|
 
Vélos partagés : l'inévitable tragédie des
biens communs ?
Emmanuel MONNIER -
SCIENCE & VIE -
09 2019
|
|
Garés avec la selle ou les freins cassés, abandonnés
la roue voilée... les Vélib' et autres véhicules partagés sont
vandalisés ä un point tel que leur gestion en est plombée. Un signal
peu encourageant pour la "société du partage"... Quels sont les
ressorts de ces comportements, et pourquoi certains systèmes, eux,
fonctionnent? |
|
Les vélos partagés ont tout d'une bonne idée pour désengorger et
dépolluer les villes. Las, le vandalisme massif subi par ces
deux-roues en libre-service menace de faire dérailler les projets.
Et les mêmes incivilités ont été observées en Belgique, Italie,
Chine...
Faut-il s'en
étonner ? Après tout, pourquoi prendre soin d'un bien qui ne vous
appartient pas, si cet effort ne vous rapporte rien ? Question
vitale pour l'avenir de cette "société du partage" dont on
prophétise l'avènement.
L'écologue Garrett
Hardin, de l'université de Californie, prédisait en 1968 la
dégradation inévitable de toute ressource partagée en libre accès.
Il prit pour cela l'exemple d'un pré que des éleveurs partagent pour
faire paitre leurs troupeaux. L'intérêt de chacun est d'y mener un
maximum de bêtes. Sauf que chaque bête supplémentaire consomme le
pâturage et le dégrade. Résultat? La surpopulation détruit le pré et
conduit ä la ruine de tous. Un funeste enchainement que Hardin avait
qualifié de "tragédie des communs". Serait-ce le destin des Vélib'
et de toute ressource partagée ? Pas si sûr.
Elinor Ostrom, Prix
Nobel d'économie 2009, a démontré que de nombreux biens (forêts,
pêcheries, cultures...) ont au contraire été durablement gérés en
commun. A condition que certaines règles aient été édictées, avec
des sanctions, même faibles, pour ceux qui ne coopéraient pas.
Ostrom observait que, plutôt que chercher à maximiser son profit
personnel, chacun faisait le plus souvent passer l'intérêt de la
communauté avant le sien.
Pourquoi?
"L'origine de la coopération" est l'une des grandes questions de la
biologie de l'évolution souligne Jean-Baptiste André, qui l'étudie
au département d'Études cognitives de l'Ecole normale supérieure.
"L'être humain a une capacité à coopérer vraiment spécifique."
SOIGNER SA
RÉPUTATION
Dès 15 mois, les
enfants rejettent une répartition inéquitable, même si elle ne les
lèse pas. Ce qui semble a priori incompatible avec la logique
darwinienne. On comprend que les fourmis se sacrifient pour la
fourmilière : comme elles ont les mêmes gènes que la reine, sa survie
favorise leurs propres gênes. Ou qu'une lionne s'associe à d'autres
pour attraper une proie.
Mais en quoi ressentir le besoin de prendre
soin de biens partagés favorise-t-il la survie de nos gênes ?
Pour Jean-Baptiste
André, le mot-clé est la "réputation" : "Ces comportements
s'expliquent par un mécanisme dans lequel j'ai un intérêt à
coopérer.
|
Parce que cela me donne une bonne réputation, qui va me permettre
d'être plus souvent choisi comme partenaire et d'en tirer des
bénéfices sociaux." Coopérer serait donc bien, sur le long terme, un
comportement gagnant. "Lorsqu'un ami vous demande de l'aider, si
vous refusez il va s'en souvenir. Il ya un coût social important.
Cet égoïsme ne sera
pas mortel en soi. Mais lorsque Homo sapiens vivait en petits
groupes, celui qui était rejeté du clan ne survivait pas longtemps.
Une pression constante a donc favorisé ceux qui étaient les mieux
acceptés par les autres. C'est-à-dire ceux qui coopéraient et
avaient ainsi bonne réputation.
Voilà qui éclaire
certains succès de l'économie du partage : nous coopérons d'autant
plus que cela se sait. "Airbnb, BlablaCar ou eBay ont mis en place
des systèmes de réputation qui se révèlent très efficaces. Saccager
un appartement est risqué parce que la plate-forme met en ligne tous
les commentaires. Dans le cas du Vélib', c'est l'anonymat qui a fait
la différence", constate Vincent Malardé, spécialiste de l'économie
collaborative ä l'université Rennes 1.
QUESTION DE
CONFIANCE
"Le paramètre-clé,
pour ces plates-formes qui mettent en relation des gens qui ne se
connaissent pas, c'est de créer de la confiance confirme Thierry
Pénard, professeur d'économie ä l'université Rennes 1. Or il n'y a
contrat réciproque que si les tricheurs sont démasqués et
sanctionnés. "Quand vous partagez un vélo, si vous savez que les
autres n'en prennent pas soin, cela augmente la probabilité que vous
fassiez de même", explique Stéphane Debove, docteur en psychologie
évolutionnaire. D'ailleurs, les enquêtes montrent que la France ou
la Chine sont justement des pays où la confiance dans les autres est
en moyenne plutôt faible.
"Je ne serais pas
étonné qu'on trouve une corrélation entre ce niveau de confiance
dans les autres et le degré de vandalisme, avance Thierry Pénard. Il
suffit qu'une minorité d'utilisateurs ne soient pas coopératifs pour
que la confiance se dégrade très vite. "D'où l'importance de la
renforcer, en dissuadant d'une part ceux qui ne voudraient pas jouer
le jeu, mais aussi en faisant disparaitre toute trace visible de
vandalisme.
Les biologistes
nous préviennent: il n'y a pas de coopération s'il y a impunité. Et
il n'y aura pas d'économie du partage réussie sans contrôle social
institutionnalisé. Avec tous les risques que cela comporte pour les
atteintes à la vie privée.
|
 
Thomas
Cavaillé-Fol
- SCIENCE
& VIE 1223 - 08-2019
|
|
THEORIE DE LA BETISE
Notre esprit, loin d'être insondable, fonctionnerait de façon
totalement superficielle !
Quid, alors des notions de convictions, de personnalité,
d'inconscient ?
Avec la théorie de l'esprit plat de Nick CHATER, tous nos biais
cognitifs s'expliquent enfin !
Il se focalise uniquement sur l'attention.
Il ne fait qu'interpréter à la volée.
Il fait illusion grâce à sa vitesse d'exécution. |
|
INTROSPECTION
NOTRE MOI INTERIEUR EST UNE ILLUSION DE L'ESPRIT
Notre cerveau est si rapide à expliquer
nos pensées qu'il arrive à nous faire croire qu'elles sont ancrées
au fond de nous
LA BÊTISE RETROSPECTIVE
En dépit de la masse de souvenirs qui nous
appartiennent, nous privilégions les dernières informations
disponibles. Il est donc courant de délaisser nos souvenirs
lointains pour ne se focaliser que sur l'instant.
LA BÊTISE DE CONFIRMATION
Les informations qui vont dans le sens de
l'histoire que l'on se raconte et qui expliquent notre comportement
vont apparaître clairement à l'esprit tandis que celles qui entrent
en contradiction avec lui seront mises de côté. Et si ces
informations atteignent tout de même la conscience, elles seront
dédaignées, sous-évaluées.
LA BÊTISE DE COHERENCE
Pour donner une cohérence à notre
comportement, nous sommes prêts à l'interpréter massivement, et même
à modifier nos croyances, nos souvenirs et à en occulter d'autres.
Notre esprit peut faire surgir en un instant n'importe qu'elle
justification à nos actions !
LA BÊTISE D'ANCRAGE
La première interprétation ou la première
impression s'ancre durablement dans le temps. Difficile de prendre
en compte les informations suivantes et de se débarrasser d'un
ancrage mental bien établi, même en dépit de la raison. |
PERCEPTION
C'EST L'ESPRIT QUI NOUS TROMPE SUR NOS SENS
A trop vouloir nous offrir un monde
cohérent, notre esprit nous leurre sur nos capacités de
perception... et nous sommes assez bêtes pour le croire
LES BÊTISES DE LA PERCEPTION
Cette illusion d'une perception parfaite
et d'une imagination aux mille détails génère des comportements
stupides.
LA BÊTISE DE SURCONFIANCE
Non seulement nous pensons voir beaucoup
plus que ce que nous voyons en réalité... mais nous surestimons en
plus nos capacités et nos connaissances ! Plus encore, moins nous
possédons de données, plus nous avons tendance à les interpréter, et
plus nous croyons avec conviction en notre propre "expertise"...
LA BÊTISE DE SURFOCALISATION
Il est très utile, lorsque nous conduisons
par exemple, de ne se focaliser que sur ce qui est important et
d'ignorer tout signal sans intérêt.
Revers de cette surfocalisation : c'est
elle qui fait que l'on se cogne contre un poteau quand on est fixé
sur l'écran de notre portable. Et elle peut même devenir
incontrôlable en cas d'addiction.
LA BÊTISE DE SURINTERPRETATION
C'est elle qui est responsable des
premières impressions, qui nous font, par exemple, juger
d'intelligence d'une personne sur la seule base de son physique...
Cette interprétation insatiable est aussi la source du phénomène
psychologique qui nous fait voir un visage dans un nuage.
|
 
|
|
|
Définition de l'intelligence par
le psychologue Howard Gardner :
Le potentiel de mobiliser des
informations dans un contexte culturel pour résoudre des problèmes ou créer des
choses et des concepts ayant une valeur dans cette culture. (SCIENCE &
VIE) |
 
SCIENCE & VIE -
Octobre 2015 |
|
Dans l'article il est écrit :
- nos états d'esprit se superposent
- nos jugements interfèrent
- nos pensées peuvent s'intriquer
- nos perceptions oscillent
quantiquement
Des expériences sont là pour le
montrer.
|
 
Emmanuel Monnier - SCIENCE & VIE 1181
|
|
LE BONHEUR
DANS L'ADN, LES CELLULES, LE CERVEAU...
MAIS OU SE CACHE-T-IL ?
A quoi tient le
bonheur ? Tout le monde le cherche, mais où se cache-t-il ?
Dans la famille,
l'argent, l'amour... comme la plupart d'entre nous nous en semblons
convaincus.
Sauf que ces
"joies" de l'existence ne durent pas.
Par ailleurs,
certains semblent plus facilement heureux que d'autres.
Une certitude, la
quête du bonheur est câblée en nous.
Dans notre
cerveau, dans nos gênes, dans les rouages de notre corps, dans
l'évolution de notre espèce, qui a fait du bonheur une aptitude à
part entière.
Un bonheur
qui se cache... en nous
Tout se passe comme si chacun avait un
niveau fixé de bonheur vers lequel il retourne plus ou moins, quoi
qu'il fasse (Daniel Nettle - Université Newcastle RU)
Neurobiologistes, généticiens,
biologistes : le bonheur se cache au croisement des mécanismes
cérébraux du plaisir, du désir et de la représentation du futur.
Le cerveau humain n'est sensible qu'aux
comparaisons
Où se cache le
bonheur ?
Dans
l'ADN, des gènes y prédisposent
Une
nouvelle génétique du bonheur
|
Rien de
définitif pour la vie
L'importance de l'environnement
Faire
soi-même son bonheur ?
Où se cache
le bonheur ?
Dans le
cerveau, des circuits spécifiques l'activent
Se réjouir
de ce que l'on va vivre
Circuits
primitifs du désir
L'action
sans le jugement
Où se cache
le bonheur ?
Dans le
corps, des signaux biologiques lui sont dédiés
Une
question d'hormones... mais pas seulement
On peut
agir sur notre bien-être
Le bonheur, un avantage évolutif ?
Les
neurobiologistes : motiver la quête de nourriture et, ainsi, assurer
la survie de notre espèce.
On vision
utilitaire du bonheur
Une
émotion communicative
Programmé
pour être insatisfait
|
 
Vincent Nouyrigat -
SCIENCE & VIE 1187
|
|
Vous avez dit complot ?
Nos cerveaux programmés pour y croire
Pourquoi notre cerveau voit des
complots partout
Le
système fronto-temporal gauche se joue des probabilités
Le
cortex temporal médian jongle avec les causalités
Le
carrefour temporo-pariétal perçoit des intentions partout
L'amygdale réagit aux situations anxiogènes
Le
cortex préfrontal médian se méfie d'autrui
Le
cortex préfrontal droit surinterprète chaque détail
Le
cortex préfrontal biaise notre opinion
Pour notre cerveau, les moindres
détails font sens.
Nous croyons repérer des intentions
partout.
Notre esprit doute des coïncidences.
Notre cerveau se méfie à l'excès des
inconnus.
Nous associons des grandes causes aux
grands chocs.
Les situations anxiogènes modifient nos
perceptions.
Notre système cognitif s'enferme dans
ses propres croyances.
Comment faire la part des choses ?
Des
théories qui ont envahi la culture populaire...
...
et sont amplifiées par internet
Chercher à démontrer seulement que ces théories sont fausses ne
fonctionne pas.
Il
faut être conscient de nos biais cognitifs et des pièges de notre
intuition.
Le triple impact du complotisme : sanitaire, social et
environnemental.
|
 
Anne
Debroise - SCIENCE
& VIE 1191
|
|
Quand l’éthique défie la technique
Que fera la voiture autonome quand elle ara le
choix entre percuter un bus scolaire et s’envoyer dans le décor,
avec ses passagers ?
La question intéresse depuis quelque temps les
psychologues.
Enquête auprès des constructeurs de voitures et
de pilotes automatiques.
La question est plus compliquée que ce qu’ils
veulent bien reconnaître.
Les véhicules conduisant à notre place sont
voués à déferler.
Question : en cas d’accident imminent, comment
leurs logiciels réagiront-ils ?
Qui sauveront-ils ?
Qui écraseront-ils de préférence ?
Selon quels algorithmes, écrits en amont ?
Anne Debroise est allée poser la question aux
constructeurs. Car leur choix sera aussi moral.
Contexte :
Depuis août 2016, la France autorise sur ses
routes le test de prototypes de voitures sans chauffeur – sous
supervision humaine permanente. Dans le viseur, des véhicules 100%
autonomes, capables de prendre des décisions cruciales en cas de
danger.
Le dilemme du tramway revisité
Un véritable enjeu commercial
Un défi éthique qui devient technique
Tous les accidents ne seront pas évités
En conclusion
La voie prônée par les constructeurs pour
s’affranchir des questions éthiques en faisant la preuve d’une
sécurité irréprochable s’avère donc très étroite.
D’autant plus que la transition vers les
voitures totalement automatisées ne se fera pas sans heurt.
Les individus, face à une situation critique ne
font pas de choix. Tout va si vite que le cerveau humain n’a pas le
temps de raisonner : il freine par réflexe.
Ironique renversement des choses : nous
demandons aux machines de répondre à des questions que nous ne nous
posons pas.
La rapidité de calcul des logiciels de conduite
des voitures autonomes ouvre ni plus ni moins un nouveau champ de
questionnements éthiques, inexistant jusqu’ici.
Asimov nous avait prévenus : l’avènement des
robots est aussi, et peut-être avant tout, un bouleversement d’ordre
moral.
|
 
T-L H - SCIENCE & VIE 1196
|
|
LE RAPPEL DES FAITS
Depuis le 22 mars, la loi rend le
port du casque à vélo obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans, conducteurs ou passagers.
La France est le 26° pays à adopter
ce type de législation.
S'il est déjà recommandé depuis
longtemps, le port du casque à vélo est maintenant obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou
passagers. Sur le site du ministère de l'Intérieur, la mesure est
justifiée par la volonté d’encourager l'apprentissage du vélo,
excellent pour la santé comme pour la qualité de l'air.
Pourtant, la majorité des
associations de promotion du cyclisme ont toujours exprimé leur
désapprobation face à une telle mesure coercitive, arguant que ce
type de décision n'améliore pas la sécurité des usagers à vélo.
Mieux PROTÉGER LA TETE
Certains estiment même que le port
du casque modifie le comportement des cyclistes : se sentant en
sécurité, ils font moins attention et finissent par être impliqués
dans plus d'accidents.
Que dit la science sur la question?
De nombreuses études se sont
intéressées à l’efficacité du casque en tant que protection, et à sa
capacité à réduire les blessures à la tête. L'année dernière, dans
une méta analyse qui recensait plus de 64000 blessures de cyclistes
à travers le monde, le mathématicien Jake Olivier a montré que le
port du casque permet de réduire les risques de blessures à la tête
de 51 %. Et la réduction est encore plus marquée pour les blessures
sévères et fatales (69 % de réduction dans les deux cas).
Pas de doute : le casque réduit bel
et bien les risques de se blesser.
Oui, mais d'autres études montrent,
en parallèle, que l’efficacité des lois sur le port du casque est,
elle, beaucoup moins probante.
UN PROBLÈME DE VISIBILITÉ
Une étude de Kay Teschke datant de
2015 s'est intéressée au cas du Canada, où seules certaines
provinces disposent de lois d'obligation. Résultat: il y a autant de
blessés à la tête dans les provinces avec et sans législation. Le
signe que le casque modifie le comportement des cyclistes? L’étude
montre en tout cas que les accidents de la circulation impliquant un
vélo diminuent dans les provinces où cette pratique est plus
répandue. Un phénomène de “sécurité par le nombre" déjà pointé par
plusieurs autres travaux: plus les cyclistes sont visibles, plus on
fait attention à eux.
L'obligation du port du casque à
vélo n'est pas une si mauvaise idée, juge Jake Olivier, mais elle
doit s'inscrire dans une stratégie globale de réduction des risques. Seule, elle risque d'être
inefficace.
Parmi les autres mesures à mettre en
place figure notamment le développement d'infrastructures dédiées à
la pratique du vélo.
Kay Teschke recommande ainsi des
pistes cyclables séparées physiquement du trafic routier. Il est à
noter que les deux pays dans lesquels les cyclistes sont les plus
nombreux, les Pays-Bas et le Danemark, n'ont pas de loi sur le port
du casque.
|
 
Kheira Bettayeb
-
SCIENCE & VIE 1197
|
|
Non, internet ne nuit
pas au cerveau
Consultation de mails à toute heure,
envois de tweets en rafales, messages permanents sur Facebook tout
en regardant la télé. En quelques années, la grande majorité d'entre
nous s'est vue happée par les immenses possibilités
d'ultra-communication et d'ultra information offertes par internet.
74 % de la population française y accède quotidiennement, pour une
durée moyenne de 18 heures par semaine.
Evidemment, ce n'est pas la première
fois qu'une nouvelle technologie de la communication s’immisce dans
notre quotidien.
Mais jamais aucune ne s'est propagée
aussi vite en une génération à peine ! et aussi largement.
“L’omniprésence d'internet et des
nouveaux médias numériques constitue un changement de société
majeur. Cela aura forcément des impacts sur notre cerveau ”,
commente Francis Eustache, au laboratoire Inserm Neuropsychologie et
neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, à Caen.
Au point “de réorganiser nos
encéphales? “Non, il est peu probable que l'usage d'internet modifie
le câblage même de notre cerveau et que l'on voie apparaître, par
exemple, une nouvelle aire cérébrale dédiée au Net. En effet, les
facultés mises à contribution par son usage (vision, lecture...) ne
sont pas nouvelles", précise Jean Philippe Lachaux, spécialiste de
l’attention au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
LA SCIENCE PREND
DU RECUL
“En revanche, cette pratique
modifiera forcément le fonctionnement du cerveau, avec par exemple
une mobilisation différente des processus neuronaux impliqués dans
la mémoire ou la concentration ”, prévient le chercheur. Mais les
possibles effets de notre vie hyper connectée seront-ils forcément
négatifs pour nos facultés cognitives ? Dès l'émergence du Web dans
notre vie, plusieurs chercheurs l'ont pointé du doigt et des études
ont montré que ce nouvel outil pourrait affaiblir notre mémoire,
diminuer notre attention, réduire nos performances intellectuelles,
ou encore favoriser des troubles du comportement comme la
dépression, le narcissisme ou l’insociabilité.
Oui, mais voilà, plus le temps passe
et plus la science prend du recul.
Désormais, plusieurs chercheurs
déplorent le caractère exagéré de ces inquiétudes, compte tenu des
données scientifiques existantes", souligne le neurobiologiste Kep
Kee Loh (Institut cellules souches et cerveau, Inserm, Lyon), auteur
d'un article publié fin 2016, intitulé “Comment l'internet a t’il
transformé la cognition humaine ?”. Après enquête, il s'avère même
que, par certains aspects, internet pourrait se révéler très
bénéfique pour notre cerveau.
Prenons le cas de la mémoire. Le web
ne l'affaiblit pas toujours. Pourtant, l'une des craintes les plus
fortes vis à vis d'internet et des réseaux sociaux est qu'à force de
compter sur eux pour trouver une information au lieu de faire
l’effort de la mémoriser, nous finirions par apprendre et surtout
par retenir moins d’informations. C’est ce que la psychologue
américaine Betsy Sparrow a appelé "l'effet Google".
Or, surfer sur le Net pourrait en
réalité augmenter les performances de l'une des composantes de notre
mémoire: la mémoire de travail visuelle. C'est elle qui permet de
stocker et de manipuler des images perçues à court terme, Cela
aurait pour résultat de nous permettre de suivre plus d'objets en
même temps sur un écran (30 % en plus, selon certaines études). En
effet, plusieurs travaux sur des joueurs de jeux vidéo suggèrent
qu'être exposé à des activités multitâches ce qui est le cas quand
on surfe sur interne test associé à une meilleure mémoire visuelle.
UN BON “EFFET
GOOGLE
Pour Patrick Lemaire, docteur en
psychologie à l'université d'Aix Marseille, comme pour un nombre
croissant de chercheurs, “l'effet Google” doit être relativisé : “Il
se peut effectivement qu'on intègre moins d'informations de façon
intentionnelle. Mais on n'a pas attendu l’arrivée du web pour ne
plus apprendre par cœur la liste des départements français! De plus,
mémoriser moins d’informations de façon volons taire ne va pas faire
disparaît recette faculté. Enfin et surtout, on continue à stocker
des informations de façon non intentionnelle. Or, au moins 80 % de
ce qui estrans notre mémoire à long terme - prénoms, dates
anniversaires, etc.- A été stocké via ces apprentissages non
intentionnels.
”Pour notre cerveau, il existe aussi
un effet collatéral bénéfique à ces économies sur la mémorisation.
“S’appuyer sur la technologie en tant que source de mémoire externe
permet dé libérer des ressources cognitives supplémentaires pour
d'autres opérations prioritaires, comme la réflexion ou la prise de
décision ”, explique Kemp Klee Loh.
De quoi renforcer toutes nos
capacités cognitives? L’hypothèse est confortée par des observations
réalisées dans le cas du vieillissement cognitif. “Nous savons que
celui-ci peut-être contré par des activités cognitives de haut
niveau, comme le raisonnement ou la communication, ou l'exposition à
des contenus culturels diversifiés et nombreux, explique Patrick
Lemaire, Or, toutes ces situations sont potentiellement favorisées
par internet et les réseaux sociaux. ”
Une étude américaine parue en 2009
suggère ainsi que la recherche d'informations sur internet pourrait
réduire le vieillissement cognitif chez les seniors. L'équipe du
psychiatre Gary Small (université de Californie) a observé, grâce à
la technique d'IRMf, le cerveau de 24 adultes âgés de 55 à 78 ans
utilisant (fréquemment ou non) internet. Résultat: “Lors de tests de
recherches sur internet, les personnes in expérimentées présentaient
une activation cérébrale similaire à celle se produisant lors de la
lecture sur papier. En revanche, le groupe habitué au Net a montré,
lui, une augmentation significative d'activité dans des régions
supplémentaires contrôlant la prise de décision, le raisonnement
complexe et la vision: cortex frontal, région temporelle antérieure,
hippocampe...”, précise GarySmall. D'où l'idée que le Net pourrait
aider à améliorer les fonctions de raisonnement et de prise de
décision chez les seniors.
Les réseaux sociaux constitueraient
aussi une aide pour les plus jeunes.
Des travaux menés sur 100 étudiants
et publiés en 2014 par le psychologue toulousain Jean François
Bonnefon et ses collègues suggèrent qu'à court terme, les réseaux
sociaux ont un effet positif pour la prise de décision.
Dans une expérience en cinq étapes,
les volontaires, mis en réseau, ont pu trouver la bonne solution à
un problème mathématique; surtout, le réseau a permis la propagation
de ce résultat exact parmi les utilisateurs...
Ces contagions de résultats sont
intéressantes pour la prise de décision, “à condition d'apprendre
par la suite comment arriver par soi même à Ia bonne réponse, pour
ne pas être dépendant des réseaux sociaux ”, précise ce pendant Jean
François Bonnefon.
“SWITCH”
ATTENTIONNEL
Enfin, l'une des idées le plus
largement répandues à propos de notre hyper connexion, c'est qu'elle
éroderait nos capacités à focaliser notre attention. “L'attention
est un processus biologique qui a évidemment ses limites", insiste
le neuroscientifique Jean Philippe Lachaux. Oui, mais "certaines de
ces limites peuvent être partiellement dépassées, et nos capacités
attentionnelles augmentées via des apprentissages ”, rétorque
Patrick Lemaire. C'est le cas, par exemple, lorsque nous apprenons à
conduire: au début, nous devons faire attention à chaque fois que
nous passons une vitesse; puis, peu à peu, les gestes s'automatisent
et nous les effectuons sans réfléchir. Dans le cas d'internet, “à
force d'effectuer certaines tâches en ligne, il est possible que
nous parvenions également à les automatiser; ce qui nous permettrait
d'avoir plus d'attention pour d'autres activités et d'en réaliser
plusieurs en parallèle, comme discuter avec une personne en face de
soi tout en répondant de temps à temps à des messages instantanés ”,
poursuit le chercheur marseillais.
Internet pourrait également
améliorer la flexibilité attentionnelle, un mécanisme de l'attention
qui permet de passer d'une activité à une autre en restant
concentré. En effet, “il est très probable qu'à force de 'switcher'
fréquemment lors de la navigation sur internet ou sur les réseaux,
nous augmentions encore une fois, dans une certaine mesure
I’efficacité des mécanismes de 'switching' attentionnel ”.
En fait, “seul un mauvais usage
d'internet et des réseaux sociaux, notamment leur utilisation à
forte dose, pourrait poser problème, recadre Patrick Lemaire. Il
faut arrêter de se faire peur avec internet, notre cerveau a
finalement beaucoup de choses à en attendre ”.
Des réseaux qui rendent plus
sociable ? Facebook et les autres réseaux sociaux limitent-ils les
contacts “réels”? Une enquête réalisée par Olivier Martin et Eric
Dagiral à l’université Paris Descartes indique tout le contraire, du
moins chez les jeunes encore étudiants. lls ont analysé l’usage de
Facebook de 1 102 étudiants de 18 à 25 ans. ll en ressort que ce
réseau social favorise et enrichit en fait leur sociabilité !
Les discussions y sont souvent le
prolongement d'échanges entamés dans la “vraie” vie. “Plus de 9
jeunes sur 10 utilisent Facebook pour organiser leurs activités ou
discuter avec des proches vus dans la journée”, précisent les
sociologues.
|
 
H.P. - Juillet 2018 |
|

|
 
Kheira Bettayeb
-
SCIENCE & VIE 1198
|
|
Les 4 avis
scientifiques que personne ne suit
Parmi ses premières mesures, le
président Emmanuel Macron a annoncé vouloir permettre aux communes
qui le souhaitent de revenir sur la réforme des rythmes scolaires de
2013.
Si cette perspective a ravi plus
d'un élu, d’autres ont vu d'un mauvais œil ce “retour en arrière",
jugé dommageable pour les enfants. Car tous les spécialistes ne
cessent de le répéter: l’organisation du temps scolaire répond
toujours plus aux exigences socio économiques et politiques qu'aux
rythmes biologiques de l'enfant (c’est à dire aux fluctuations,
imposées par l'horloge biologique, de son degré d'éveil, de son
attention, de ses capacités cognitives ou de sa mémorisation).
La réforme Peillon a tout de même eu
le mérite de tenter pour la première fois !de faire en sorte que les
horaires de l’école tiennent compte de ces rythmes biologiques.Mais
elle a laissé de côté certains points qu'il était pourtant crucial
de revoir...
Quels changements faudrait-il opérer
dans les aménagements des temps scolaires qu'ils soient plus adaptés
aux besoins des enfants? Pour y voir plus clair, nous avons analysé
différentes études sur les rythmes biologiques des enfants, et
demandé l'avis de plusieurs spécialistes des rythmes biologiques et
psychologiques.
Une enquête sensible, car les
rythmes scolaires intéressent différents lobbies, et les avis des
scientifiques divergent sur certaines questions. Cependant, un
consensus se dégage sur quelques points importants.
Voici quatre recommandations à
adopter. si l’on veut enfin tenir compte de l'intérêt des enfants.
1 - SCOLARISER LE
SAMEDI MATIN PLUTOT QUE LE MERCREDI
Tous les scientifiques s'accordent
sur le fait que la semaine de 4.jours et demi est une meilleure
option que celle de 4 jours à laquelle pourraient revenir un certain
nombre de communes en septembre 2018. Car elle permet une meilleure
répartition des vingt-quatre heures scolaires obligatoires par
semaine, et allège ainsi chaque journée.
Lors de la réforme de 2013, plus de
98% des communes ont opté pour le mercredi matin, plus adapté à la
société actuelle, habituée au samedi matin vaqué. Certains experts
(comme le psychophysiologiste Hubert Montagner) estiment que cette
option est la meilleure. Notamment parce qu'’elle éviterait, selon
eux, “une rupture du rythme de vie des enfants ”, et assurerait
ainsi une continuité dans la semaine, “source de stabilité ”. Or,
pour de nombreux scientifiques, l’explication ne tient pas: “Si l'on
suit cette logique, il faudrait aussi scolariser le samedi et le
dimanche matin ”, raille la chronobiologiste et psychologue Claire
Leconte (université Lille 3). De fait, deux rapports scientifiques
antérieurs à la réforme de 2013, l'un de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm), l'autre de l'Académie de
médecine, privilégiaient clairement le samedi matin. Une option
encore défendue par beaucoup d'experts. Et pour cause : plusieurs
travaux ont montré que le samedi matin libre favorise
l'endormissement tardif de l’enfant deux soirs de suite [vendredi et
samedi), ce qui retarde d'autant son horloge biologique et le
désynchronise le lundi et le mardi matin... A noter: une étude
publiée en février, réalisée sur 177 élèves de 14 ans, a montré pour
la première fois que plus les couchers le week-end sont tardifs,
plus le volume de matière grise cérébrale des adolescents diminue
(ainsi que leurs performances scolaires). Pour en revenir au
mercredi matin, une étude menée à Arras, rendue publique en juin
2016, indique que 82 % des enseignants, 46 % des animateurs et 64 %
des parents estiment que les derniers aménagements fatiguent les
enfants; De son côté, le rapport de l'Inserm déjà cité indique que
laisser le mercredi libre jusqu'à la fin du primaire “permet un
lever spontané supplémentaire qui apparait favorable à l'équilibre
de l’enfant”. Pour Claire Leconte, il ne fait aucun doute que “le
mercredi matin scolarisé est un choix par défaut, et non dans
l'intérêt de l'enfant”.
2 - RETARDER
L'HEURE D'ENTREE A L'ECOLE LE MATIN
La réforme de 2013 n'a rien changé
sur ce point. Or, une étude canadienne publiée en 2016 a montré que
36% des 10-18 ans qui commencent les cours à 8 h ne dorment pas
assez, et 65 % se sentent fatigués. Concernant spécifiquement la
France, des enquêtes ont révélé que près de 30 % des 15-19 ans sont
en dette de sommeil. “A la puberté, l’horloge biologique des
adolescents subit naturellement un décalage horaire de deux à trois
heures. Il devient alors très difficile pour eux de s'endormir
avant 23h, et de se lever avant 8h, explique l’épidémiologiste
Geneviève Gariépy, co-auteur de ces travaux. Commencer les cours
vers 9h 30 ou 10h serait plus compatible avec leur horloge
biologique". Une autre étude parue en février 2017, menée sur 30 000
lycéens américains, a mis en évidence, elle, que retarder d'une
heure l'entrée en cours des adolescents améliore leur taux de
présence à l'école et leurs chances de réussite aux examens. Ainsi,
deux ans après un démarrage différé des cours à 8h ou 9h, au lieu
de respectivement 7h ou 8h, le taux moyen d'obtention du diplôme a
grimpé en moyenne de 79 % à 88 %. Quant au taux de présence, il est
passé de 90% à 94 % en moyenne, voire de 68 % à 99 % dans certains
établissements !
Dès 2001, un rapport de l'Inserm
recommandait de retarder l'heure d'entrée en cours des
adolescents... Pour les plus jeunes, il précise: “Chez les 6-7 ans,
46 % des 'gros dormeurs nocturnes' (1 1 h 17à 12h43 de sommeil et 20
% des 'petits dormeurs' ont un réveil provoqué en période scolaire".
Cela dit, il n'existe pas de consensus concernant l’idée de
commencer l'école plus tard aussi en maternelle et en primaire.
“Contrairement aux adolescents, les
jeunes enfants sont plutôt du matin et se lèvent naturellement tôt.
Chez eux, le problème vient surtout de couchers trop tardifs ”,
tempère Claire Leconte.
3 - ALLEGER LA
JOURNEE SCOLAIRE
En ajoutant une demi-journée
d'école, la réforme de 2013 visait justement à alléger la journée
scolaire (5h40 par jour au plus, contre 6 h auparavant). Mais
lorsqu'on ajoute à ce temps scolaire les heures d'activités
périscolaires et de garderie nécessaires pour beaucoup d’enfants
dont les parents travaillent le temps de présence des enfants à
l'école pouvait atteindre huit à dix heures. Or, concernant les
apprentissages scolaires mêmes, plusieurs études ont montré que les
enfants ne peuvent rester concentrés plus de quatre à six heures par
jour, selon l’âge.
En 2005, François Testu et Baptiste
janvier (université François Rabelais de Tours) ont observé 30
élèves de maternelle (45 ans), 60 de CP (6-7 ans), et 80 de CM2
(10-11 ans). Résultat?
Tous âges confondus, le niveau de
vigilance augmente au fil de la matinée - surtout entre 9h50 et
10h40. Ensuite, tout dépend de l'âge. La vigilance des 4-5 ans
augmente lors de la pause déjeuner, entre 11h40 et 13h50, puis
diminue l'après-midi. Chez les primaires, la vigilance diminue à la
pause déjeuner, avant d'augmenter à nouveau en deuxième partie
d'après-midi, de façon plus légère chez les CP que chez les CM2.
Grosso modo, les plus jeunes sont réceptifs surtout en matinée, soit
pas plus de trois heures; les plus grands, le matin et en deuxième
partie d'après midi, soit environ six heures. “Ces données
suggèrent qu'il faut alléger Ia journée de travail scolaire
différemment selon l'âge ”, conclut François Testu.
4 - REVOIR LE
DECOUPAGE DES VACANCES
La réforme Peillon n'avait apporté
aucun changement à ce niveau. Pourtant, alors que les
chronobiologistes recommandent en général 7 semaines d'école,
suivies de 2 semaines de repos, les élèves de la zone C, par
exemple, n'ont eu cette année que 32 jours de classe entre les
vacances de Noël et d'hiver, mais ont dû se lever tôt 11,5 semaines
d’affilée entre les vacances de Pâques et d'été. .. Concernant ces
dernières dont la durée de 2 mois fut décidée en 1939 pour que les
enfants puissent aider aux travaux agricoles…“il serait judicieux de
les écourter afin d'allonger les congés d'hiver. Car alors, les
enfants ont besoin de plus de sommeil ”, explique Jacques Taillard,
neurobiologiste spécialiste des :rythmes biologiques (CNRS,
Bordeaux). En effet, “la tombée de la nuit, plus précoce en hiver,
induit une sécrétion plus tôt de l’hormone de l'endormissement, la
mélatonine”. Réduire les vacances d’été permettrait également
d'avoir plus de jours scolarisés et d'alléger la journée scolaire.
Enfin, “cela diminuerait les inégalités de réussite entre les enfants
de milieux défavorisés et les autres, qui ont, eux, les moyens de
pratiquer des activités scolaires l'été”, indique Bruno Suchaut,
chercheur en sciences de l’éducation à l’université de Lausanne.
Lors d'une étude menée sur 257 collégiens français, le chercheur a
en effet observé qu'à l'issue des vacances d’été, les plus favorisés
amélioraient leurs performances de 0,5 point sur 20, en moyenne.
Respecter les rythmes... à la maison
aussi
“Rien ne sert d’adapter les horaires
scolaires aux rythmes biologiques des enfants s’ils ne sont
respectés à la maison. Et là, cela relève des parents", insiste
Jacques Taillard.
Les conseils des experts sont
connus: information de l’enfant sur le rôle du sommeil pour sa
santé. Horaires de lever et de coucher réguliers, restriction des
écrans…
“Un coucher tardif n’est pas
totalement compensé par un lever tardif car la qualité du sommeil
n’est pas aussi bonne en matinée qu'’en début de nuit, ajoute Claire
Leconte. En cas des coucher tardif, préférez une sieste lors du
creux de vigilance, après le déjeuner.
|
 
Aude RAMBAUD -
SCIENCE & VIE 1199
|
|
DEUX ZONES TRES LOCALISEES DE
REGENERATION PERPETUELLE
Deux réserves de neurones immatures
ont à ce jour été localisées dans le cerveau humain.
L’une dans l'hippocampe, zone qui
régule les émotions et ou se forment les souvenirs ; il s‘y produit
jusqu‘à 700 nouveaux neurones par jour. L’autre réserve se situe
dans le striatum, région qui abrite le système de récompense et qui
produit le plaisir.
DE QUOI RELANCER LA MACHINE
Ce qui apparait clairement, en
revanche, c’est que fabriquer de nouveaux neurones à l’âge adulte
n’est pas un dû et que ce processus nécessite certaines conditions.
“Il existe en effet des facteurs
favorables et d'autres pas, et, malheureusement, la vie moderne fait
pencher la balance en faveur des seconds."
La sédentarité, le
surpoids, la passivité, le stress, l’isolement social ou encore le
manque de sommeil freinent ce phénomène.
Alors, en attendant de percer tous
les mystères de notre fascinant cerveau, rien ne nous empêche déjà
de tout faire pour relancer la machine de sa régénération.
|
 
|